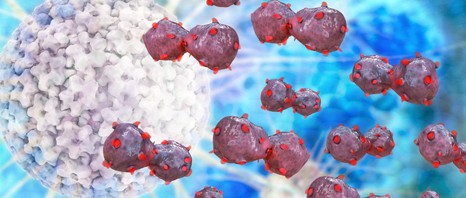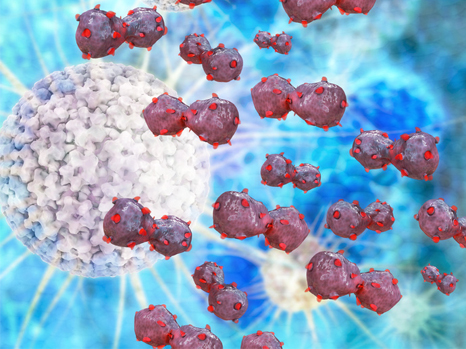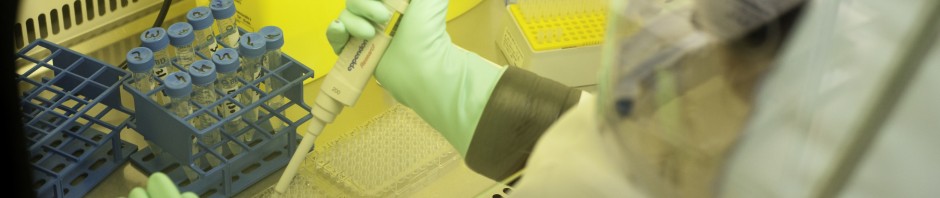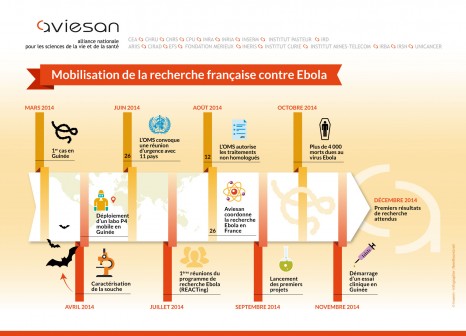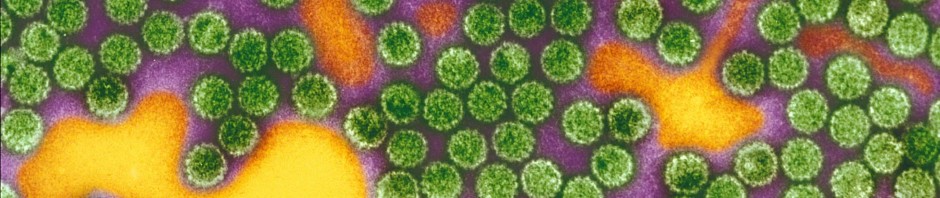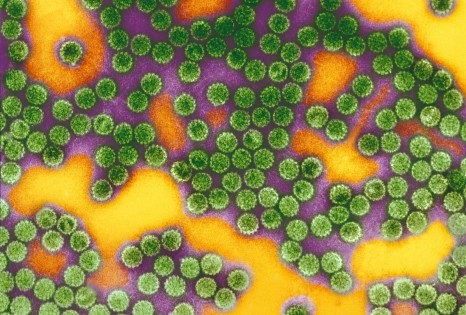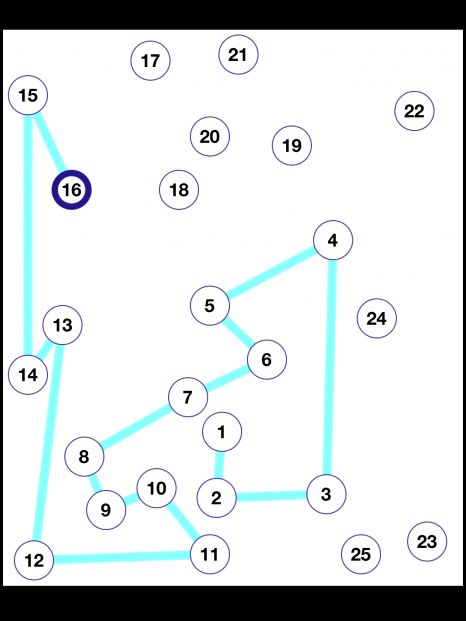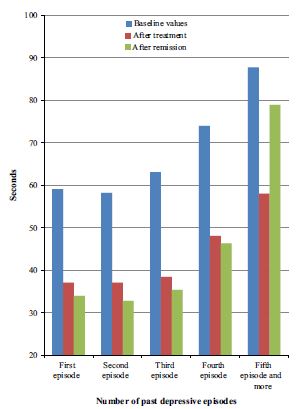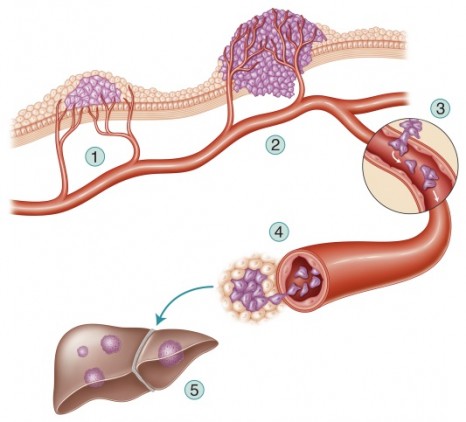À l’occasion des 3 ans et demi des enfants Elfe1, une nouvelle enquête est lancée ce 21 octobre, pour approfondir le recueil d’informations sur la petite enfance, par téléphone mais également au domicile des familles pour la première fois. La réussite de cette nouvelle étape résulte de l’investissement de toutes les familles convaincues de l’intérêt de cette recherche, qui va se poursuivre jusqu’aux 20 ans de leur enfant. Pilotée par l’Ined, l’Inserm et en partenariat avec l’EFS, cette étude nécessite de nombreuses étapes depuis la collecte des données jusqu’à la publication des résultats par les chercheurs. Certains viennent de paraître, dans les trois domaines de la santé, de l’environnement et des sciences sociales.
Éclairage sur les premiers résultats de l’étude Elfe, par Marie-Aline Charles,
Directrice de recherche Inserm au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations (CESP),
Directrice de l’étude Elfe (unité mixte Ined-Inserm-EFS)
Dans le domaine de la santé, l’enquête a permis d’apprendre que 70 % de mères allaitent à la maternité, un chiffre en forte progression depuis les années 19702:
Bien que les préparations pour nourrissons représentent aujourd’hui une alternative tout à fait acceptable pour les mères ne souhaitant ou ne pouvant pas allaiter, de nombreuses recherches scientifiques concluent à un effet positif de l’allaitement sur la santé de la mère et de l’enfant. Les résultats de cette étude Elfe confirment la tendance à l’augmentation de l’initiation de l’allaitement maternel en maternité, documentée depuis plusieurs années, en parallèle des nombreuses actions de santé publique qui ont été initiées pour promouvoir l’allaitement maternel.
À la maternité, 59 % des mères allaitent exclusivement et 11 % donnent un biberon en plus du lait maternel. Les mères qui allaitent plus fréquemment sont plus âgées, de corpulence normale et appartiennent à une catégorie socioprofessionnelle supérieure. Les mamans nées à l’étranger allaitent plus souvent, de même que les mères qui ont suivi des séances de préparation à la naissance et qui ne fument pas pendant leur grossesse. Il apparaît aussi que l’allaitement est plus fréquent lorsque les pères sont impliqués, présents à la naissance et que les couples sont mariés.
Pour poursuivre les efforts en matière de promotion de l’allaitement, les chercheurs proposent donc d’impliquer davantage les pères tout en permettant à plus de femmes d’assister aux séances de préparation à l’accouchement (par exemple, 70 % des ouvrières n’y ont pas assisté en 2011, contre 27 % des cadres).
Pour en savoir plus: BEH n°27 du 07 octobre 2014, Prévalence de l’allaitement à la maternité selon les caractéristiques des parents et les conditions de l’accouchement. Résultats de l’enquête Elfe maternité, France métropolitaine, 2011, par Claire Kersuzan et coll., Institut national de la recherche agronomique (Inra)
Dans le domaine de la santé-environnement, les premiers résultats sur la contamination des logements par des micro-organismes vont être publiés3:
Grâce aux 3 000 capteurs à poussières qui ont été déposés dans les chambres des enfants au cours des 2 premiers mois de leur vie, les micro-organismes recueillis (acariens, moisissures) ont été analysés afin d’évaluer leur influence sur la santé ultérieure, notamment respiratoire. Six profils différents de contamination des logements ont été identifiés, dont deux sont assez fréquents dans l’Ouest de la France (l’un étant riche en acariens et bactéries, l’autre en acariens, bactéries et moisissures). Un plus fort taux d’humidité et des températures plus favorables au développement de ces micro-organismes pourraient expliquer ces résultats. La répartition géographique de ces profils se superpose avec celle issue d’une étude récente menée dans les crèches sur la fréquence de l’asthme des jeunes enfants4. Les données de suivi des enfants Elfe vont permettre de confirmer ou non l’existence d’une relation entre ces profils de contamination et la santé respiratoire des enfants. L’objectif, dans le cadre de l’étude Elfe, est d’observer plus attentivement les maladies respiratoires dans ces régions en corrélation avec la qualité du logement, la ventilation, l’isolation…
Dans le domaine des sciences sociales, les prochaines publications renseigneront sur la façon dont les parents se préparent à la naissance d’un enfant et en particulier sur leur désir de connaître son sexe5:
Les résultats d’Elfe montrent que près de 9 futurs parents sur 10 souhaitent connaître le sexe de leur enfant avant sa naissance. Pour leur premier enfant, 60 % des parents n’expriment pas de préférence. Lorsqu’ils en ont une, elle est équilibrée chez les mères (20 % pour une fille et 20 % pour un garçon) alors que les pères privilégient davantage les garçons (25 % préfèrent un garçon et 14 % une fille). Lorsqu’il s’agit du deuxième enfant, la proportion de parents qui n’ont pas de préférence diminue légèrement. Et quand elle est exprimée, elle est très dépendante du sexe de l’aîné, les parents souhaitant souvent des fratries mixtes. Un objectif de ce projet de recherche est de mesurer si cette préférence influence le début de la parentalité…
Une nouvelle enquête aux 3 ans ½ de l’enfant, au moment de l’entrée à l’école maternelle

2 contacts sont prévus lors de cette étape importante de la vie des jeunes enfants :
- Une interview téléphonique auprès de l’un des parents portera notamment sur l’actualisation des informations concernant l’environnement de l’enfant (familial, social, économique, culturel, alimentaire, etc.), les pratiques éducatives des parents, le développement psychomoteur de l’enfant et les évènements de santé… De nouveaux thèmes dont l’entrée à l’école maternelle seront également abordés.
- Une visite à domicile chez environ 10 000 familles permettra un contact direct avec l’enfant. La réalisation d’un dessin, quelques jeux visuels et d’association d’images renseigneront les chercheurs sur le développement cognitif et les apprentissages de l’enfant.

Vidéo – La visite de l’enquêteur à domicile
Pour les familles qui ont déjà participé au volet biologique en maternité, de nouveaux recueils non invasifs, comme les urines de l’enfant, sont prévus. Une collecte de poussières sera également réalisée dans quelques foyers afin de mesurer différentes substances présentes dans l’environnement des enfants. Enfin, des familles volontaires pourront faire porter à leur enfant un « compteur de mouvements », ou accéléromètre, pour mesurer son activité physique et la qualité de son sommeil.
L’évolution de cette étude sans précédent, qui compte 1 enfant sur 50 parmi les naissances de 2011 en France, repose sur l’implication des familles qui, dès la maternité, ont accepté le principe d’un entretien initial puis d’un suivi régulier. Les familles de l’étude Elfe sont des acteurs essentiels de la recherche, mobilisées sur… 20 ans.
À propos de l’étude Elfe
L’étude Elfe mobilise un grand nombre de chercheurs français appartenant à diverses disciplines scientifiques. Pilotée par l’Institut national d’études démographiques (Ined), l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), en partenariat avec l’Établissement Français du Sang (EFS), l’étude Elfe est soutenue par les ministères chargés de la Recherche, du Développement durable, des Affaires sociales et de la Santé, et par des institutions publiques : Institut de Veille Sanitaire (InVS), Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf) et Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). L’étude Elfe bénéficie d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du programme « Investissements d’avenir » portant la référence ANR-11-EQPX-0038.
1 Elfe est la première étude longitudinale française consacrée au suivi des enfants, de la naissance à l’âge adulte. Elle aborde les multiples aspects de la vie de l’enfant sous l’angle des sciences sociales, de la santé et de la santé-environnement, pour mieux comprendre leurs interactions. Au cours de 4 périodes d’inclusion en 2011, plus de 18 000 familles ont accepté de rejoindre l’aventure Elfe en France métropolitaine.
2 BEH n°27 du 07 octobre 2014, Prévalence de l’allaitement à la maternité selon les caractéristiques des parents et les conditions de l’accouchement. Résultats de l’enquête Elfe maternité, France métropolitaine, 2011, par Claire Kersuzan et coll., Institut national de la recherche agronomique (Inra)
3 Steffi Rocchi, Gabriel Reboux et coll., Université de Franche Comté, UMR 6249 Chrono-environnement, publication à paraître dans Sciences of total Environment sous le titre : Microbiological characterization of 3193 French dwellings of Elfe cohort children.
4 Etude menée auprès de 20 000 enfants en crèche, qui présentaient des sifflements et de l’asthme : Delmas MC, Prévalence et contrôle de l’asthme chez le jeune enfant, Revue des maladies respiratoires, 2012.
5 XVIIIe colloque international de l’Aidelf, Université de Bari, 26-30 mai 2014, Olivia SAMUEL et coll., Université Versailles St Quentin, Printemps/Ined-IPOPs