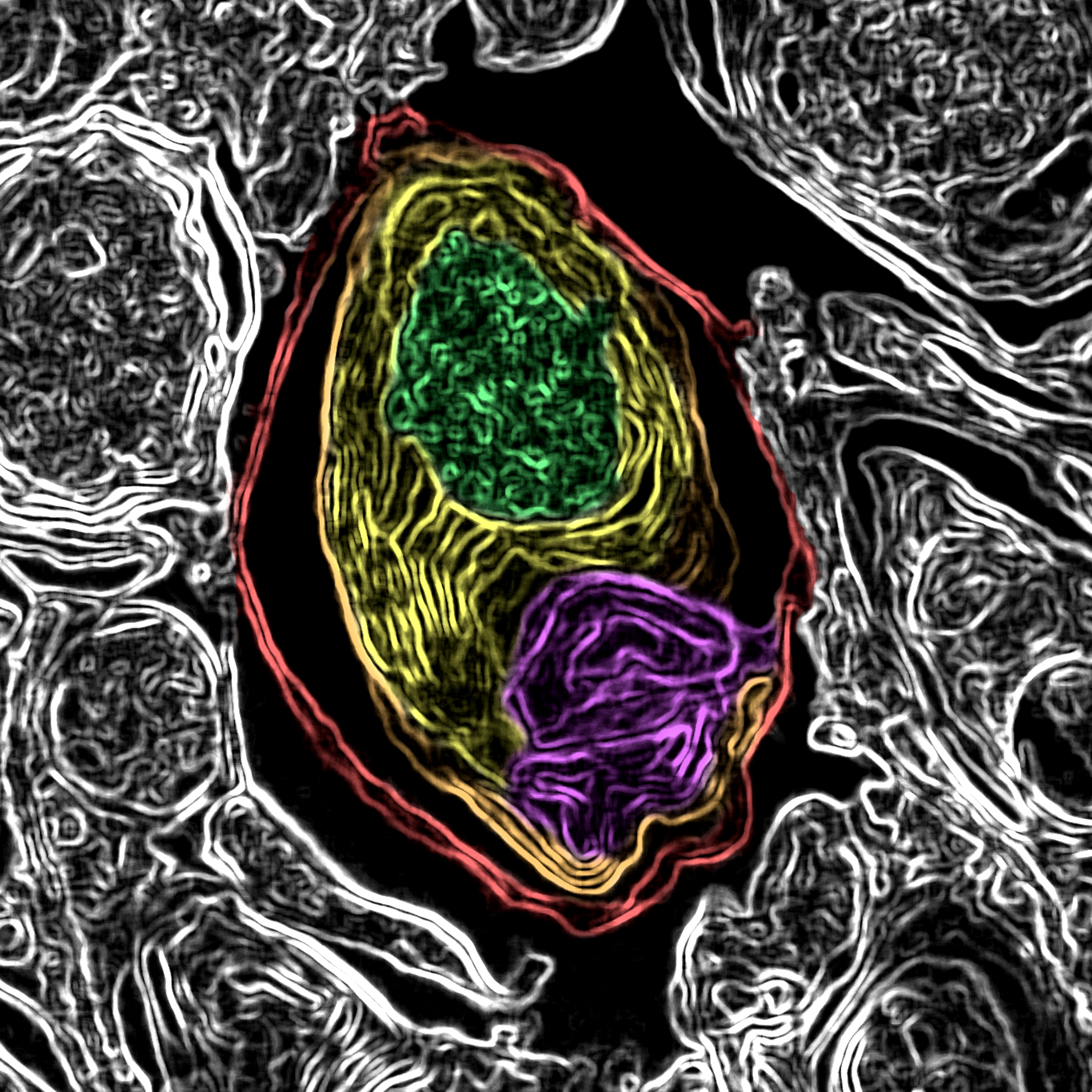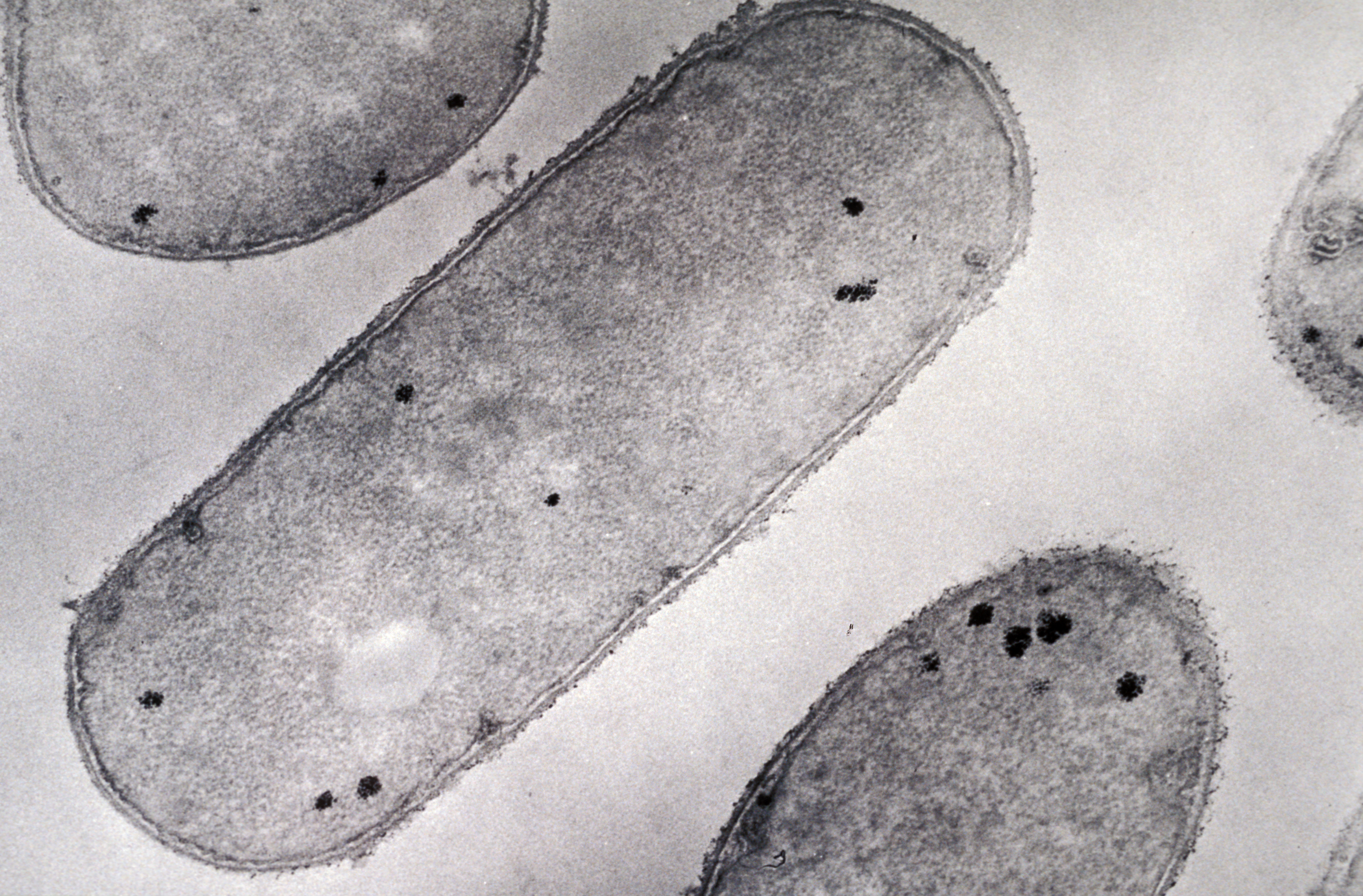Photo by George Kourounis on Unsplash
Des chercheurs de l’Inserm au sein du Bordeaux Population Health Research Center, du Paris Cardiovascular Research Center, de l’Université de Bordeaux et de la cohorte des 3 Cités ont démontré que maintenir à un niveau optimal et combiner plusieurs facteurs et comportements bénéfiques pour le cœur était associé à un risque diminué de développer une démence et un déclin cognitif après 65 ans. Les chercheurs ont utilisé le concept de santé cardiovasculaire optimale défini par l’American Heart Association dans ses objectifs à 2020 pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Cette étude a été publiée dans la revue JAMA.
Dans le cadre d’une nouvelle étude épidémiologique menée au sein de la grande cohorte Française des 3 Cités initiée en 1999 pour comprendre l’impact des facteurs de risque vasculaires dans le vieillissement cognitif et la démence, des chercheurs de l’Inserm (au sein du Bordeaux Population Health Research Center et du Paris Cardiovascular Research Center) ont suivi en France pendant 16 ans, 6 626 adultes âgés de 65 ans et plus. Plusieurs travaux ont à ce jour montré la pertinence de l’approche de la prévention dans le cas des maladies cardiovasculaires. Compte tenu des liens biologiques et de la présence de facteurs de risque communs entre maladies cardiovasculaires et démence, l’équipe de recherche s’est intéressée aux bénéfices de la prévention des facteurs de risque vasculaires pour les démences et le déclin cognitif.
La notion de « santé cardiovasculaire optimale » telle qu’elle est définie par l’American Heart Association repose sur 7 paramètres qui intègrent 4 comportements de santé (ne pas fumer, avoir un poids corporel optimal, une activité physique et une alimentation en adéquation avec les recommandations de santé publique) et 3 composantes biologiques (avoir un taux de cholestérol, un taux de glucose et une tension artérielle à un niveau idéal, et ce sans traitement).
Bien que cette étude possède ses limites, notamment concernant la population étudiée issue du milieu urbain et la variation possible des paramètres pris en compte. Elle montre néanmoins que le fait de maintenir une santé cardiovasculaire dite optimale (7 paramètres au niveau idéal) est associé à une diminution importante du risque de développer une démence, et à une atténuation du déclin cognitif qui lui est associé.
Ainsi par exemple, chaque paramètre supplémentaire à niveau idéal est associé à une diminution de 10% du risque de démence (si les 7 paramètres sont à un niveau optimal, la réduction du risque est de 70 % par rapport à ceux n’en ayant aucun).
Si l’objectif est d’atteindre une santé cardiovasculaire optimale, l’étude montre que le simple fait d’avoir un seul paramètre au niveau idéal est associé à une diminution du risque de démence. Cécilia Samieri, chercheuse Inserm en charge de l’étude précise : « En pratique, cet objectif paraît plus réaliste et pourrait permettre de toucher un plus grand nombre de personnes et donc d’avoir des effets plus importants. La promotion de la santé est un enjeu collectif des pouvoirs publics et des professionnels de santé mais qui implique également que chacun soit acteur de sa propre santé ».