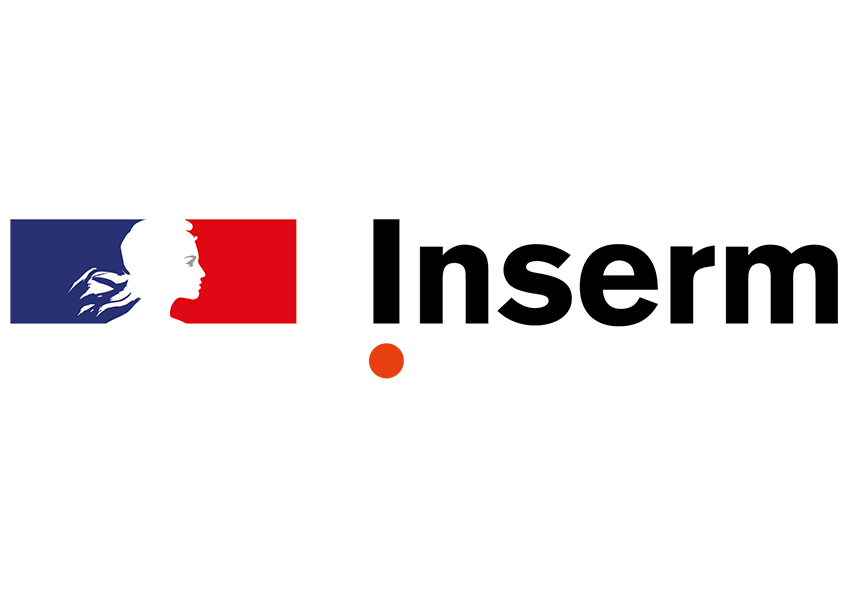© Inserm
« La remise des prix Inserm constitue un moment clé dans la vie de l’Institut, qui permet d’abord de montrer tout le talent de nos collaborateurs, ainsi que la grande richesse des recherches que nous menons pour faire front commun au service de la santé de nos concitoyens. Mais c’est aussi l’occasion de rappeler notre implication au cœur de la société, notre engagement en faveur d’une recherche scientifique efficace, éthique et accessible au plus grand nombre », souligne Gilles Bloch, PDG de l’Inserm.
Cette année les prix Inserm sont attribués à cinq lauréates et lauréats dont les résultats et l’engagement en faveur d’une recherche de qualité témoignent de l’excellence scientifique et de la place centrale de l’Institut au sein de la société. Le Grand Prix Inserm 2022 est décerné à Olivier Delattre, oncopédiatre dont le travail a permis des découvertes majeures dans les cancers pédiatriques.
Olivier Delattre, Grand Prix Inserm
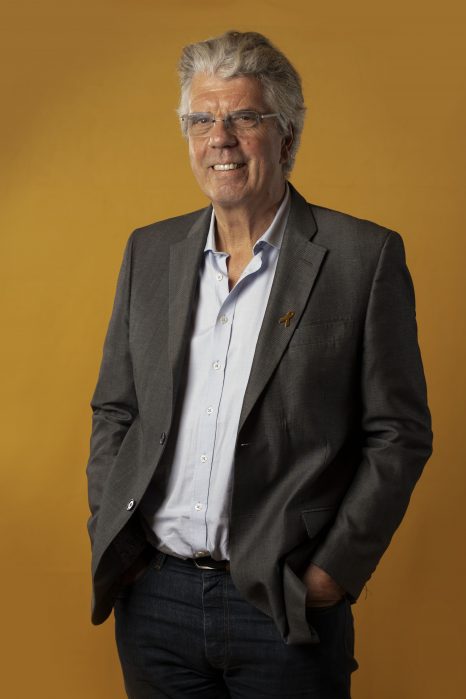
Olivier Delattre © Inserm/François Guénet
« Pédiatre un jour, pédiatre toujours », c’est peut-être la formule qui décrit le mieux l’engagement d’Olivier Delattre. Directeur du laboratoire Cancer, hétérogénéité, instabilité et plasticité (unité 830 Inserm/Institut Curie), ce chercheur a débuté sa carrière par des études de médecine, durant lesquelles il s’est tourné vers la pédiatrie. Un passage dans le service d’oncologie pédiatrique de l’institut Curie à Paris l’incitera à se spécialiser sur les cancers de l’enfant et à reprendre des études de biologie en parallèle de son activité de médecin.
Au début des années 1990, il décide de se consacrer entièrement à la recherche dans le but d’améliorer la compréhension, le diagnostic et le traitement des cancers pédiatriques et rejoint donc l’Inserm. Dès 1992, il est impliqué dans une première mondiale quand son équipe identifie et caractérise les gènes à l’origine du sarcome d’Ewing, un cancer des os de l’enfant. Dans les années qui suivent, les découvertes s’accumulent avec des avancées significatives dans la compréhension des tumeurs rhabdoïdes, des cancers rares, très agressifs.
En 2018, autre étape clé de son parcours, il fonde le centre SIREDO (Soins, innovation, recherche en oncologie de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte jeune), au sein de l’institut Curie à Paris qu’il dirige depuis. Une initiative qui a permis de réunir en un même lieu des équipes de soins et de recherche qui se consacrent aux tumeurs solides touchant les moins de 25 ans. Dans ce centre précurseur, l’ambition est de collaborer plus efficacement et de faire en sorte que les recherches fondamentales puissent bénéficier rapidement aux patients.
C’est cette volonté d’aller toujours plus loin au service de la santé des jeunes patients et de leurs familles, en continuant sans relâche à œuvrer pour mieux comprendre leurs maladies et les soigner, qui vaut aujourd’hui à Olivier Delattre de recevoir le Grand Prix Inserm.
Valérie Gabelica, Prix Recherche

Valérie Gabelica © Inserm/François Guénet
La spectrométrie de masse, outil de chimie analytique vieux de plus d’un siècle, a connu un coup de jeune grâce aux travaux de Valérie Gabelica et de son équipe.
Chercheuse au sein du laboratoire ARNA (unité 1212 Inserm/CNRS/Université de Bordeaux), cette chimiste a notamment développé avec ses collègues une méthode innovante couplant spectrométrie de masse et lumière polarisée circulairement permettant de mieux étudier la structure des acides nucléiques – ADN et ARN – et leurs interactions avec d’autres molécules. Or comprendre ces interactions, c’est aider la recherche à découvrir de nouveaux médicaments par exemple.
Un travail de longue haleine, qui permet d’offrir à la recherche biomédicale de nouveaux outils très précieux, et qui témoigne de l’importance et de l’excellence de la recherche transdisciplinaire menée à l’Inserm.
Valérie Crépel, Prix Innovation

Valérie Crépel © Inserm/François Guénet
Parmi les épilepsies, celle du lobe temporal est la plus fréquente chez l’adulte. En 2005, Valérie Crépel, directrice de recherche Inserm à l’Institut de neurobiologie de la méditerranée à Marseille, a montré que les récepteurs kaïnate du glutamate, un neurotransmetteur clé du système nerveux, y sont impliqués. Son collègue Christope Mulle découvrira peu après que ces récepteurs sont un élément clé de la genèse de cette épilepsie dans l’hippocampe et une cible thérapeutique potentielle.
Accompagnés par Inserm Transfert, la fililale de l’Inserm pour le tech transfer, les scientifiques ont déposé un premier brevet en 2013. Le projet n’a ensuite cessé de se développer, aboutissant à la création en 2019 de la start-up Corlieve Therapeutics. Celle-ci est ensuite devenue, en 2021, une filiale de la biotech néerlandaise uniQure. Des années de recherche dans le domaine de l’épilepsie et des efforts de valorisation qui ont donc payé : ce travail va donner lieu à un essai clinique pour tester un traitement chez les personnes malades.
Justine Bertrand-Michel, Prix Appui à la recherche

Justine Bertrand-Michel © Inserm/François Guénet
Chimiste de formation, Justine Bertrand-Michel a toujours dédié sa carrière à soutenir le travail des chercheurs. Depuis 2021, elle dirige d’une main de maître la plateforme MetaToul, la plus importante en France avec 6 équipes, 40 ingénieurs, 23 systèmes d’analyse et 4 robots.
Cette plateforme de métabolomique permet l’analyse des métabolites, les composés issus du métabolisme de tout être vivant (glucose, acides aminés, nucléotides…).
Un travail qui la passionne et qui suppose de bien connaître les enjeux des équipes de recherche pour proposer des prestations, développer des méthodes, former des nouveaux personnels tout en assurant un équilibre budgétaire.
Priscille Rivière, Prix Science et société-Opecst

Priscille Rivière © Inserm/François Guénet
Directrice adjointe du département de l’Information scientifique et de la communication de l’Inserm, Priscille Rivière œuvre au service d’une diffusion claire, transparente et rigoureuse de la science auprès du grand public.
La pandémie de Covid-19 s’est aussi accompagnée d’un essor de la désinformation dans le domaine de la santé.
Les différentes initiatives qu’elle a mises en place avec l’équipe communication – de la série Canal Détox au développement d’un réseau de chercheurs référents pour répondre aux médias, baptisé cellule Riposte – permettent aujourd’hui à l’Inserm d’apporter une véritable pierre à l’édifice dans la lutte plus globale contre les fausses infos. Et de bâtir un dialogue fondé sur la confiance entre scientifiques et citoyens, pour améliorer la santé de tous.
Les Prix Inserm
Le Grand Prix rend hommage à un acteur de la recherche scientifique française dont les travaux ont permis des progrès remarquables dans la connaissance de la physiologie humaine, en thérapeutique et, plus largement, dans la recherche en santé.
Le Prix Recherche distingue un chercheur, un enseignant-chercheur ou un clinicien chercheur dont les travaux ont particulièrement marqué le champ de la recherche fondamentale, de la recherche clinique et thérapeutique et de la recherche en santé publique.
Le Prix Innovation revient à un chercheur dont les travaux ont fait l’objet d’une valorisation entrepreneuriale.
Le Prix Appui à la recherche est décerné à un ingénieur, technicien ou administratif pour des réalisations marquantes au service de l’accompagnement de la recherche.
Enfin, le Prix Science et société-Opecst récompense un chercheur, ingénieur, technicien ou administratif qui s’est distingué dans le domaine de la valorisation de la recherche et par sa capacité à être en dialogue avec la société et à l’écoute des questions des citoyens sur leur santé.