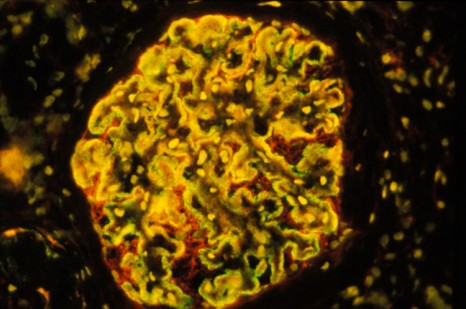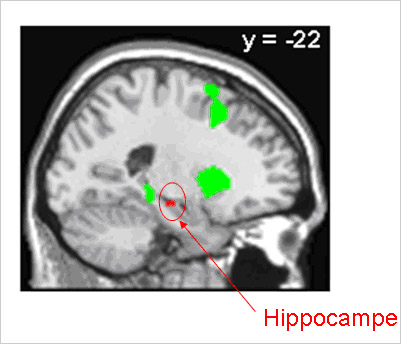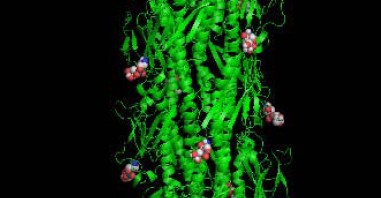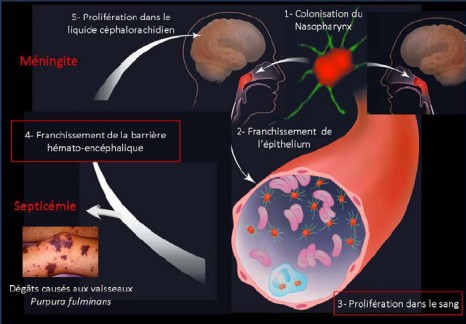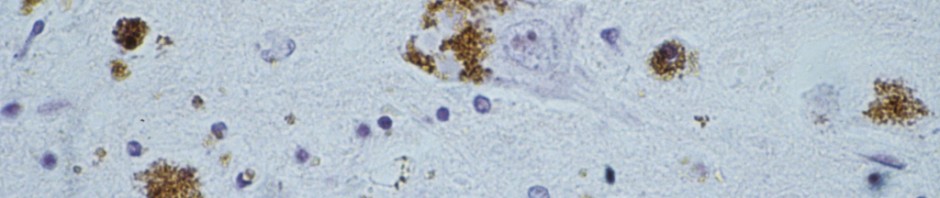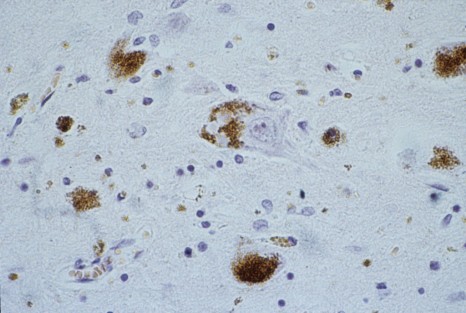Les différences de santé entre groupes socio-économiques constituent l’un des résultats les plus constants de la recherche épidémiologique. L’équipe d’Archana Singh-Manoux de l’unité Inserm 1018 a mis en place une collaboration entre la cohorte française GAZEL (quelque 20000 personnes) et la cohorte britannique Whitehall II (environ 10000), afin de mieux comprendre le rôle des comportements de santé dans la genèse des inégalités sociales de mortalité selon les contextes socioculturels. Quelle que soit la population suivie (française ou britannique), l’association entre position socio-économique et mortalité d’une part, comportements de santé (régime alimentaire, activité physique, consommation d’alcool et de tabac) et mortalité d’autre part ; sont du même ordre de grandeur. En revanche, les chercheurs ont montré que chez les participants britanniques, les comportements néfastes étaient d’autant plus répandus que les personnes appartenaient à une classe sociale peu élevée. Ce qui est moins le cas dans la cohorte française.
Les résultats, publiés dans la revue PloS Medicine datée du 22 février sont disponibles en ligne.
© Fotolia
Les recherches épidémiologiques ont montré des différences de mortalité selon la position socio-économique dans différents pays. Silvia Stringhini, doctorante en d’épidémiologie dans l’Unité Inserm 1018, a montré que les « comportements sociaux » de santé (régime alimentaire, activité physique, consommation d’alcool et de tabac), qui constituent le mode de vie des individus, expliqueraient en grande partie l’association entre la position socio-économique et la mortalité dans un papier publié en 2010 (Stringhini et al., JAMA 2010). Jusqu’à présent, la contribution de ces comportements aux inégalités sociales de santé dans différents contextes culturels restait peu connue. C’est pourquoi, dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont comparé leurs résultats à ceux de la cohorte française GAZEL en vue de les généraliser.
La cohorte épidémiologique GAZEL, à laquelle participent activement plus de 20 000 volontaires, agents et anciens agents d’EDF – GDF, a été mise en place en 1989. La cohorte Whitehall II, mise en place en 1985, est basée sur plus de 10 000 fonctionnaires britanniques.
Ces deux cohortes sont comparables pour l’âge des participants, la période de suivi, les mesures de la position socio-économique et les comportements de santé. Plusieurs indicateurs de la position socio-économique ont été utilisés : la profession, le niveau d’étude et le revenu.
La comparaison entre les pays
Quatre comportements potentiellement néfastes pour la santé ont été étudiés : consommation excessive d’alcool et de tabac, régime alimentaire déséquilibré, manque ou faible niveau d’activité physique.
- Le lien entre la position socio-économique et la mortalité est similaire dans les deux cohortes : le taux de mortalité en France comme en Grande-Bretagne est deux fois plus important dans la catégorie socio-économique la moins élevée par rapport à la catégorie la plus élevée.
- Dans la cohorte britannique, globalement, les comportements néfastes pour la santé sont plus fortement associés au statut socio-économique que dans la cohorte française.
- Les chercheurs observent les mêmes résultats pour les différents indicateurs de la position socio-économique (profession – niveau d’étude – revenu).
Contrairement à ce qui se passe en Grande-Bretagne, ces résultats montrent que les comportements néfastes pour la santé semblent avoir une moindre influence sur les inégalités sociales de mortalité en France.
« La répartition sociale des comportements néfastes pour la santé dans la population est très différente d’un pays à l’autre. Cependant, l’association entre les comportements de santé et la mortalité suggère que la santé des populations pourrait être améliorée en ciblant les comportements néfastes quel que soit le contexte culturel » conclut Silvia Stringhini.
Les auteurs de l’étude s’accordent sur la prise en compte, pour la prévention, des différences culturelles qui jouent sur la répartition des comportements néfastes : « d’autres facteurs semblent contribuer aux inégalités sociales comme l’environnement, le stress et la prévention au travail, la sécurité sociale ou encore l’accès aux soins », ajoute Silvia Stringhini. Autant de facteurs dont l’étude comparative permettrait à terme d’identifier les déterminants universels et les cibles des inégalités sociales de santé.