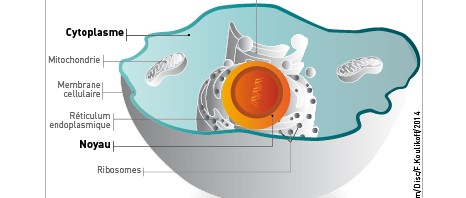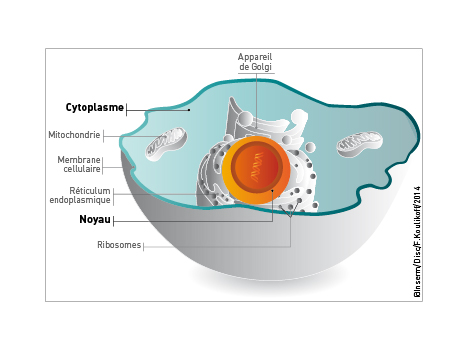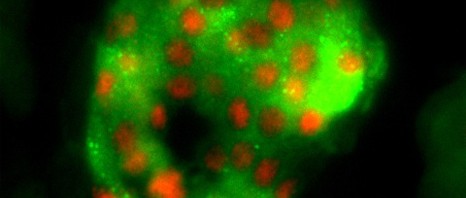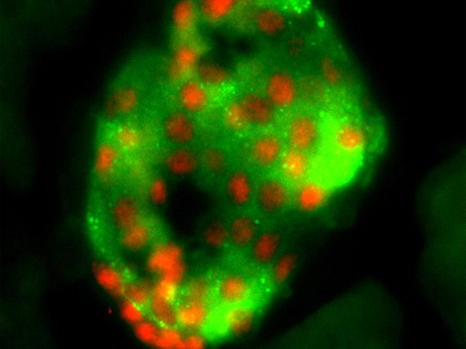Existe-t-il une relation entre le groupe sanguin et le risque de diabète de type 2 ? C’est ce qu’ont étudié Guy Fagherazzi et ses collaborateurs de l’Unité mixte de recherche 1018 « Centre de recherche en épidémiologie et sante des populations » (Inserm/Université Paris-Sud) à Gustave Roussy. L’analyse, menée auprès de 82 104 femmes de la cohorte E3N suivies pendant 18 ans, suggère pour la première fois que le risque de diabète de type 2 serait plus faible pour les individus de groupe « O », que pour les groupes A, B et AB.
Ces résultats sont publiés dans le journal Diabetologia.
Le diabète touche plus de 382 millions de personnes dans le monde dont 90% sont atteintes du diabète de type 2. Environ 4,6% de la population française est affectée par cette pathologie, et ce chiffre ne cesse d’augmenter. Les facteurs de risque connus sont l’obésité, l’inactivité physique, un apport calorique trop élevé, le tabagisme, l’hypertension ou l’hypercholestérolémie. Les chercheurs estiment qu’il est aujourd’hui capital d’identifier de nouveaux facteurs qui permettront de mieux comprendre cette maladie et ainsi de ralentir son développement.
Dans cette étude, 82 104 femmes françaises de la cohorte E3N ont été suivies pendant 18 ans, entre 1990 et 2008.
« Nous montrons, pour la première fois dans une si grande population, que les femmes ayant le groupe sanguin O – environ 43% des Français sont de ce groupe aujourd’hui – ont un risque moindre de développer un diabète de type 2 » explique Guy Fagherazzi, épidémiologiste à l’Inserm.
En détail, les femmes avec d’autres groupes sanguins avaient un risque accru de développer un diabète, allant de 10% pour le groupe A, 17% pour le groupe AB et 21% pour le groupe B, par rapport au groupe O.
Lorsque le rhésus de la personne était pris en compte, les chercheurs notent que les femmes ayant un groupe sanguin O- (seuls 6% de la population en France) avaient un risque de diabète plus faible que les autres.
Comment peut-on expliquer ces résultats ?
Peu de mécanismes biologiques permettent aujourd’hui de relier le groupe sanguin et le risque de diabète de type 2, mais certaines hypothèses déjà identifiées permettraient d’expliquer en partie l’association observée :
- Il semblerait que certains marqueurs endothéliaux et marqueurs d’inflammation soient présents en plus grande quantité chez les personnes qui ne sont pas du groupe O. Or ces marqueurs sont associés à un risque accru de diabète de type 2.
- Le groupe sanguin ABO a déjà été identifié comme étant un des facteurs génétiquement déterminés qui module la composition du microbiote intestinal, qui à son tour joue un rôle dans le métabolisme du glucose, la balance énergétique ainsi que l’inflammation chronique.
« Malgré la robustesse de nos données, il est nécessaire de répliquer cette étude dans d’autres grandes populations, en particulier avec d’autres patrimoines génétiques, chez les hommes, même si les mécanismes proposés ne sont pas dépendants du sexe » souligne Guy Fagherazzi, premier auteur de l’étude.
Si ces observations sont confirmées, le groupe sanguin pourrait être une information pertinente à recueillir dans la pratique courante, dans les futures études portant sur le diabète de type 2 et dans le cadre du suivi de personnes à risque. Les chercheurs devront déterminer pourquoi les individus du groupe O ont un risque plus faible de développer un diabète de type 2.
Pour en savoir plus :
LES ETUDES E3N (www.e3n.fr) ET E4N (www.e4n.fr)
L’étude E3N, ou Etude Epidémiologique auprès de femmes de la MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale), dirigée par Françoise Clavel-Chapelon, directrice de recherche à l’Inserm, est une étude de cohorte prospective portant sur environ 100 000 femmes volontaires françaises nées entre 1925 et 1950 et suivies depuis 1990.
Depuis 1990, les femmes remplissent et renvoient des auto-questionnaires tous les 2 à 3 ans. Elles sont interrogées sur leur mode de vie (alimentation, prise de traitements hormonaux…) d’une part, et sur l’évolution de leur état de santé d’autre part.
Les données sur les facteurs de risque ont fait l’objet de plusieurs études de validation. Le taux de « perdues de vue » est très faible du fait de la possibilité qu’offre la MGEN de suivre les non-répondantes. Mais c’est avant tout grâce à la fidélité et à la constance des participantes, et grâce à la collaboration des médecins traitants, que l’étude E3N peut fournir tous ces résultats.
L’étude E3N est soutenue par quatre partenaires fondateurs : l’Inserm, la Ligue contre le Cancer, l’Institut Gustave Roussy et la MGEN.
L’étude E4N vient d’être lancée et vise à prolonger l’étude E3N en suivant les membres de la famille des femmes E3N. A terme, E4N rassemblera trois générations : les femmes E3N et les pères de leurs enfants constituent la première génération, leurs enfants, la deuxième, et leurs petits-enfants formeront la troisième génération. Le suivi des trois générations permettra de recueillir des informations sur les facteurs comportementaux et environnementaux à différentes périodes de la vie. L’objectif principal de l’étude E4N est d’étudier la santé en relation avec l’environnement et le mode de vie moderne chez des sujets d’une même famille ayant un terrain génétique et un environnement communs.