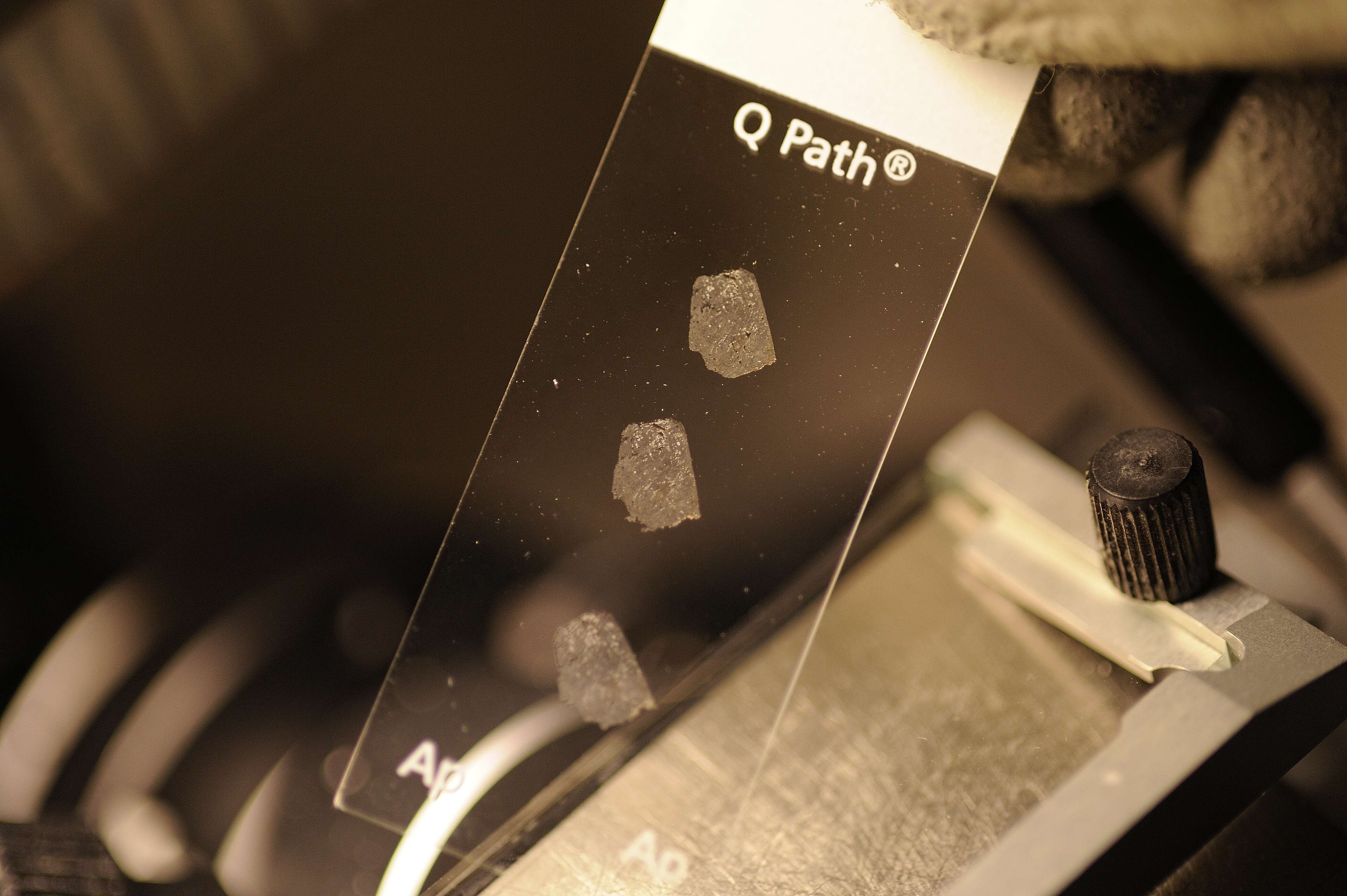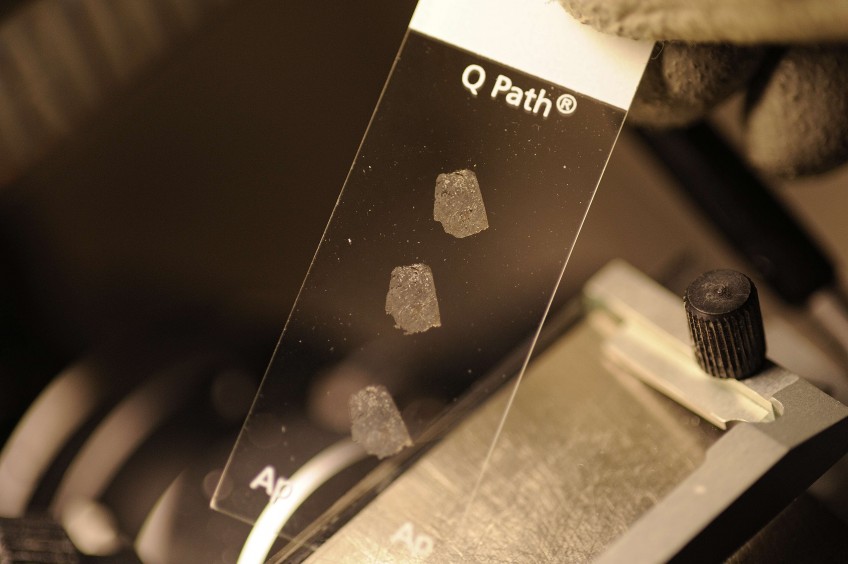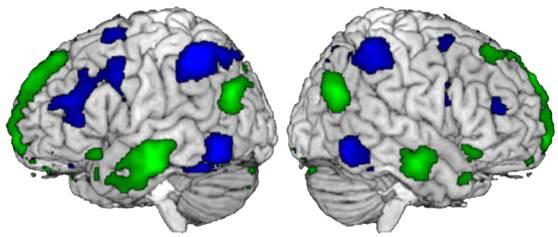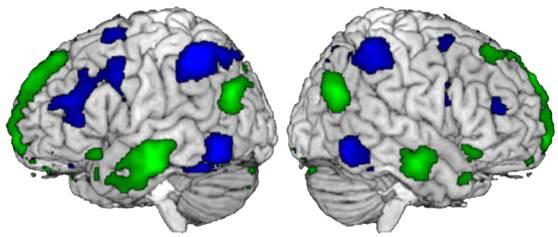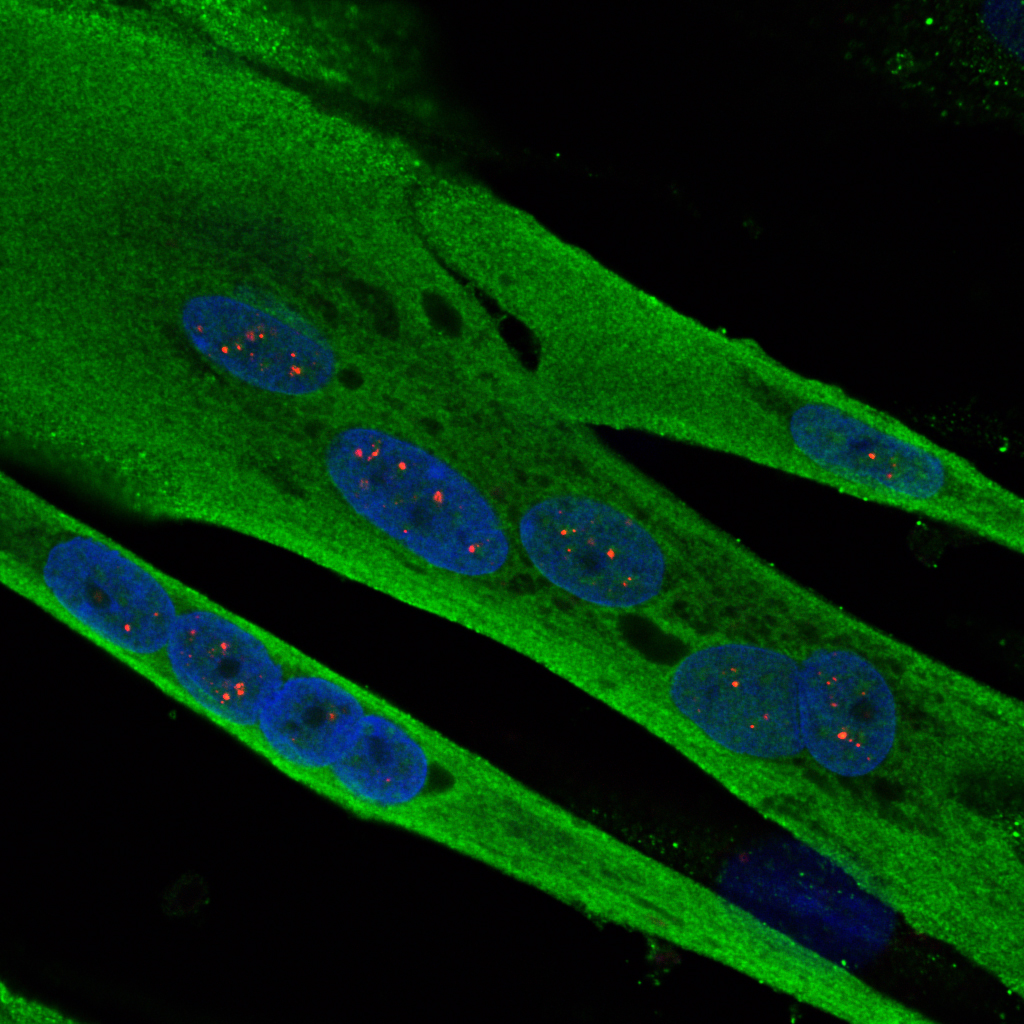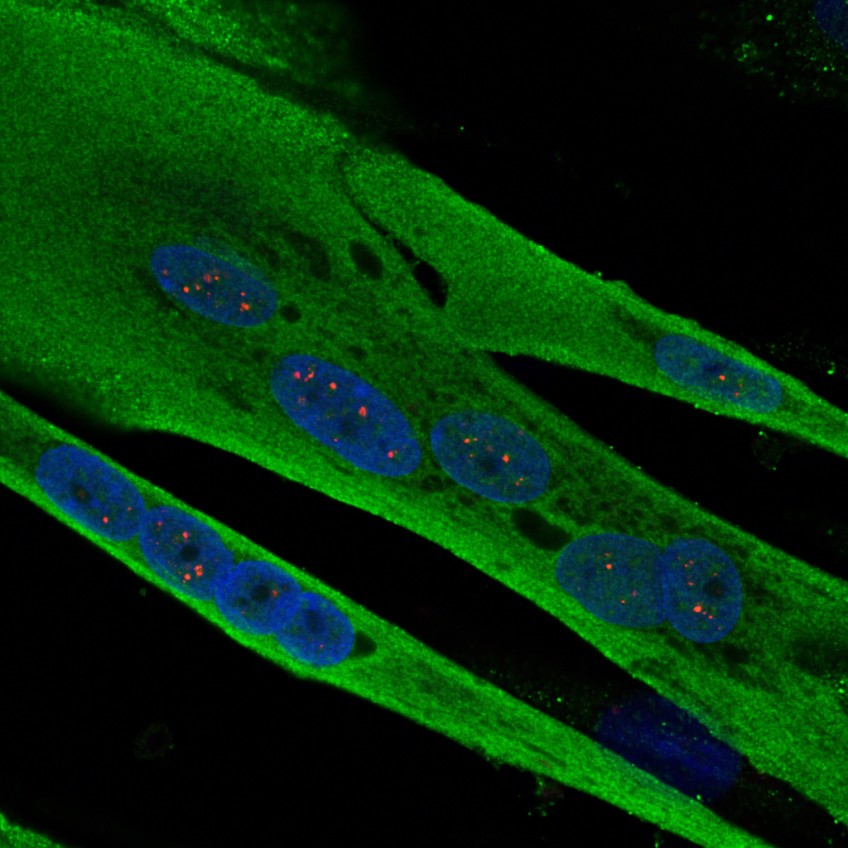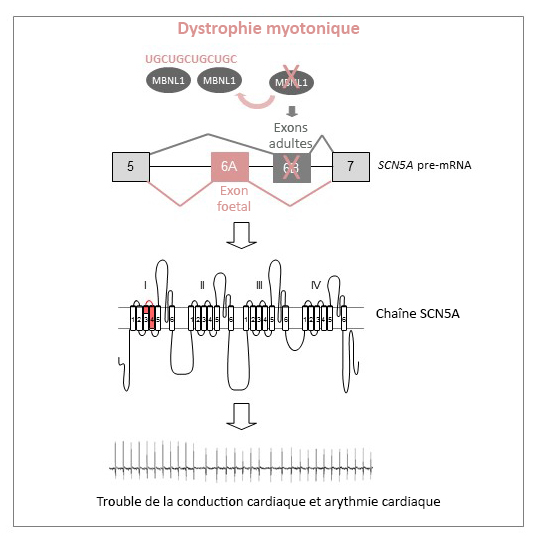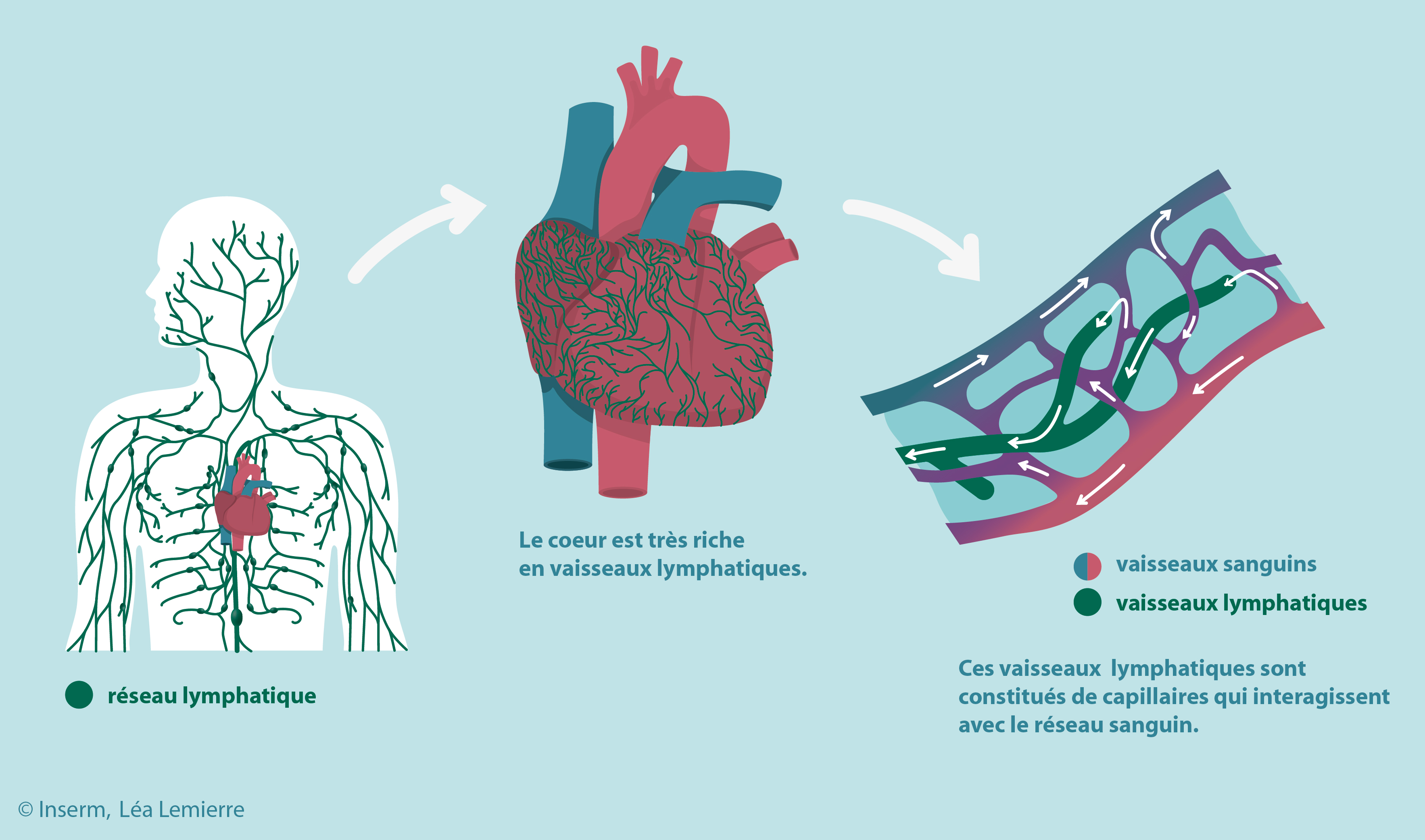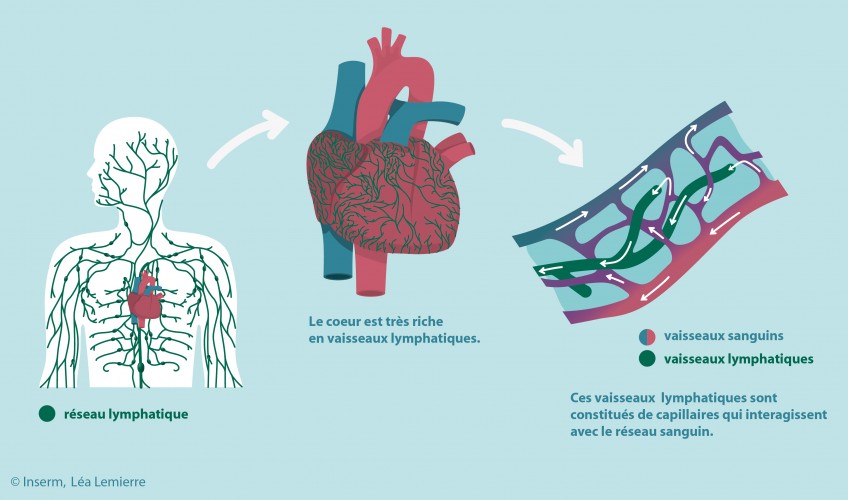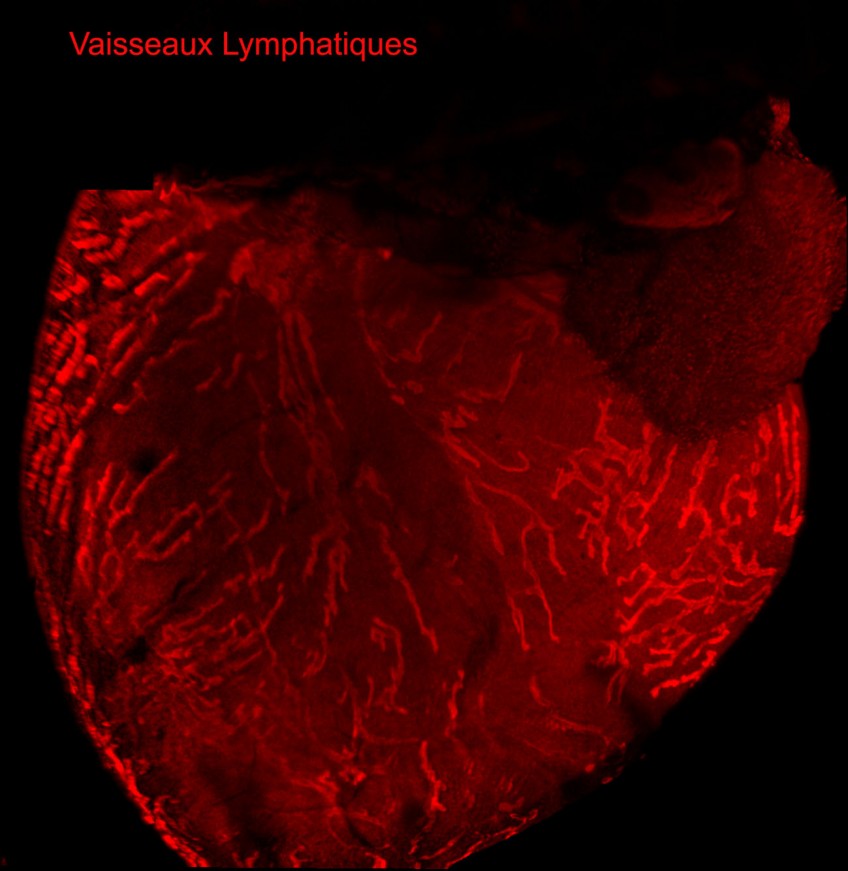La Commission européenne est légalement tenue de fournir des critères d’identification des composés agissant comme perturbateurs endocriniens (PE), un processus bloqué depuis près de trois ans, avec comme motifs avancés un manque de consensus scientifique et la nécessité d’une étude d’impact. Aujourd’hui, un groupe de 7 chercheurs indépendants issus d’universités et d’instituts de recherche européens et américains* montrent qu’il n’existe pas de controverse sur la définition des PE, que la méthode simple qui est utilisée pour l’identification et la réglementation des cancérigènes peut être employée pour les PE et qu’une étude d’impact n’est pas justifiée. L’article est publié ce lundi sous forme de commentaire dans la revue scientifique Environmental Health Perspectives.
En premier lieu, les auteurs démontrent le consensus autour de la définition que donne l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’un PE, à savoir « une substance ou un mélange exogène qui modifie la/les fonction(s) du système endocrinien [ou système hormonal] et qui, en conséquence, a des effets nocifs sur la santé d’un organisme intact ou de sa descendance, des populations ou des sous-groupes de population ».
Deuxièmement, les auteurs décrivent l’approche employée pour identifier d’autres dangers de niveau de préoccupation équivalente pour la santé, comme les substances cancérigènes ou les toxiques de la reproduction. Cette identification repose sur une catégorisation simple en 3 niveaux, qui ne fait pas référence au concept toxicologique de puissance[1]. Une approche similaire qui ne s’appuierait pas sur la puissance devrait être employée pour les perturbateurs endocriniens ; les 3 catégories proposées par la Commission européenne comme l’une des options envisagées sont les “perturbateurs endocriniens”, les “perturbateurs endocriniens suspectés” et les “substances endocrinologiquement actives” (cette dernière catégorie incluant les substances qui affectent le système endocrinien sans qu’il soit prouvé qu’elles ont un effet nocif sur la santé). Ces catégories sont jugées suffisantes par les chercheurs. Inclure la notion de puissance ou des considérations relatives à la dose-réponse modifierait l’esprit des lois sur les pesticides et les biocides (cf. encadré p.2).
Enfin, ils expliquent qu’effectuer une étude d’impact pour déterminer des critères scientifiques n’est pas défendable. Cela créerait un dangereux précédent, dans la mesure où les études d’impact ne sont pas destinées à définir les dangers, mais à quantifier les effets de ces dangers et de la réglementation sur la santé, la société et l’économie. Cette position est conforme à la décision de la Cour européenne de justice (2015), qui déclarait que « la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien ne peut se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique ».
Les auteurs reconnaissent qu’il reste une incertitude scientifique quant aux mécanismes fins et l’étendue exacte des effets des PE sur la santé et l’environnement. On ne connaît pas non plus le nombre exact de substances susceptibles d’être identifiées comme des PE. Ces incertitudes ne sont toutefois pas un blocage à l’établissement de critères scientifiques définissant les PE.
Plusieurs années ont donc été passées à essayer de formuler des critères scientifiques pour un danger qui a en fait été défini en 2002 par l’OMS. Pour cette raison, les chercheurs considèrent que l’absence de consensus scientifique a été créée de toutes pièces pour justifier le retard de la publication des critères scientifiques. Différer la publication des critères scientifiques peut être vu comme une manière de reporter l’entrée en vigueur de la loi de 2009 sur les pesticides et de la loi de 2012 sur les biocides. Les auteurs rappellent que les études d’impact ne peuvent pas servir d’argument pour reporter la publication d’une définition scientifique. Ils se disent préoccupés par le fait que des définitions scientifiques puissent être déformées pour modifier l’esprit d’une loi, mélangeant ainsi science et politique. Ce report est d’autant plus préoccupant que ces critères scientifiques ne sont que l’une des premières étapes de l’identification des PE pour apporter une protection plus efficace de la santé publique dans l’Union Européenne.
Informations générales
Les perturbateurs endocriniens (PE) sont très divers du point de vue de leur nature chimique, origine, et milieu où on les trouve. Parmi les PE suspectés on trouve des métaux (par exemple le mercure), des pesticides organochlorés comme le DDT ou le triclosan (utilisé dans les dentifrices ou les savons), d’autres pesticides, des contaminants alimentaires comme le bisphénol A, des phénols comme les parabènes (utilisés comme conservateurs dans les cosmétiques) ou les phtalates, que l’on peut trouver dans les parfums, les cosmétiques, le matériel médical, le PVC (polychlorure de vinyle), les vêtements de pluie… Des effets sur la santé tel que des malformations congénitales, des troubles du neurodéveloppement ou troubles du comportement, des cancers du sein, ont été rapportés pour certaines de ces substances dans des modèles animaux ou des études chez l’humain. On estime que les coûts qui résultent des effets sur la santé de l’exposition aux PE dans l’Union européenne sont de 100 à 200 milliards d’€ (Trasande L. et collègues, JCEM, 2015).
L’Europe est la seule grande économie au monde à avoir une législation ambitieuse sur les PE. En plus des des cancérigènes, des mutagènes ou des produits toxiques pour la reproduction, le Parlement européen a identifié les PE comme un nouveau type de danger pour la santé et l’environnement.
Depuis 1999, il existe dans l’UE une stratégie sur les perturbateurs endocriniens, et, en 2009 et 2012, le Parlement Européen a voté deux lois sur les pesticides et les biocides (la Réglementation sur les Produits phytopharmaceutiques [pesticides] en 2009 et la Réglementation sur les produits biocides en 2012). Ces lois stipulaient que pour les composés pour lesquels l’exposition de la population est non négligeable, les pesticides et les biocides contenant des perturbateurs endocriniens devaient être réglementés selon une approche basée sur les dangers (par opposition à une approche basée sur les risques). Cela implique qu’il n’est pas nécessaire de caractériser en détail la relation dose-réponse et de rechercher d’es éventuels seuils dans les effets du composé sur la santé. Cette approche permet de gérer plus rapidement les risques pour la santé, de moins recourir aux animaux de laboratoire, et d’éviter le débat sur la plausibilité de l’existence de seuils dans l’action de ces composés. C’est aussi l’approche prévue pour gérer les pesticides et les biocides contenant des substances cancérigènes, des mutagènes et des produits toxiques pour la reproduction.
L’application de la partie de ces lois qui se rapportait aux perturbateurs endocriniens exigeait que la Commission Européenne publie des critères d’identification des perturbateurs endocriniens au plus tard en 2013. Cela n’a pas été fait. Au lieu de cela, une feuille de route proposant 4 options pour identifier les PE a été publiée par la Commission européenne en 2014, et une étude d’impact destinée à aider à choisir entre ces 4 options a été annoncé. En décembre 2015, la Cour européenne de justice a décrété qu’une étude d’impact n’était pas justifiée, que la Commission avait manqué à ses obligations d’agir concernant la publication de critères définissant les PE. « L’évaluation réalisée par les chercheurs indique que “l’Option 3” de la feuille de route de la Commission européenne est scientifiquement pertinente et opérationnelle ».
Depuis 2013, les lois sur les pesticides et les biocides (pour ce qui concerne leurs effets en tant que PE) ne peuvent pas être appliquées à cause de la non publication de critères d’identification des perturbateurs endocriniens. En février 2016, la Commission européenne a indiqué que deux documents, dont un précisant les critères d’identification des PE, seraient publiés d’ici à l’été 2016.
Note : après la soumission de cette publication, un séminaire scientifique de consensus a rassemblé des chercheurs les 11 et 12 avril 2016 à Berlin autour de l’identification des PE. Ce séminaire était orienté sur des notions scientifiques plus fondamentales, et a permis d’arriver à la conclusion de la pertinence de la définition des PE donnée par l’OMS, et du manque de pertinence du concept de puissance pour identifier les PE. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site web de BfR.
* Les auteurs sont rattachés à l’Inserm, l’Université Grenoble Alpes, le CNRS, le Museum national d’histoire naturelle (France); au CHU de Liège (Belgique) ; à l’Université de Nottingham et l’Université Brunel à Londres (Royaume-Uni) ; à l’Université de Turin (Italie) et à l’Université du Massachusetts (USA)
[1] Selon l’International Union of
Pharmacology, la puissance (ou potency) est « une expression de l’activité d’un médicament [ou d’une substance toxique] correspondant à la concentration ou à la quantité nécessaire pour produire un effet déterminé ; c’est un terme imprécis qui devrait toujours être complété par l’ampleur de l’effet considéré» (Neubig, Pharmacological Reviews, 2003).
Les chercheurs soulignent le caractère trop vague de cette définition et préconisent d’employer la notion proche et plus adaptée de relation de dose-réponse.