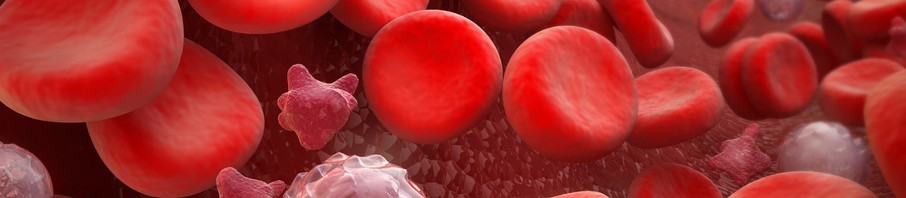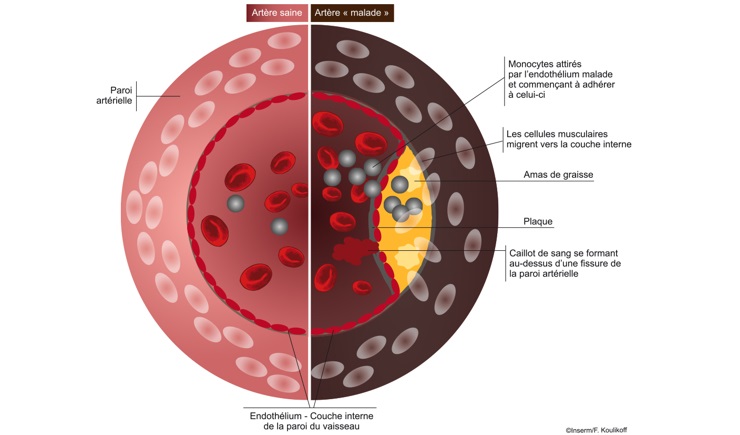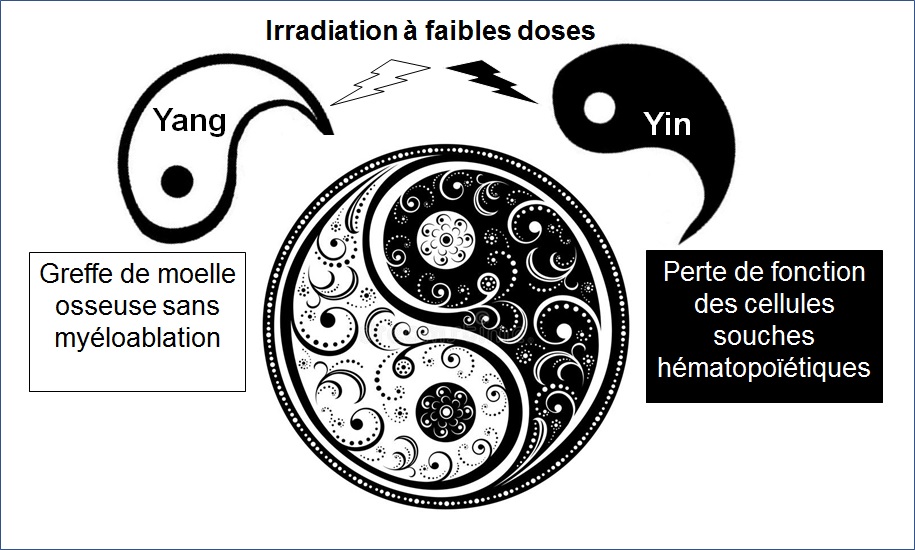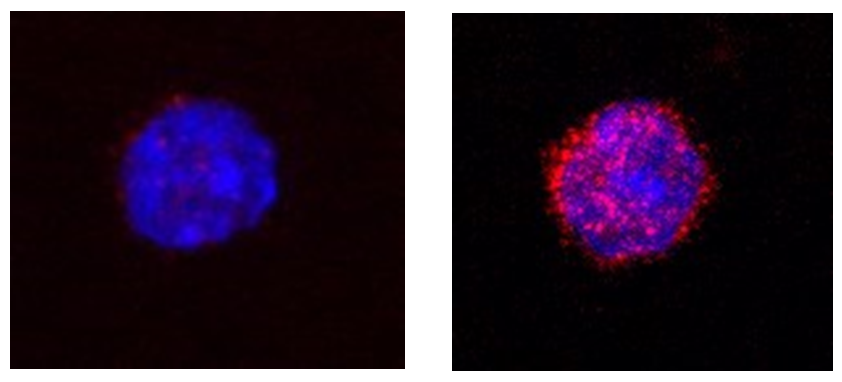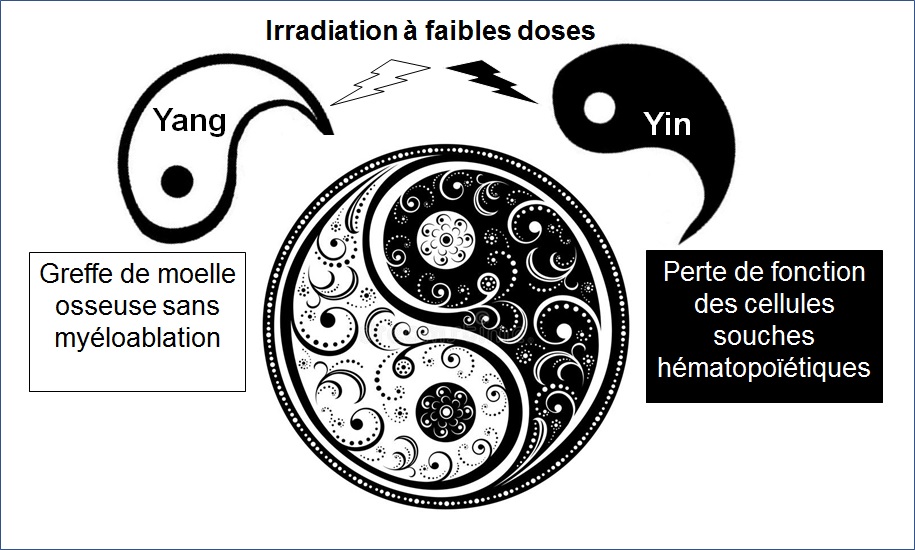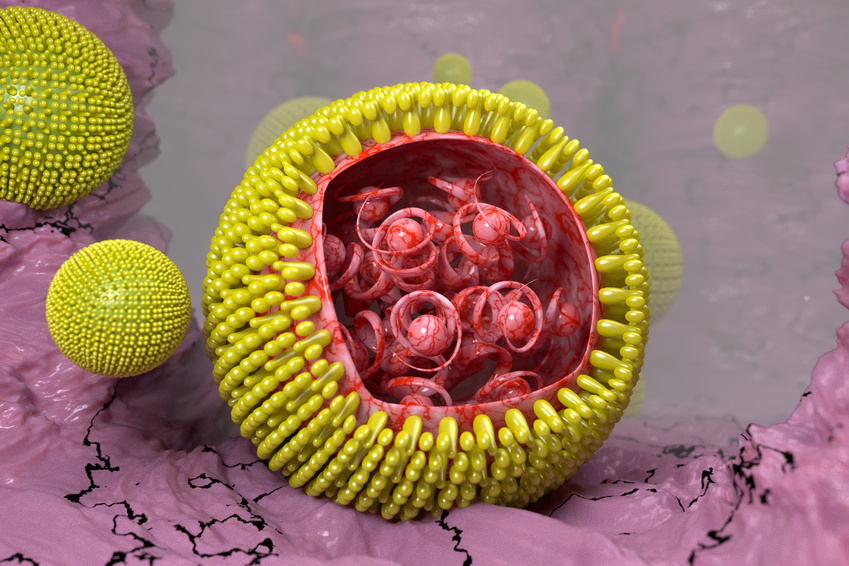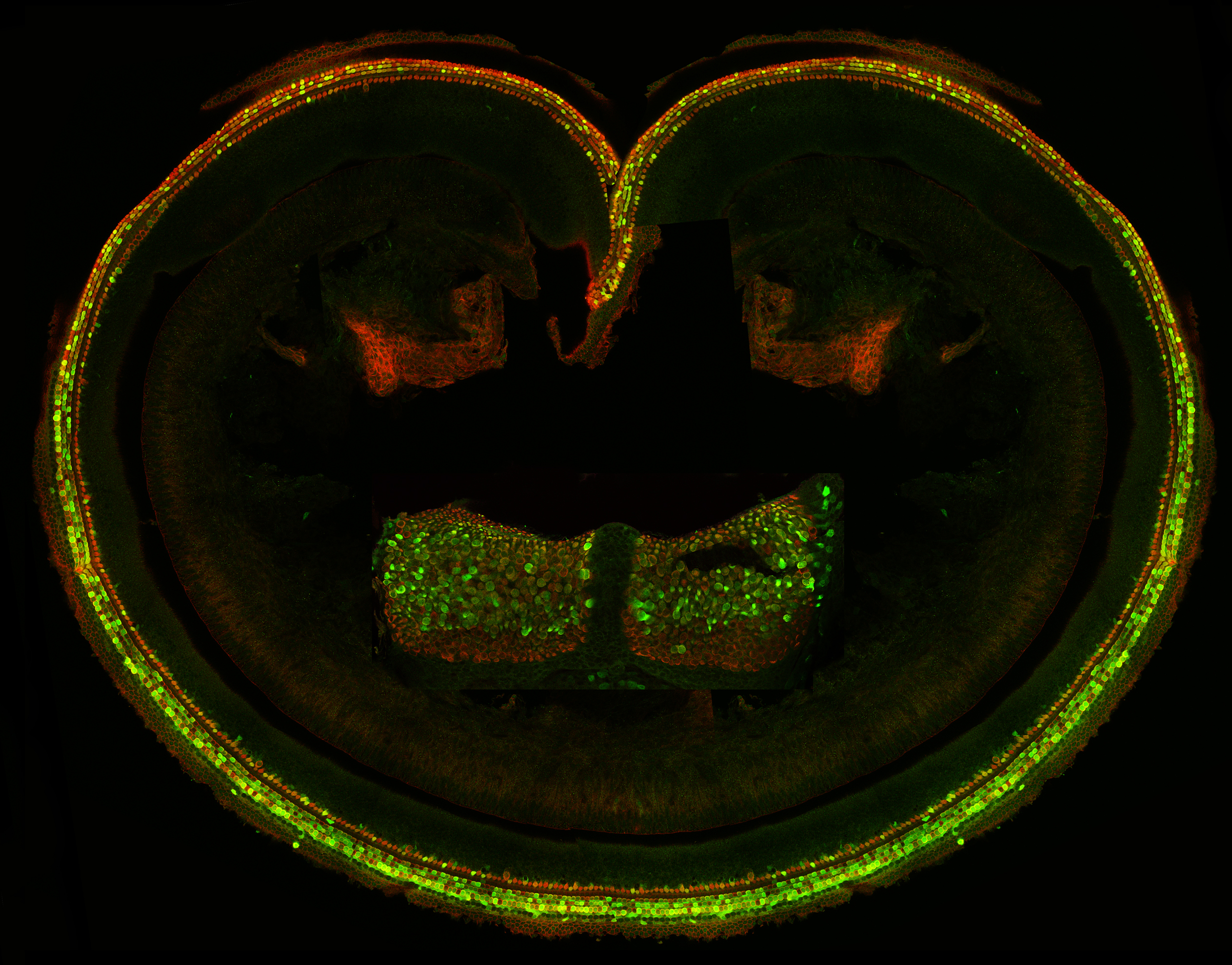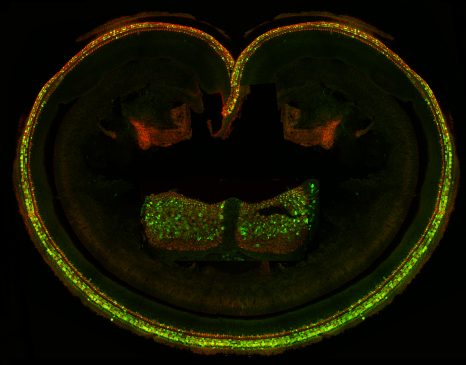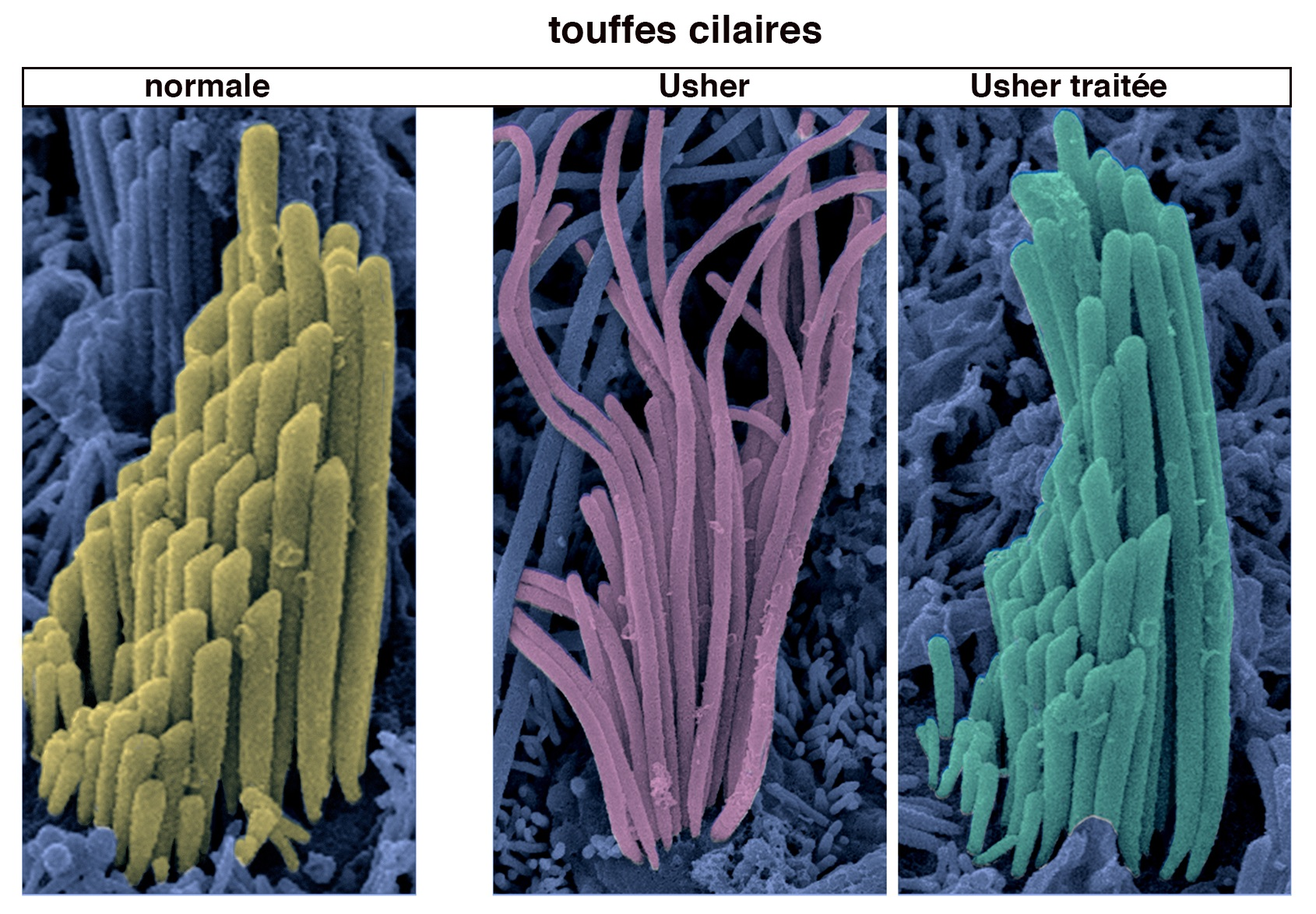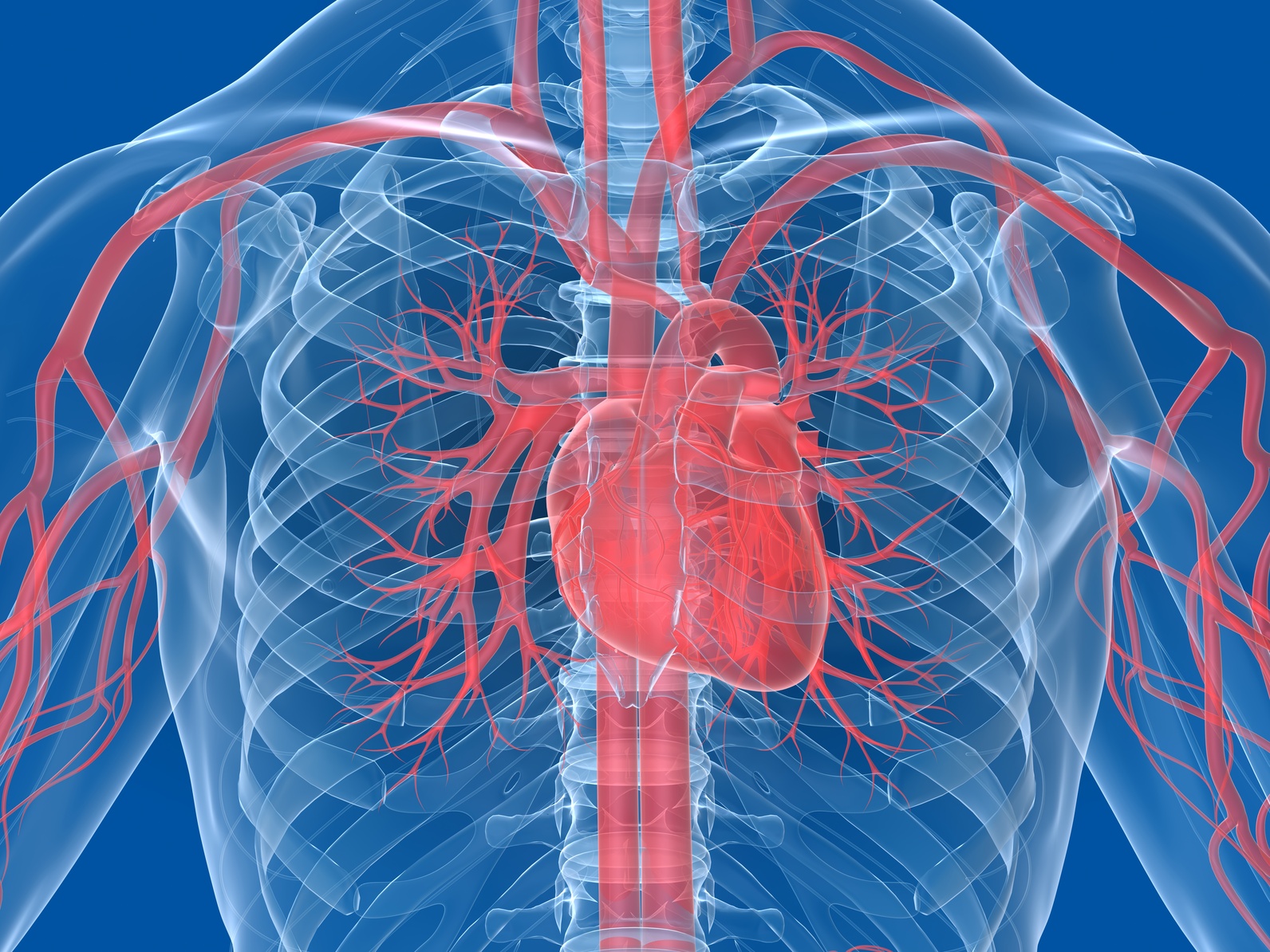© Fotolia
Une étude épidémiologique menée par l’Inserm[1] sur les familles de la cohorte EDEN (500 garçons nés entre 2003 et 2006 et leurs mères) montre que l’exposition pendant la grossesse à certains phénols et phtalates est associée à des troubles du comportement des garçons entre 3 et 5 ans. Les composés les plus préoccupants à cet égard sont le bisphénol A, le triclosan et le di-n-butyl phtalate, ou DBP. Les résultats viennent d’être publiés dans la revue Environmental Health Perspectives.
Le bisphénol A a été interdit de tous les contenants alimentaires en France en janvier 2015, une date ultérieure à la réalisation de cette étude. Le triclosan est un agent antibactérien retrouvé dans certains dentifrices et savons ; le DBP est utilisé comme plastifiant dans les plastiques de type PVC, certaines colles, vernis à ongles et laques pour les cheveux. Triclosan et DBP sont réglementés selon la logique d’une valeur limite dans certaines familles de produits, tout en étant interdits dans d’autres (le DBP est par exemple interdit d’usage dans les cosmétiques et le triclosan dans les habits dans l’UE). Des études toxicologiques in vitro et chez l’animal ont mis en évidence que ces composés étaient des perturbateurs endocriniens et pouvaient interagir avec des systèmes hormonaux impliqués dans le développement normal du système nerveux central. Les mécanismes précis qui pourraient expliquer un effet des perturbateurs endocriniens sur le neurodéveloppement et le comportement pourraient passer par une altération du fonctionnement des hormones thyroïdiennes, des hormones stéroïdiennes, comme l’œstrogène, ou d’autres hormones, comme l’ocytocine ou la vasopressine, des hormones sécrétées par l’hypothalamus.
Face à ces premières conclusions chez l’animal, les chercheurs ont souhaité étudier l’association entre les expositions aux perturbateurs endocriniens pendant la grossesse et le comportement ultérieur des enfants.
L’étude a porté sur 529 petits garçons de la cohorte mère-enfant EDEN, mise en place par l’Inserm. Les femmes enceintes participant à cette cohorte ont été recrutées entre 2003 et 2006 dans les CHU de Nancy et Poitiers. Aux troisième et cinquième anniversaires de l’enfant, ces mamans ont rempli un questionnaire standardisé évaluant certains aspects du comportement de leur enfant tel que l’hyperactivité, les troubles émotionnels et les troubles relationnels. Ce questionnaire standardisé, utilisé depuis une vingtaine d’années, intitulé « Questionnaire des forces et difficultés » de l’enfant, permet d’établir un score dans différentes dimensions du comportement tels que les symptômes émotionnels, les problèmes de relation avec les pairs, les problèmes de conduite, d’hyperactivité et d’inattention. Un échantillon d’urine prélevé durant la grossesse a permis le dosage de biomarqueurs caractéristique de l’exposition aux phénols et aux phtalates dans le Laboratoire de Santé Environnementale des CDC d’Atlanta, qui est en charge des campagnes de biosurveillance américaines.
De 70 à 100% des femmes de la cohorte Eden, recrutées durant leur grossesse entre 2003 et 2006, étaient alors exposées à des niveaux détectables de différentes substances. Les niveaux urinaires étaient de l’ordre de 1 à 3 µg par litre pour le bisphénol A, de 10 à 100 µg par litre pour le triclosan, et de 50 à 200 pour le méthylparabène. Les résultats suggèrent que l’exposition maternelle à certains phénols et phtalates est associée à des troubles du comportement des petits garçons.
L’exposition au bisphénol A était associé à une augmentation des troubles relationnels à 3 ans et des comportements de type hyperactif à 5 ans. Les chercheurs notent que ce travail confirme ainsi que les effets du bisphénol A sur le comportement observés chez l’animal de laboratoire se retrouvent chez l’humain à des expositions faibles, probablement inférieures à celles préconisées par l’autorité européenne de sécurité alimentaire, l’EFSA.
Le métabolite du DBP était lui associé à davantage de troubles émotionnels et relationnels, incluant les comportements de repli, à 3 ans, mais pas à 5 pour les troubles émotionnels. Des associations entre ces composés et le comportement avaient déjà été mis en évidence dans des études précédentes chez de jeunes garçons et chez l’animal. Ainsi, dans une étude réalisée à partir de femmes et d’enfants new-yorkais, une augmentation des comportements de repli chez les enfants de 3 ans avec des niveaux croissants du métabolite du DBP avaient été rapportés en 2012.
Les résultats de cette étude ont aussi montré une association entre le triclosan et une augmentation des troubles émotionnels à 3 et 5 ans. Il s’agit de la première étude évaluant les effets de ce composé sur le comportement, pour lequel l’équipe d’épidémiologie environnementale de Grenoble avait déjà mis en évidence une diminution du périmètre crânien à la naissance, dans cette même population. Au niveau moléculaire, le triclosan est capable d’interagir avec l’axe thyroïdien qui, pendant la grossesse, est impliqué dans le développement du cerveau du fœtus.
L’effectif de l’étude, qui est une des plus vaste sur la question, ne permettait pas d’étudier directement la survenue de pathologies du comportement comme les troubles du spectre autistique, ce qui impliquerait de suivre des dizaines de milliers d’enfants.
Les équipes de recherche vont désormais s’attacher à répliquer ces résultats au sein de la cohorte mère-enfant SEPAGES en cours dans la région Grenobloise, coordonnée par l’Inserm et soutenue par l’European Research Council. Dans cette dernière, de nombreux échantillons d’urine par participant sont recueillis durant la grossesse et les premières années de vie de l’enfant. Cette approche permettra de limiter les erreurs de mesure de l’exposition et d’identifier de potentielles périodes de sensibilité aux phénols et phtalates sur différents événements de santé tels que la croissance, le comportement ou la santé respiratoire. Cela permettra aussi d’étudier l’effet éventuel de ces substances chez les petites filles, qui n’avaient pu être considérées ici. Il est possible que leur sensibilité aux perturbateurs endocriniens diffère de celle des garçons.
[1] Un consortium de recherche associant des équipes de recherche Inserm, les CHU de Nancy et Poitiers, le Center for Disease Controls and Prevention (CDC, Atlanta, USA), et coordonné par l’équipe d’épidémiologie environnementale de l’Institut pour l’Avancée des Biosciences (Inserm/CNRS/Université Grenoble Alpes).