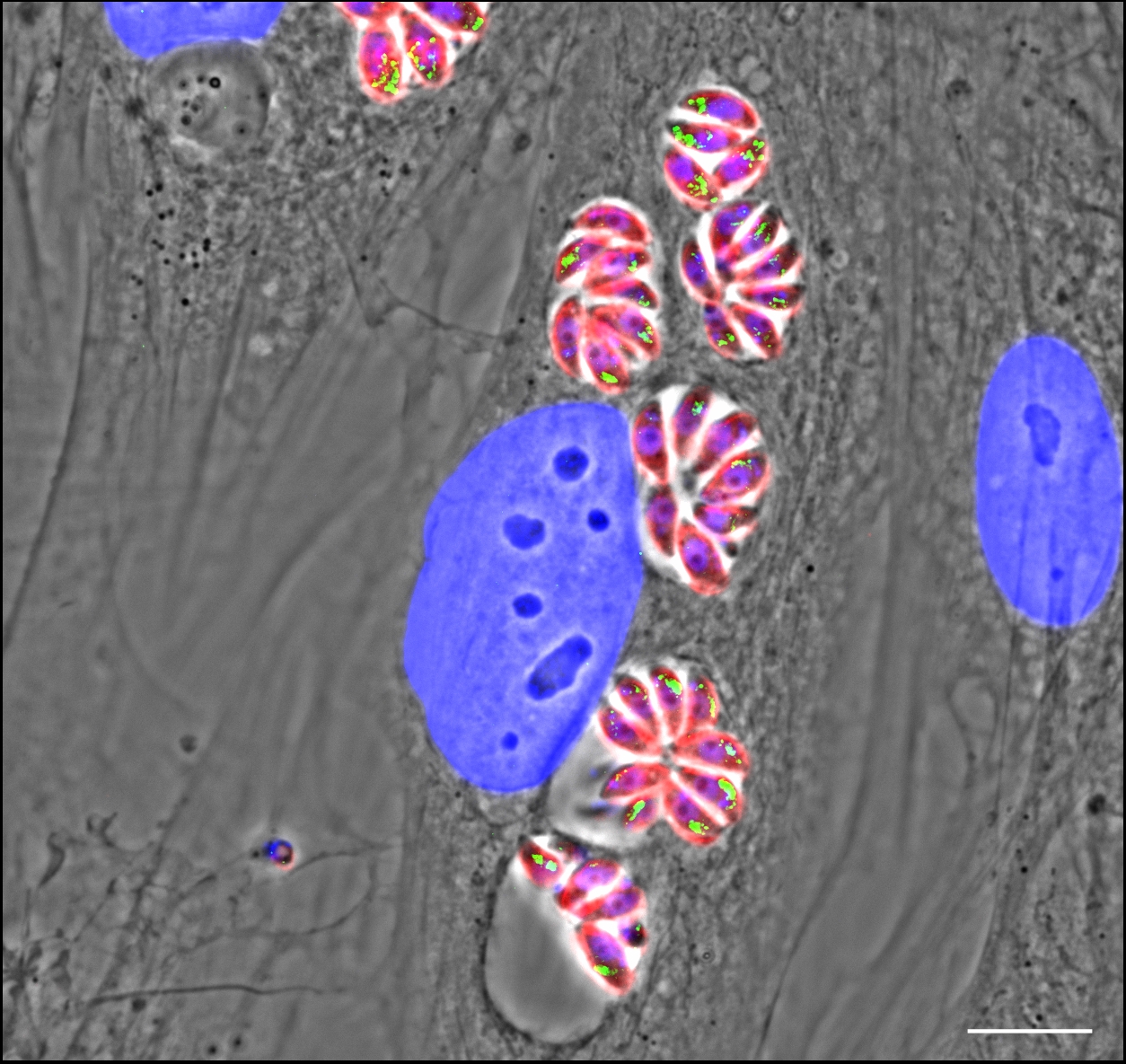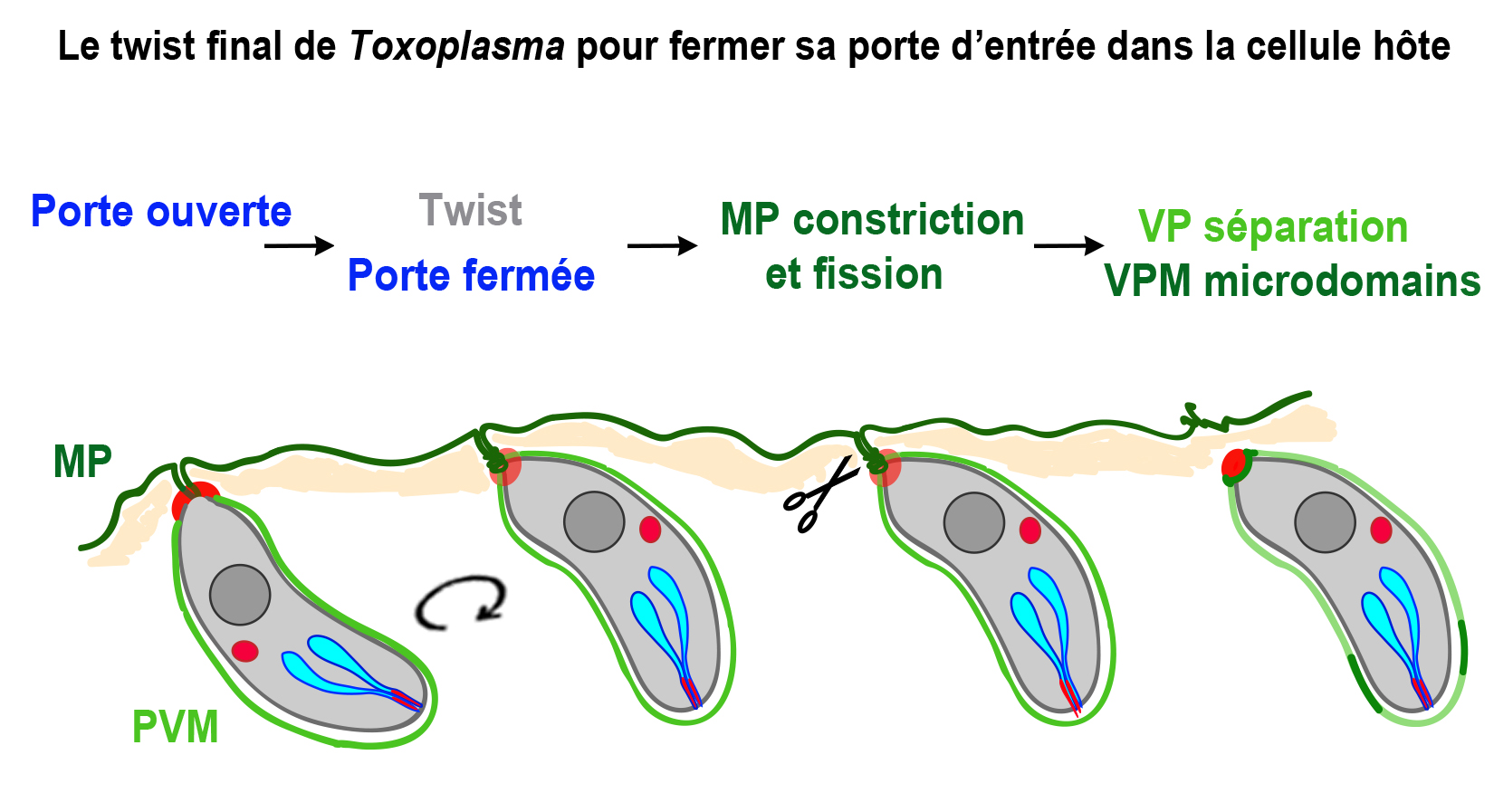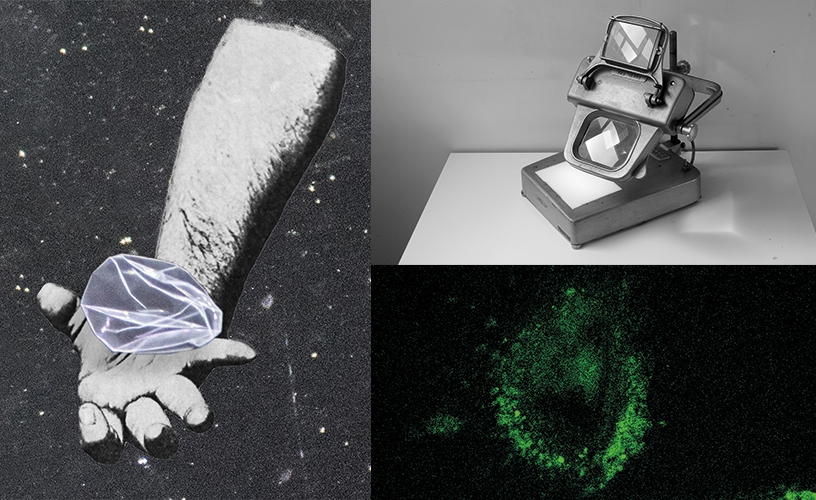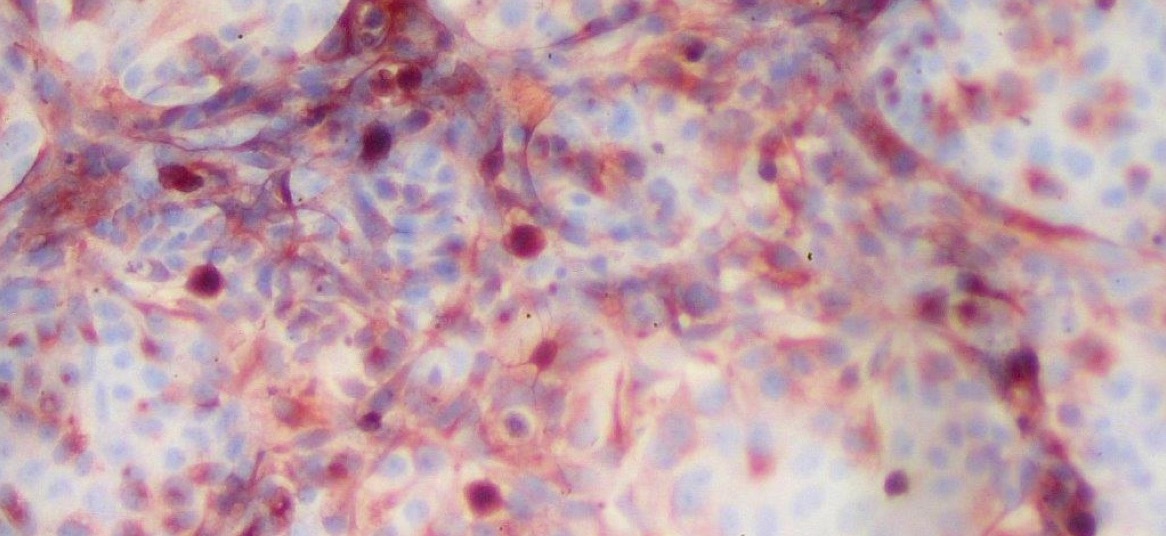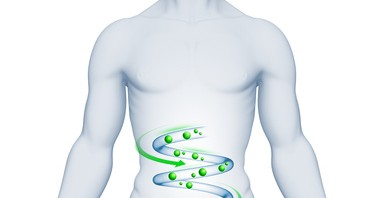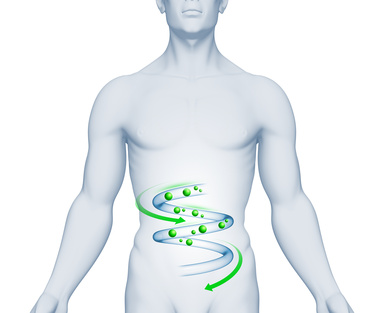Adobestock
Plus de 3 millions de personnes en France vivent aujourd’hui avec un cancer ou en ont guéri.
Si le nombre de nouveaux cas diagnostiqués chaque année augmente, les progrès réalisés dans le diagnostic et les traitements ont permis de faire reculer la mortalité par cancer. La maladie demeure une épreuve difficile pour les personnes touchées, tant au plan physique que psychologique. Elle est aussi synonyme de ruptures dans la vie sociale et professionnelle.Afin d’étudier l’impact dans le temps de la maladie sur le quotidien des personnes atteintes de cancer, l’Institut national du cancer a souhaité prolonger l’enquête sur la vie deux ans après un diagnostic de cancer (VICAN2) menée en 2012. Réalisée par l’Inserm[1], cette étude explore, cinq ans après un diagnostic de cancer, l’état de santé, les séquelles et le suivi, les difficultés rencontrées au quotidien mais aussi l’impact de la maladie et des traitements sur les ressources et l’emploi. Ses résultats seront discutés lors d’un colloque
le 20 juin à Paris.
L’Étude « La vie cinq ans après un diagnostic de cancer – VICAN5 »
Riches d’enseignements sur l’évolution des effets secondaires mais également sur la répercussion de la maladie sur la vie personnelle et professionnelle des personnes atteintes d’un cancer, les résultats permettent de guider l’action des pouvoirs publics et de l’ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre les cancers.
Aussi, certains de ces résultats confortent les actions mises en place par l’Institut national du cancer et les pouvoirs publics (le panier des soins de support, les actions en prévention tertiaire telles que le remboursement des patchs nicotiniques ou la prescription de l’activité physique, le droit à l’oubli ou encore le retour et le maintien dans l’emploi dans le cadre du club des entreprises). D’autres permettent d’envisager les actions à mener pour renforcer les dispositifs actuels ou d’en mettre en œuvre de nouveaux pour orienter au mieux l’accompagnement des personnes malades et de leurs proches. En effet, des disparités selon le pronostic, la localisation ou encore le statut des personnes malades permettent d’envisager des actions plus ciblées notamment pour les cancers dont les progrès des thérapeutiques restent faibles. Réaffirmée dans le Plan cancer 2014-2019, la continuité et la qualité de vie préservée malgré la maladie est une ambition partagée par l’ensemble des acteurs de la lutte contre le cancer.
Les principaux résultats de l’enquête VICAN5
Une persistance de l’impact du cancer sur la qualité de vie physique
Les personnes malades rapportent, à 44,4 %, une qualité de vie physique dégradée par rapport à la population générale. Ce pourcentage est similaire à celui observé lors de la première enquête.
Si le cancer du poumon a les conséquences les plus négatives en termes de qualité de vie physique, on observe une baisse de la dégradation par rapport à la situation antérieure. Il en est de même pour le cancer du sein. Pour les autres localisations, la situation reste stable.
L’amélioration observée pour le cancer du poumon reste cependant à nuancer ; en effet, il s’agit de la localisation dont le taux de décès est le plus élevé entre les deux enquêtes. Les résultats ne sont donc pas superposables.
La fatigue : symptôme le plus fréquemment spontanément rapporté mais qui s’améliore en fonction des localisations
Cinq ans après le diagnostic, 48,7 % des personnes décrivent la fatigue comme un symptôme cliniquement significatif. La prévalence est plus importante chez les femmes et varie en fonction des localisations.
Par ailleurs, les niveaux de fatigue demeurent significativement plus importants chez les femmes et les personnes jeunes. Enfin, les personnes en situation de précarité rapportent des niveaux de fatigue plus élevés soulignant ainsi le poids des inégalités quant à son vécu.Les résultats montrent une baisse significative de la prévalence de la fatigue pour le cancer du poumon et dans une moindre mesure pour le cancer de la thyroïde, localisations pour lesquelles la prévalence de la fatigue était la plus élevée à deux ans (de 70,9 % à 2 ans à 59,4 % à 5 ans et de 66 % à 2 ans à 55,8 % à 5 ans respectivement).Au-delà des différences hommes-femmes, les personnes les plus vulnérables par rapport à la fatigue sont les plus jeunes, et celles en situation de précarité financière. Ce dernier point souligne le poids toujours aussi important des inégalités sociales dans le vécu de l’après-cancer.
Une diminution des ressources liée en majorité à la diminution du temps de travail
Plus d’un quart des personnes diagnostiquées en 2010 ont connu une diminution de leurs revenus disponibles cinq ans après le diagnostic. Les personnes ayant connu une telle diminution présentent les profils les plus vulnérables sur le marché du travail (femmes, personnes avec niveau d’étude inférieur au baccalauréat, travailleurs indépendants), vivent fréquemment seules et déclarent vivre avec des séquelles liées à la maladie et/ou à son traitement.
La réduction du temps de travail est la principale cause d’une baisse des revenus professionnels.
Fortement associée à des caractéristiques de la maladie telles que le pronostic du cancer, le fait d’avoir été traité par chimiothérapie et éprouver de la fatigue en 2015, la réduction du nombre d’heures travaillées constitue le levier le plus fréquemment utilisé lors de la reprise de l’activité professionnelle afin de tenir compte de la capacité physique réduite, à cause notamment des séquelles de la maladie et des traitements.
L’enquête VICAN5 permet également de réaliser un suivi à deux puis cinq ans du diagnostic pour les personnes qui ont répondu aux deux questionnaires. L’analyse spécifique de ce groupe a montré que la baisse de revenus par personne intervient majoritairement à l’issue des deux premières années après le diagnostic ; pour 53,7 % cette diminution intervient au cours des trois années suivantes.
Une dégradation de la situation professionnelle au fil du temps
Cinq ans plus tard, un cancer a toujours un impact négatif sur la vie professionnelle des individus concernés, contrasté selon la réalité épidémiologique de la maladie et les caractéristiques professionnelles de l’emploi occupé initialement.
Aussi, la situation professionnelle des personnes ayant eu un cancer s’est détériorée, révélant globalement une accélération du phénomène de sortie d’emploi : baisse du taux d’emploi et hausse du chômage sont les premiers résultats de l’enquête VICAN5 concernant l’évolution de la situation professionnelle. Une hausse de la part d’inactifs en invalidité a également été constatée.
Parmi les personnes en emploi au moment du diagnostic du cancer, une sur cinq ne travaille pas cinq ans après.
En tenant compte du fait que les personnes en arrêt-maladie restent administrativement en situation d’emploi, ce résultat révèle une détérioration de la situation professionnelle plus importante que celle constatée lors de l’enquête VICAN2. Il semblerait ainsi que l’impact du cancer sur la vie professionnelle puisse survenir à moyen terme.
Comme dans la précédente enquête, les plus concernés par la perte d’emploi cinq ans après un diagnostic de cancer sont les travailleurs-exécutants, les salariés du secteur privé, les individus travaillant dans des TPE, les chefs d’entreprise et les personnes ayant connu un diagnostic de cancer du poumon, des vois aérodigestives supérieures ou un cancer colorectal.
Certains des résultats présentés ici doivent être interprétés avec précaution. La situation d’emploi présentée en fonction de différentes caractéristiques socioprofessionnelles permet de caractériser les groupes d’individus les plus concernés par une dégradation de la situation professionnelle cinq ans après un diagnostic de cancer, mais cela ne doit pas être interprété trop hâtivement en termes de causalité. Par exemple, si les individus touchés par un cancer du poumon sont plus affectés en termes de maintien en emploi, ceci peut provenir des caractéristiques de la maladie, mais également exprimer un argument d’épidémiologie sociale des cancers : les catégories socioprofessionnelles les plus concernées par ce type de maladie, comme les ouvriers, sont justement les plus vulnérables sur le marché du travail.
L’aménagement des conditions de travail jugées satisfaisantes
L’aménagement du temps de travail est la mesure la plus fréquente pour les personnes en emploi au moment du diagnostic ; 62,7 % d’entre elles ont connu un aménagement de leurs conditions de travail au cours des cinq années suivantes et s’en déclarent majoritairement satisfaites. Les personnes qui ont bénéficié des aménagements sont les femmes, les personnes initialement à temps plein, les salariés du secteur public et les personnes à contrat à durée indéterminée.
Les indépendants ont moins recours à ces aménagements.
La prévention tertiaire : suivi médical, habitudes de vie et de consommation
À cinq ans du diagnostic, 56,9 % des personnes ont un suivi spécifique en médecine générale de leur cancer. Toutefois, plus d’un tiers (33,1 %) déclare ne pas être suivie. Celles-ci se sentent d’ailleurs moins bien informées sur les symptômes auxquels elles sont susceptibles d’être confrontées.
Pendant et après un cancer, l’alimentation et l’activité physique jouent un rôle important dans plusieurs domaines tels que la prévention des risques de second cancer ainsi que l’amélioration du pronostic de la maladie et de la tolérance aux traitements. Pourtant, cinq ans après un diagnostic de cancer, 34,3 % des personnes déclarent ne pas avoir modifié leur pratique d’activité physique. De plus, 53 % des individus déclarent en faire moins ou avoir cessé complètement toute activité tandis que 12,7 % affirment en pratiquer davantage.
Les personnes rapportant une augmentation de leur activité physique sont plus jeunes et plus souvent des femmes tandis que celles ayant connu une diminution de leur activité physique conservent des séquelles, souffrent de troubles anxieux ou dépressifs, sont plus souvent des hommes et sont plus âgés. Trois individus sur cinq ayant réduit leur activité physique présentent un état de fatigue avéré.
Comme en population générale, parmi les personnes diagnostiquées d’un cancer il y a cinq ans, la prévalence tabagique décroît avec l’âge et concerne plus particulièrement les individus ayant un faible statut économique. Aussi, 39,8 % des personnes qui fumaient avant le diagnostic ont arrêté cinq ans après et 16,7 % fument du tabac le plus souvent quotidiennement. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est observé en population générale, les femmes fument plus que les hommes.
[1] Équipe de recherche UMR 1252-SESSTIM de l’Inserm.
Méthode
L’enquête VICAN5 prolonge VICAN2, en interrogeant des personnes bénéficiaires de l’assurance maladie, résidant en France métropolitaine, pour lesquelles un diagnostic de cancer a été posé environ cinq ans avant le déroulement de l’enquête, et qui étaient âgées de 18 à 82 ans au moment du diagnostic. Douze localisations cancéreuses, dont les plus fréquentes, ont été privilégiées. Parallèlement à l’enquête téléphonique, des données issues du dossier médical et des informations sur la consommation de soins[1] ont été recueillies.
Au total, 4 174 personnes ont été interrogées, parmi lesquelles 2 009 individus ayant déjà participé à l’enquête VICAN2 auxquels s’ajoute un échantillon complémentaire de 2 165 personnes.
[1] Données extraites du Système national d’information inter-régime de l’assurance maladie (SNIIRAM).
Télécharger la synthèse de l’étude « La vie cinq ans après un diagnostic de cancer »
Télécharger le rapport complet de l’étude « La vie cinq ans après un diagnostic de cancer »