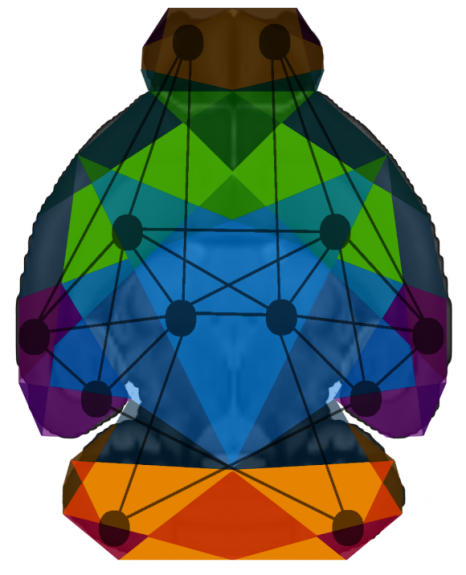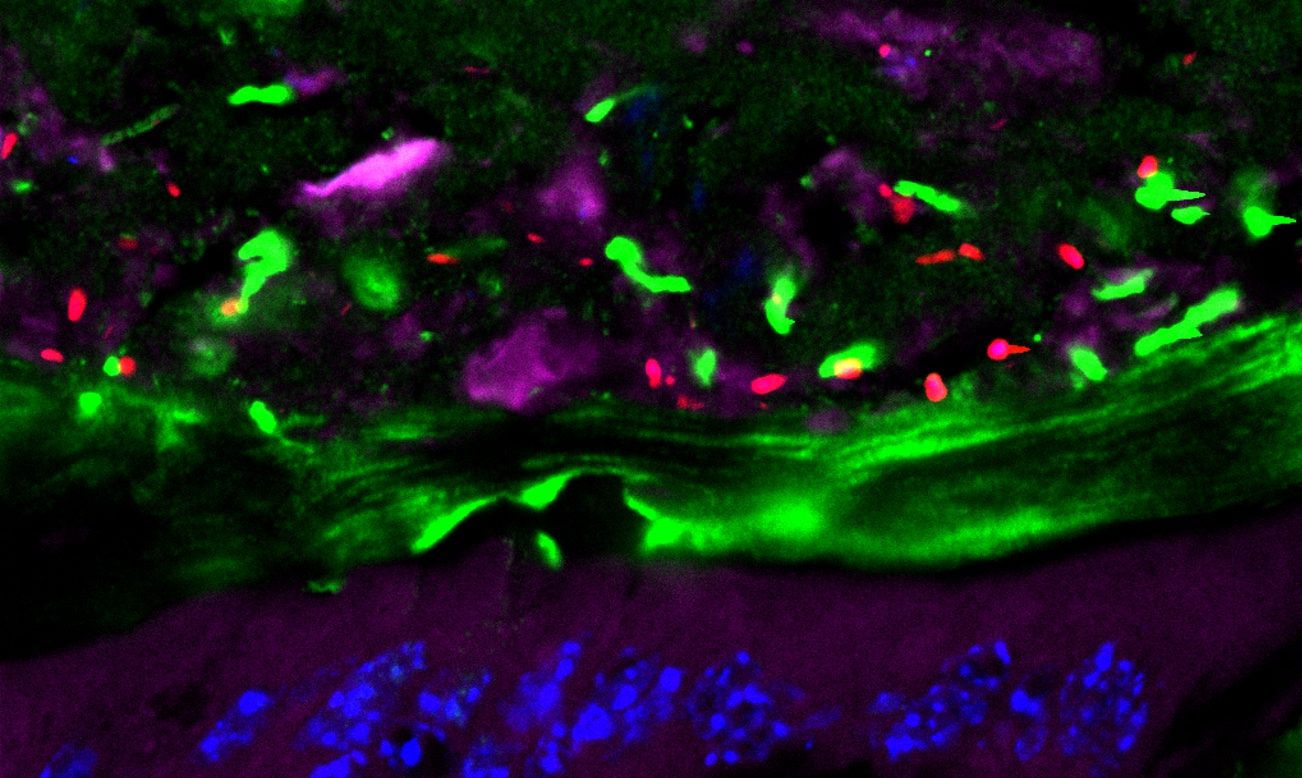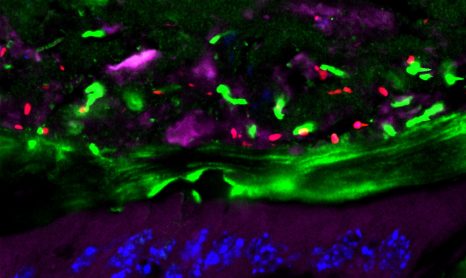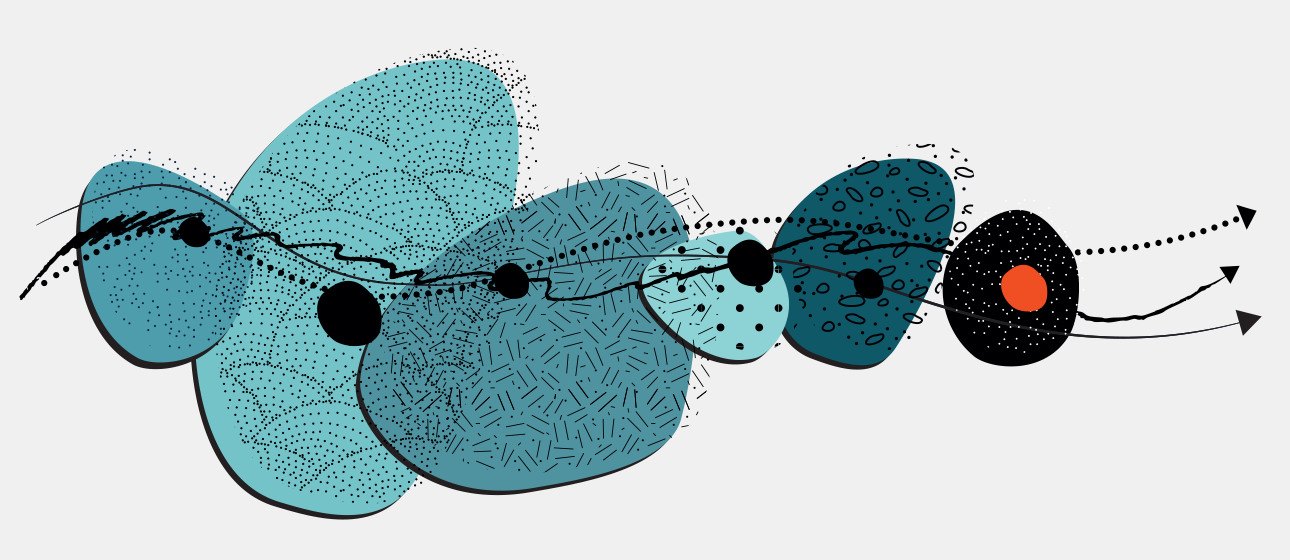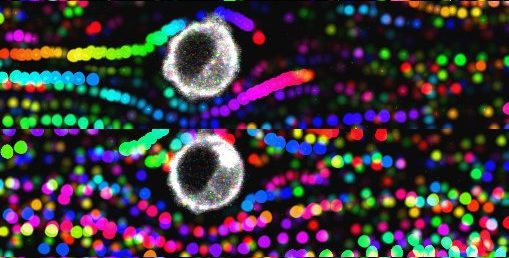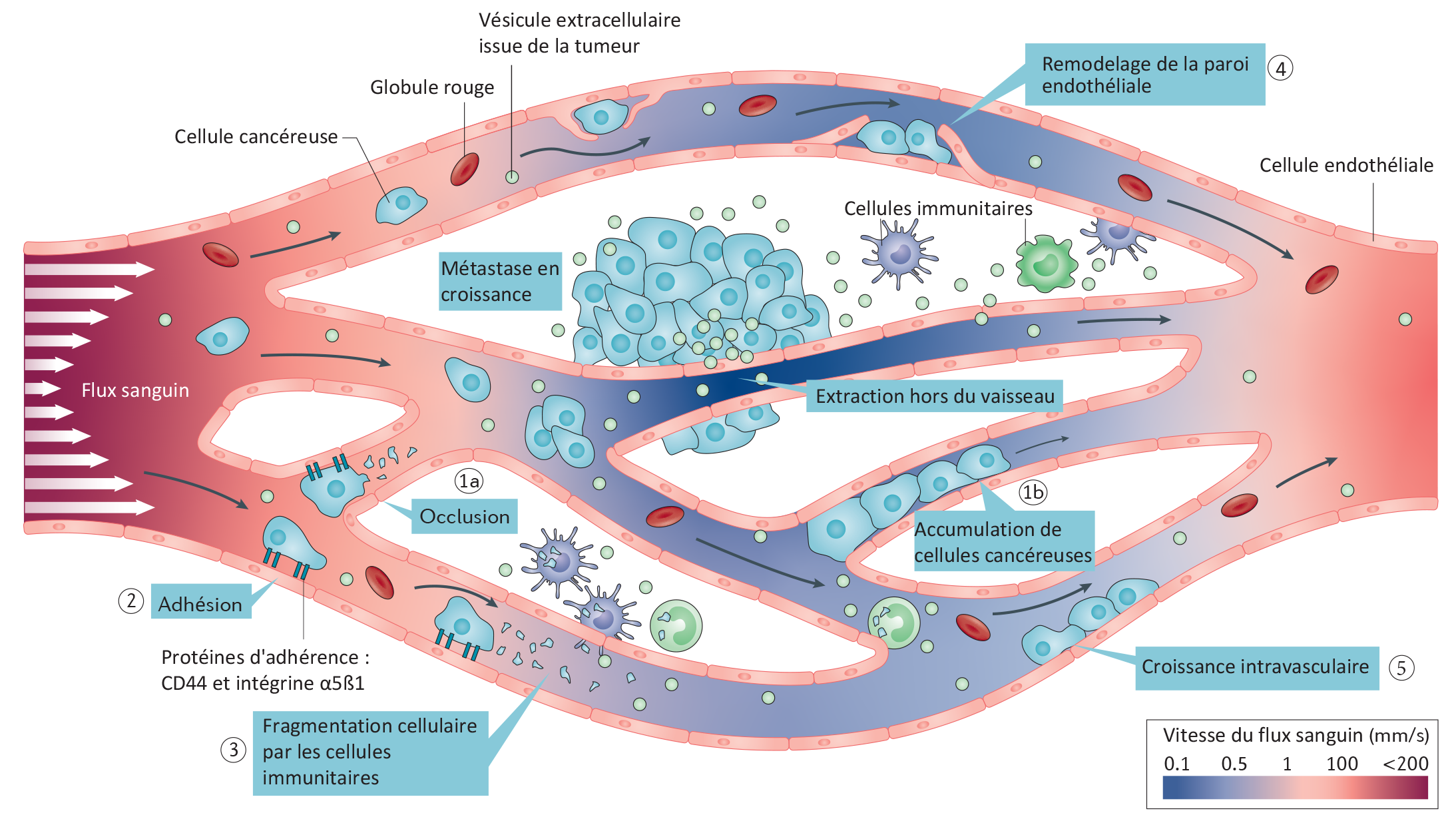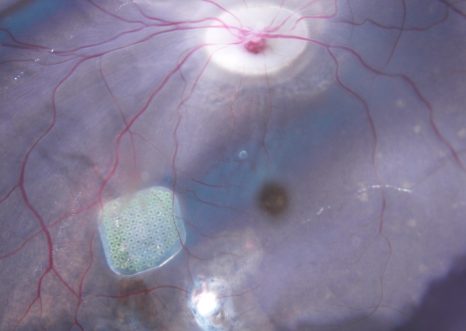Publiée dans le Journal of Clinical Oncology, une nouvelle analyse de la cohorte CANTO (CANcer TOxicities) identifie les déterminants de la reprise de l’activité professionnelle après un cancer du sein. Le premier constat est que 21 % des femmes, soit une femme sur cinq, n’a pas repris une activité professionnelle alors que les traitements sont achevés depuis un an. Les déterminants d’une reprise d’emploi après la maladie sont multiples mais les chercheurs ont identifié trois principaux paramètres qui pèsent davantage : les symptômes dépressifs, un travail manuel et le type de traitement (chimiothérapie et trastuzumab). Les résultats mettent également en avant, pour la première fois, le rôle des toxicités sévères liées aux traitements.
De plus en plus de femmes atteintes d’un cancer du sein sont traitées avec succès même si 25 à 50 % d’entre-elles conservent des séquelles physiques et psychologiques liées à la maladie et ses traitements1. « En se chronicisant, cette pathologie qui touche des femmes souvent encore en activité a rendu centrale la question du retour au travail qui est devenu un véritable enjeu sociétal, le non-retour au travail ayant un coût associé pour la collectivité aussi important que celui des traitements2 » précise Agnès Dumas, sociologue à l’INSERM et chercheuse associée à Gustave Roussy.
La reprise d’une activité professionnelle après les traitements est une question complexe, de nombreux paramètres agissant sur la capacité à travailler. L’objet de cette analyse est d’identifier quels facteurs cliniques, psychologiques et sociaux déterminent le retour au travail et de comprendre leur poids relatif.
Pour cela, l’analyse s’est basée sur une extraction de près de 1 900 femmes inclues dans la cohorte CANTO âgées de moins de 57 ans, en emploi au moment du diagnostic et dont la maladie n’avait pas rechuté. Un des points forts de CANTO est que toutes les femmes inclues dans cette cohorte répondent à plusieurs questionnaires répétés dans le temps, au diagnostic, à la fin des traitements et un an après, permettant d’éviter les biais de mémoire d’un questionnaire rétrospectif. C’est la première analyse prospective de cette ampleur sur les causes du non-retour au travail après un cancer du sein.
De manière globale, les chercheurs ont constaté que 21 % de femmes ne reprenaient pas le travail ; parmi ces femmes, 74 % étaient en arrêt maladie, 9 % à la recherche d’un emploi et 17 % étaient dans une autre situation.
Le retour au travail dépend d’un ensemble de facteurs et c’est pourquoi les chercheurs ont pris en considération de multiples paramètres pour comprendre les déterminants du non-retour : le stade de la maladie, l’état de santé général des femmes au moment du diagnostic de la maladie incluant la présence d’autres pathologies comme les troubles musculo-squelettiques, les toxicités et effets secondaires des traitements, la qualité de vie et notamment différents types de fatigue, selon qu’elle est physique, émotionnelle ou cognitive, l’anxiété, la dépression ainsi que des caractéristiques sociodémographiques (âge, vie en couple…) et socioprofessionnelles (catégorie professionnelle, temps de travail).

En prenant en compte tous ces facteurs, les chercheurs ont mis en évidence trois principales causes du non-retour un an après l’arrêt des traitements :
- Les symptômes psychologiques sont le premier paramètre à peser. Les femmes rapportant des symptômes dépressifs à la fin des traitements sont moins enclines à reprendre le travail.
- Vient ensuite le type de travail. Les femmes avec un travail manuel ont un risque de non-reprise très important. A cela s’ajoute la question du temps de travail, les femmes travaillant à temps partiel reprenant moins le travail que celles travaillant à temps plein au moment du diagnostic.
- Enfin, le type de traitement a également un rôle important. Ainsi, les femmes ayant été traitées par chimiothérapie (sans distinction du type) associée à du trastuzumab avaient significativement moins repris une activité professionnelle un an après la fin des traitements.
« Toutes choses égales par ailleurs, par exemple le même type de chirurgie ou la prise en compte des symptômes dépressifs, le fait d’avoir du trastuzumab augmente clairement le risque de ne pas retourner au travail. Nous n’avons pas encore trouvé d’explication satisfaisante à son rôle : ce médicament n’ayant pas une toxicité considérée comme sévère (grade 3 ou 4), il ne devrait pas avoir un tel impact sur l’emploi. Est-ce sa toxicité à long terme, même si elle est faible, la cause ? Est-ce la formulation par voie intraveineuse et son administration à l’hôpital sur une longue durée qui joue ? Nous sommes en train d’affiner les paramètres pour mieux comprendre » conclut Ines Vaz-Luis, oncologue à Gustave Roussy et co-auteur de l’article.
En plus de ces trois principaux facteurs, l’étude CANTO montre pour la première fois le rôle des toxicités sévères liées aux traitements (dites de grade 3 ou supérieur, concernant les domaines cardiovasculaire, gynécologique, gastro-intestinal, rhumatologique, dermatologique, pulmonaire ou neurologique) à côté de facteurs déjà démontrés dans la littérature pour leur rôle négatif sur l’emploi tels que les douleurs au bras suite à la chirurgie.
Promue par Unicancer et dirigée par le Pr Fabrice André, oncologue spécialisé dans le cancer du sein à Gustave Roussy, directeur de recherche Inserm et responsable du laboratoire « Identification de nouvelles cibles thérapeutiques en cancérologie » (Inserm/Université Paris-Sud/Gustave Roussy), la cohorte prospective CANTO pour CANcer TOxicities est composée de 12 000 femmes atteintes d’un cancer du sein localisé prises en charge dans 26 centres français. Elle a pour objectif de décrire les toxicités associées aux traitements, d’identifier les populations susceptibles de les développer et d’adapter les traitements en conséquence pour garantir une meilleure qualité de vie dans l’après-cancer.