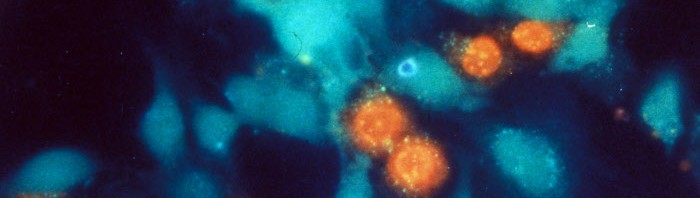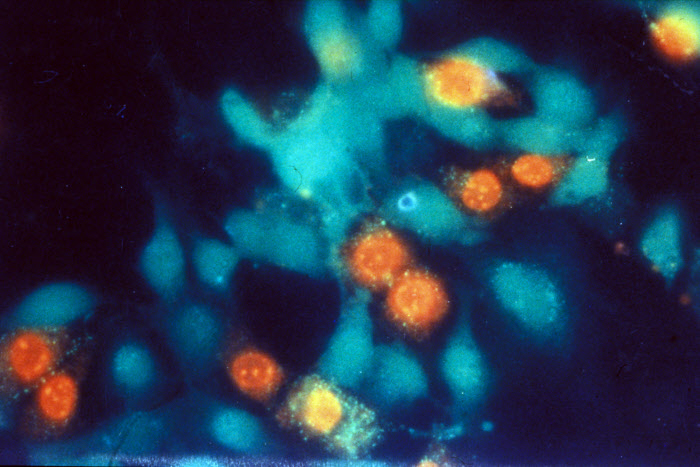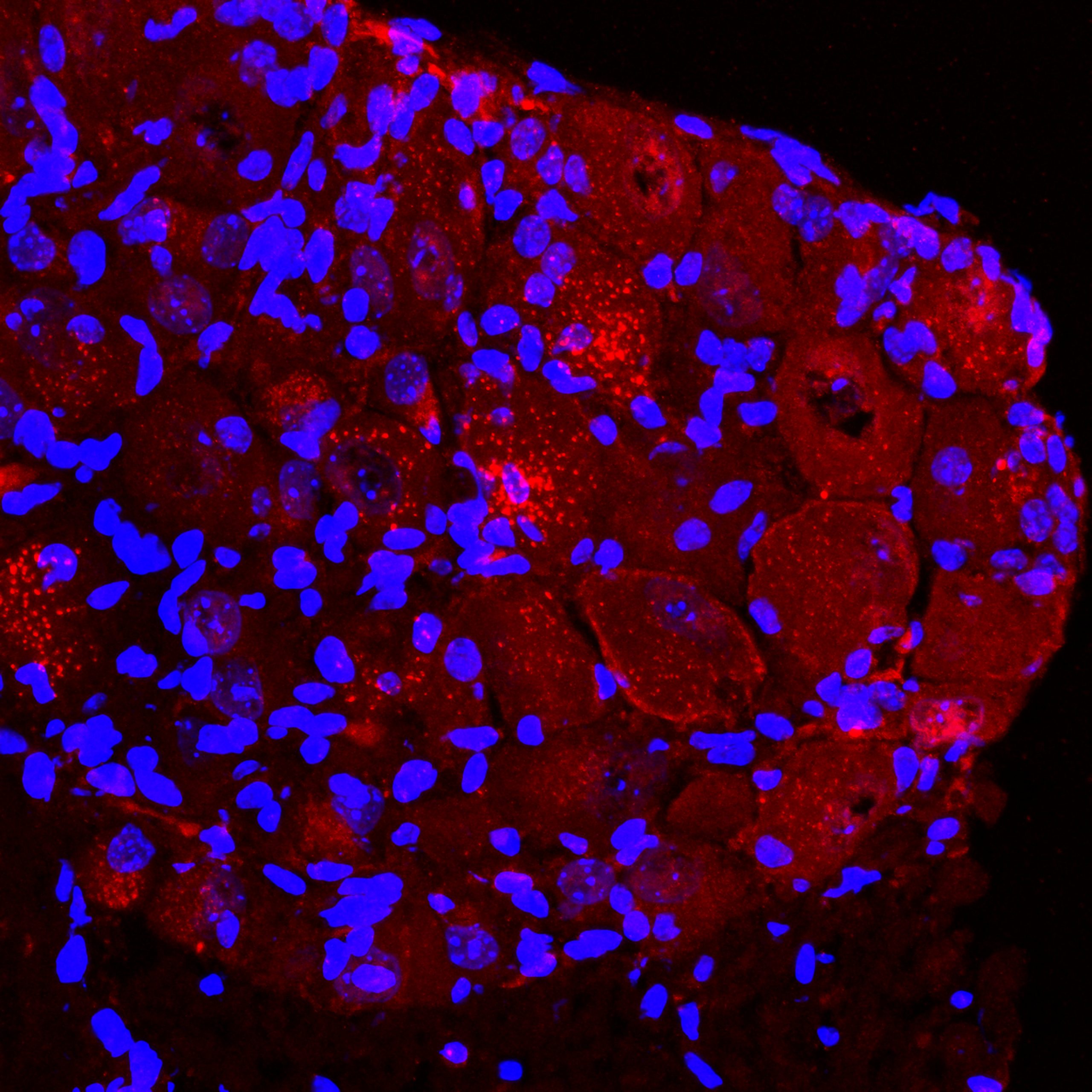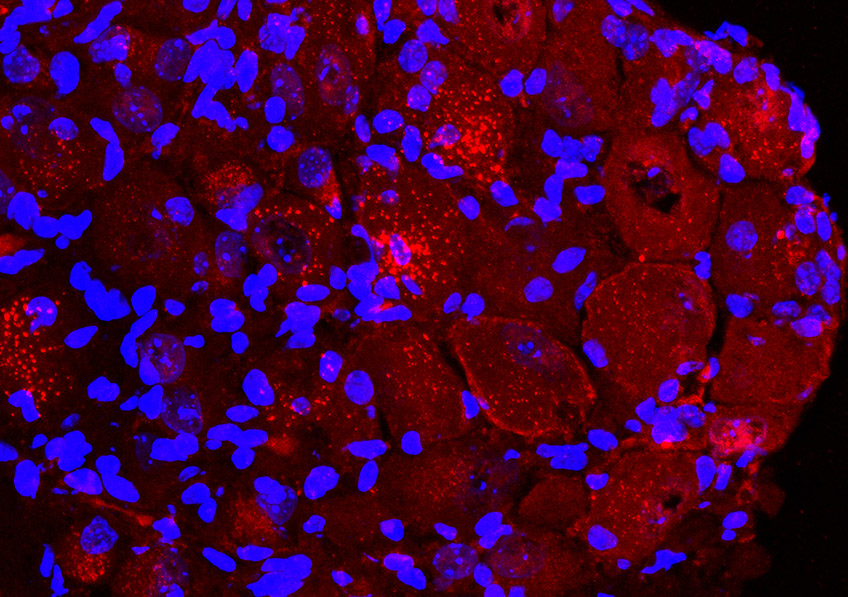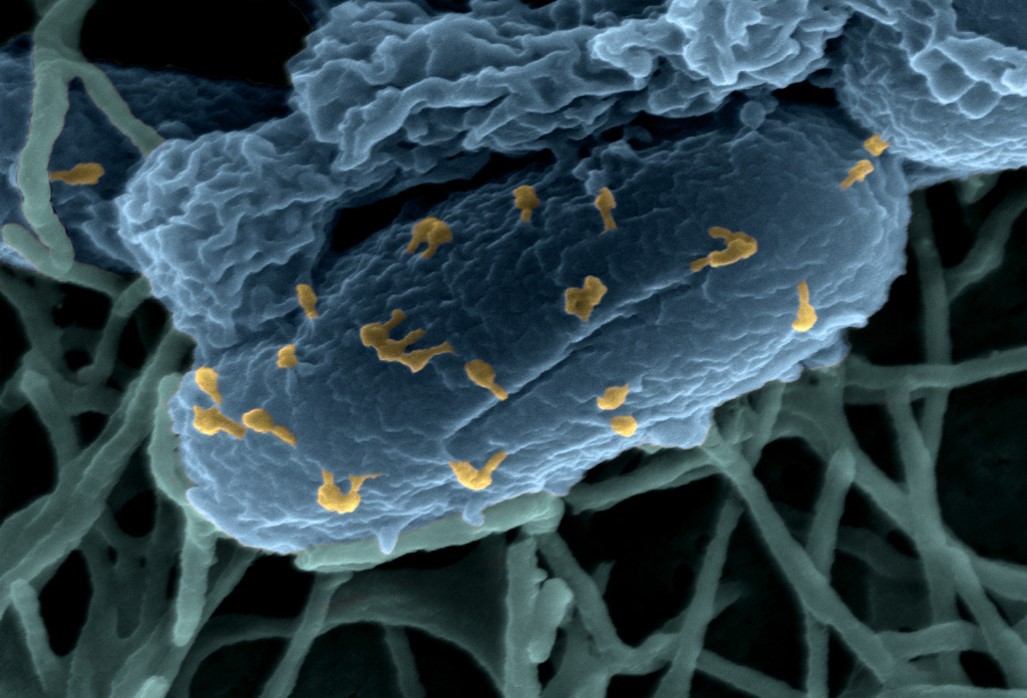En France, la stratégie de prévention de la carence en fer chez les jeunes enfants est en partie fondée sur la recommandation d’utiliser des laits infantiles enrichis en fer, dont le lait de croissance, lors de l’arrêt de l’allaitement. Mais quel est l’apport réel de ces laits dans la prévention de la carence en fer ? Une équipe de recherche de l’Inserm, de l’AP-HP et d’Université de Paris, au sein du Centre de recherche en épidémiologie et statistiques (Cress) a étudié l’apport en fer de l’alimentation et la survenue de carence chez 561 nourrissons de 2 ans en France de 2016 à 2017. Les chercheurs ont observé que la consommation de laits infantiles enrichis en fer réduisait très significativement le risque de carence en fer et permettait d’atteindre les besoins nutritionnels quotidiens recommandés pour près de la moitié des enfants. Ces résultats, publiés dans Clinical Nutrition, appuient la stratégie de prévention française et invitent à accorder une attention particulière aux familles défavorisées, dont les enfants sont les plus touchés par la carence en fer.
La carence en fer est considérée comme la carence en micronutriment la plus fréquente à travers le monde, et en particulier dans les pays industrialisés. Lorsqu’elle survient chez les nouveau-nés et les jeunes enfants, elle est fortement suspectée d’être associée à des effets neurocognitifs néfastes à court et long terme, comme une diminution des capacités d’apprentissage et de mémoire, ou une atteinte neurosensorielle visuelle ou auditive.
Pour les nourrissons de plus de 1 an, les besoins nutritionnels moyens quotidiens en fer recommandés sont de 5 mg[1]. Lorsque le taux sanguin de ferritine (protéine fixant le fer, correspondant aux réserves en fer de l’organisme) est inférieur à 12 µg/L, on considère qu’un jeune enfant est carencé.
En France, la stratégie de prévention de la carence en fer repose en partie sur la recommandation de consommation systématique et prolongée de laits infantiles enrichis en fer – notamment le lait dit « de croissance » de 1 à 3 ans – lors de l’arrêt de l’allaitement, afin de compléter les apports de l’alimentation qui sont rarement suffisants pour cette tranche d’âge.
Afin d’examiner la pertinence de cette stratégie de prévention, les travaux d’une équipe de recherche de l’Inserm, de l’AP-HP et d’Université de Paris, au sein du Centre de recherche en épidémiologie et statistiques – Cress (Inserm/Université de Paris/Université Sorbonne Paris Nord/INRAE), coordonnés par Anne-Sylvia Sacri et Martin Chalumeau ont comparé l’apport en fer de l’alimentation, avec et sans consommation de lait de croissance, et la survenue de carence, chez 561 nourrissons âgés de 2 ans et ne présentant pas de pathologie affectant le métabolisme du fer. Cette étude a mis à contribution, entre 2016 et 2017, près de 120 cabinets pédiatriques répartis dans toute la France, grâce aux réseaux Activ et Afpa.
Pour chaque enfant, un questionnaire renseignant tous les aliments ingérés sur 3 périodes de 24h non consécutives a été rempli par les parents et a permis aux chercheurs de déterminer la quantité de fer ingérée au quotidien. Les analyses ont montré que lorsque la consommation de lait de croissance (utilisés par 73 % de l’effectif) n’était pas prise en compte, les apports en fer issus de l’alimentation ne permettaient pas d’atteindre les besoins recommandés de 5 mg/jour pour 63 % des enfants contre 18 % lorsqu’elle était prise en compte.
La consommation de lait de croissance a donc permis à 45 % des enfants d’atteindre les besoins nutritionnels recommandés en fer.
Dans un second temps, la concentration sanguine de ferritine a été mesurée à partir d’un prélèvement sanguin. Chez les 561 enfants étudiés, 37 (7 %) présentaient une carence en fer. La concentration sanguine en ferritine était significativement plus élevée chez les enfants consommant du lait de croissance à 24 mois ou depuis l’âge de 10 mois. Elle était significativement inférieure chez ceux consommant du lait de vache à 24 mois ou ayant débuté leur consommation avant cet âge.
La survenue de carence en fer était d’autant plus diminuée que la consommation de lait de croissance était prolongée et ce, même en faible quantité (à partir de 200 mL/jour).
« Cela suggère que la consommation régulière de fer est un meilleur moyen de prévenir les carences en fer qu’une importante supplémentation sur une courte période », précise Anne-Sylvia Sacri.
Elle ajoute : « Ces résultats plaident en faveur des stratégies nationales de prévention de la carence en fer fondées sur la recommandation de consommation de lait infantile enrichi en fer après l’âge de 12 mois. Ces laits apparaissent comme une solution simple pour supplémenter en fer les jeunes enfants, afin d’atteindre les besoins nutritionnels quotidiens recommandés. »Les chercheurs ont également observé qu’une carence en fer était associée à des antécédents de prématurité. Elle était également plus fréquente dans les familles nombreuses et dans celles présentant des marqueurs de situation sociale défavorisée.
« Une attention particulière doit être apportée à ces populations plus vulnérables. Elles doivent être ciblées plus spécifiquement par les politiques de prévention et de surveillance », conclut Martin Chalumeau.
[1] Selon les recommandations de la European Food Safety Authority (EFSA)