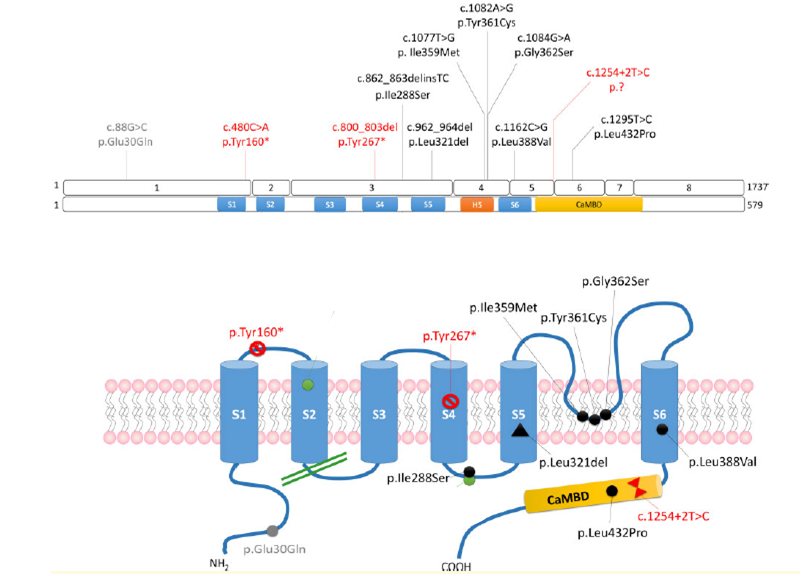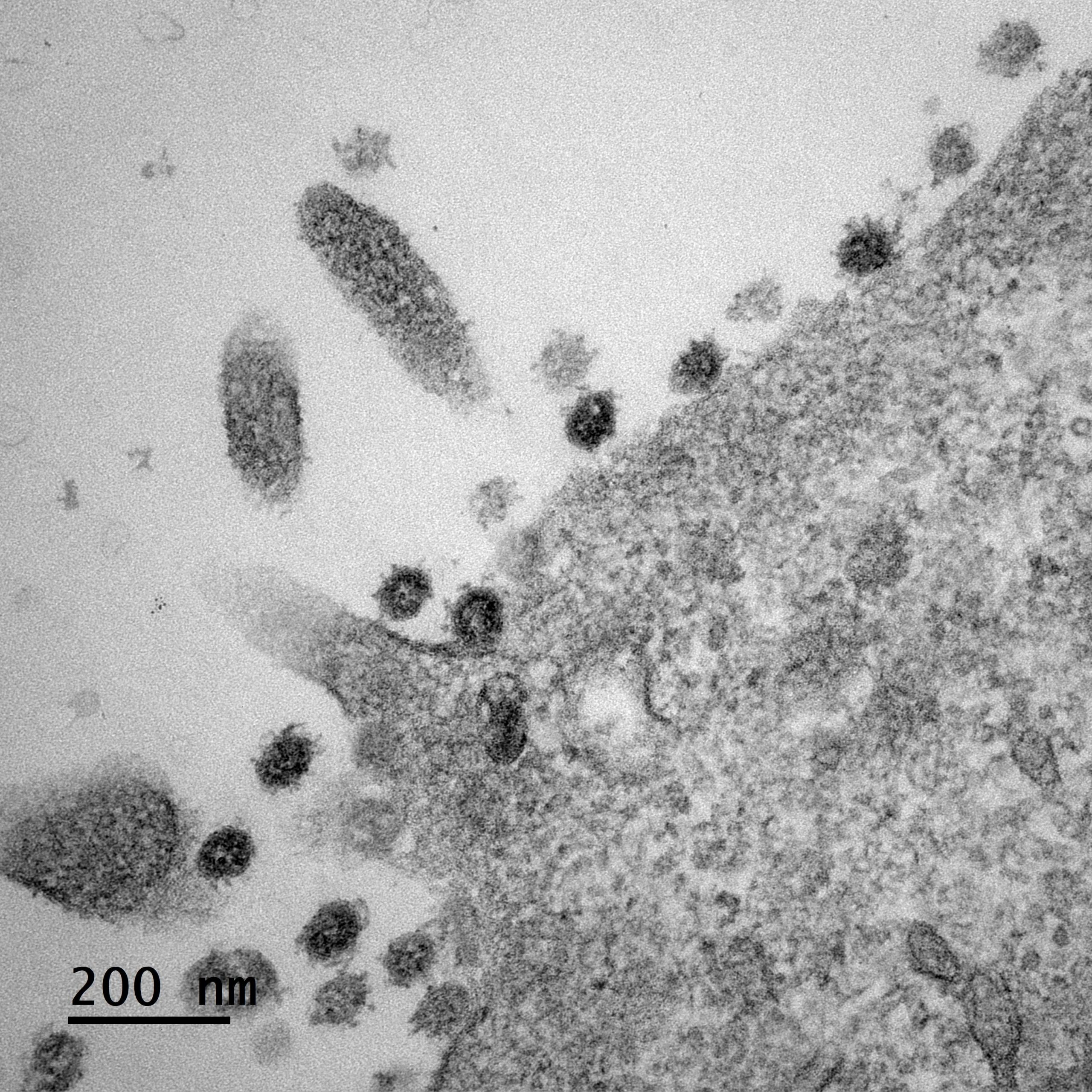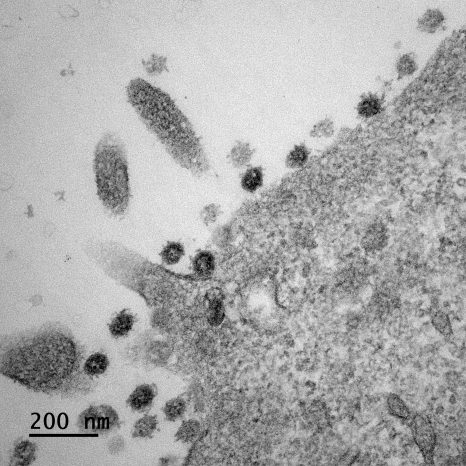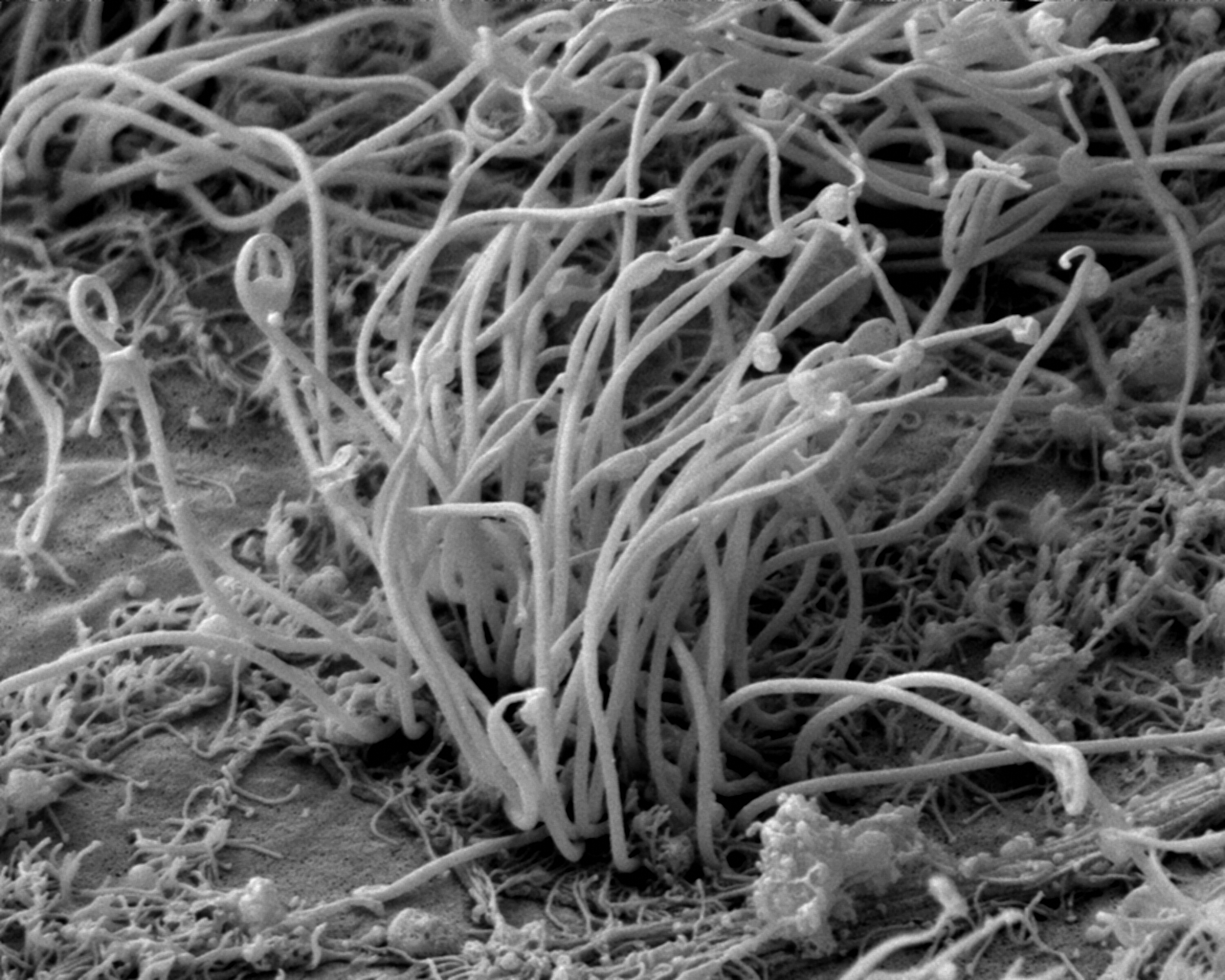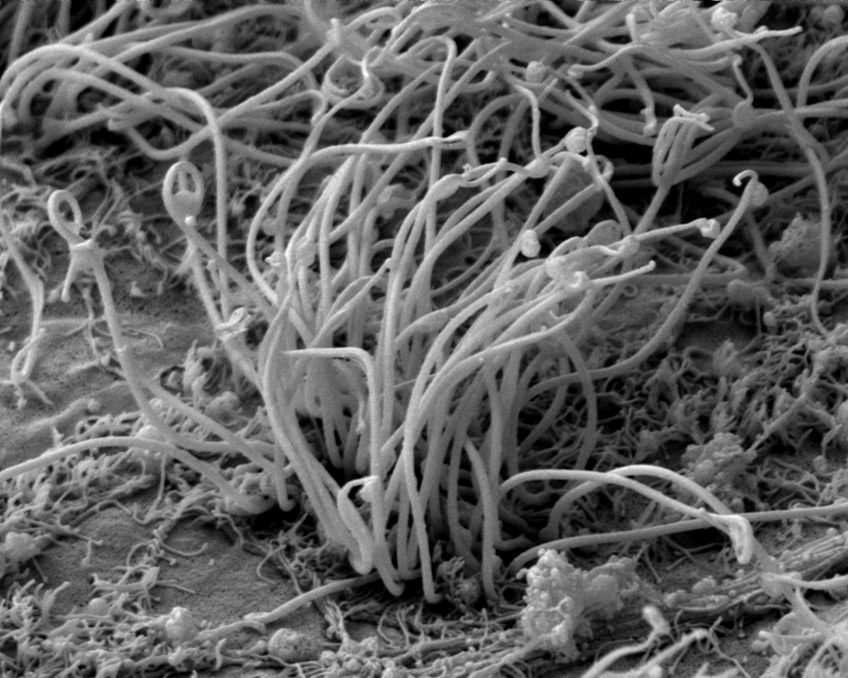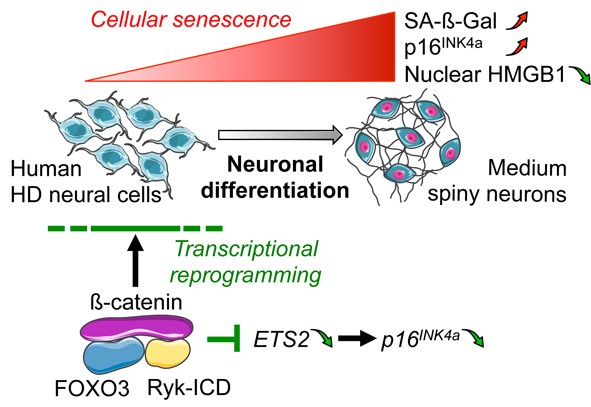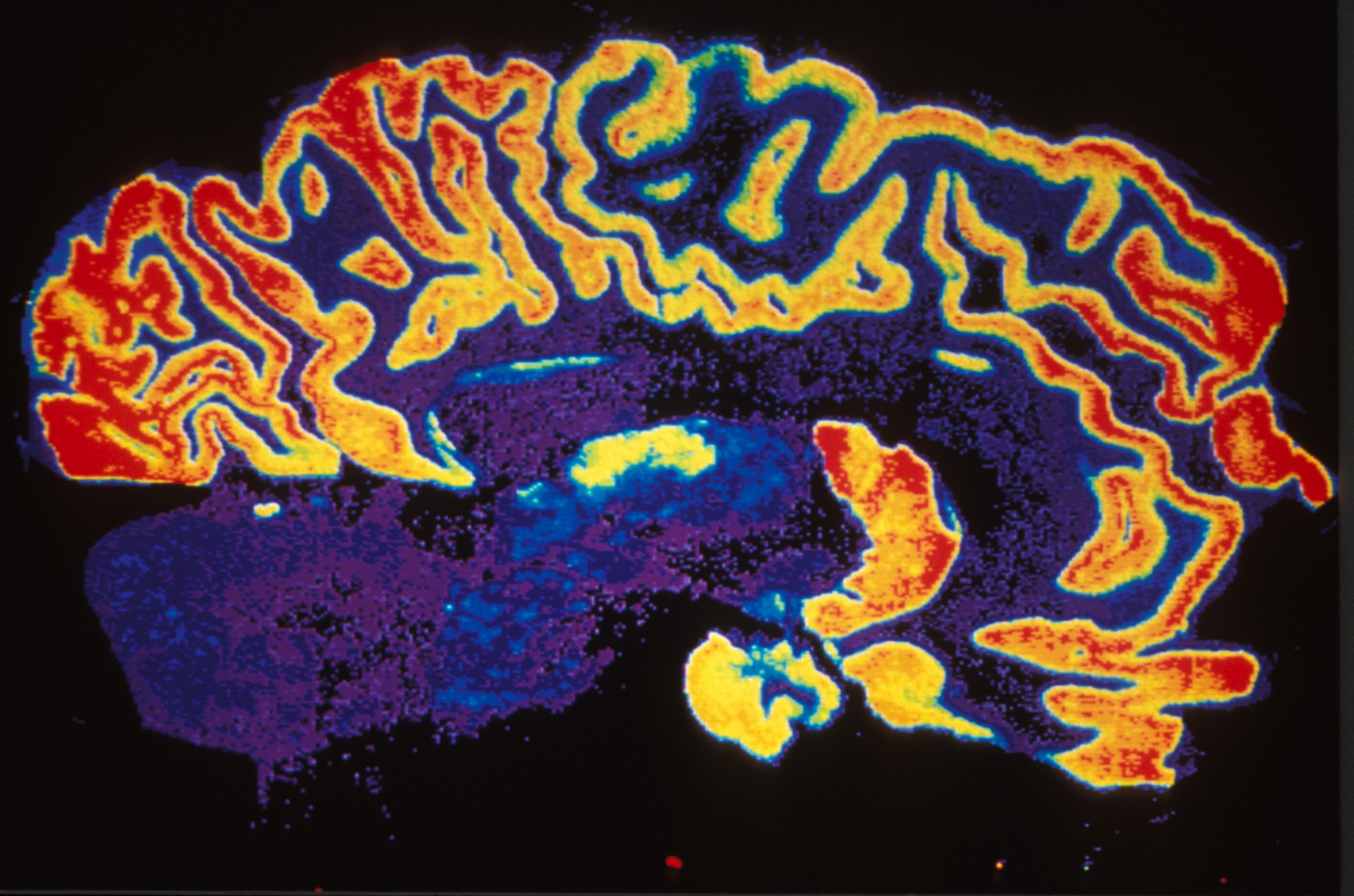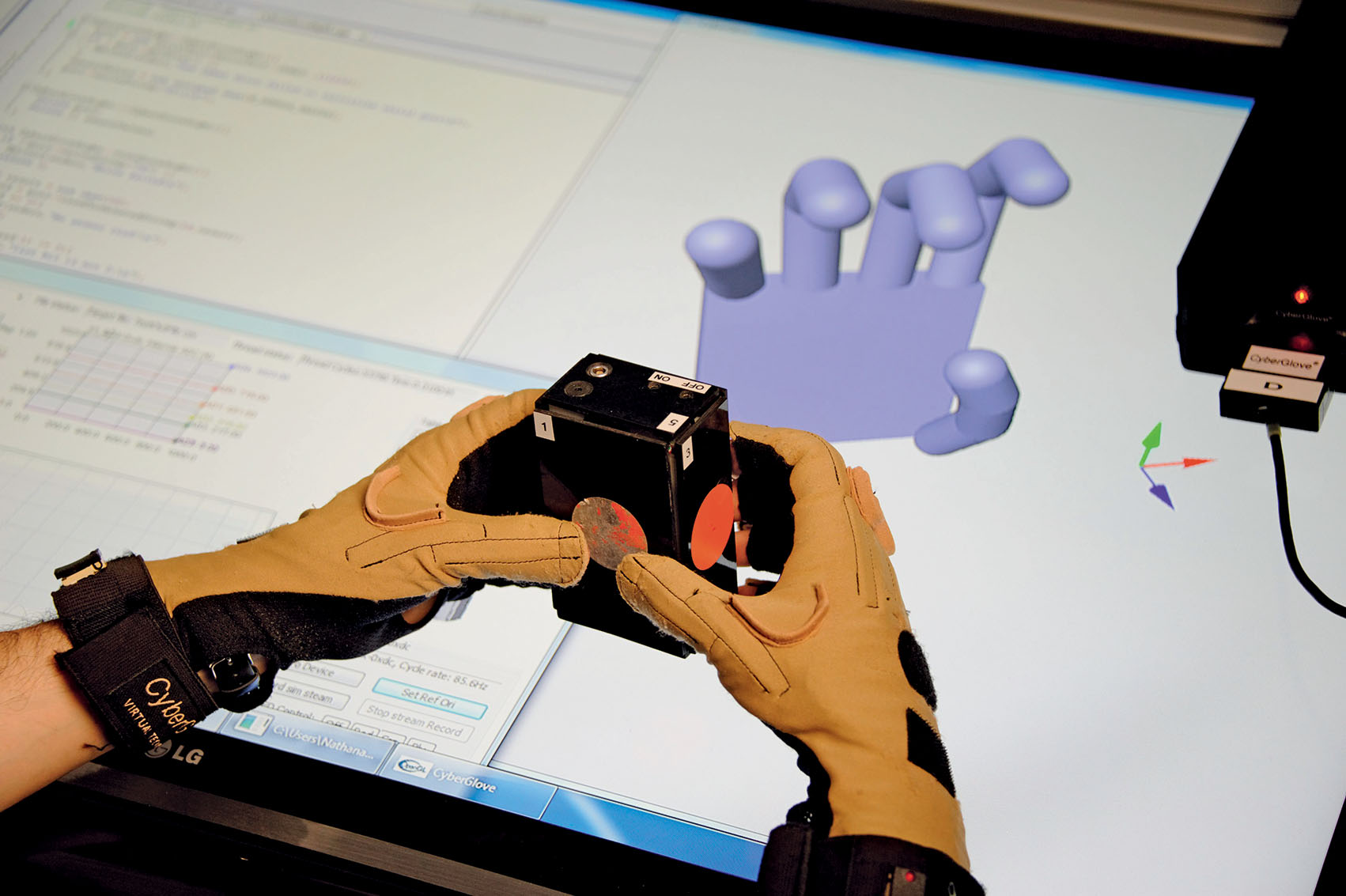©Fotolia
L’Inserm et le fonds de dotation Pfizer Innovation France annoncent la création d’un dispositif de formation à la recherche en biologie/santé à destination des élèves des écoles d’ingénieurs : l’École de l’Inserm-Pfizer Innovation (EIPI).
Née de ce partenariat, l’EIPI alliera modules d’enseignement et soutien financier pour la réalisation d’une thèse de doctorat par des élèves désireux d’enrichir leur formation initiale par une spécialisation dans le domaine de la santé.
De nombreuses écoles d’ingénieurs proposent au cours de leur cursus une formation à la recherche mais rares sont aujourd’hui les élèves à emprunter cette filière pour s’orienter vers la biologie ou la santé.
En créant l’École de l’Inserm-Pfizer Innovation France (EIPI), l’Inserm et le fonds de dotation Pfizer Innovation France proposent une nouvelle voie d’accès privilégiée, organisée et simplifiée aux élèves ingénieurs qui souhaitent compléter leur formation initiale par une spécialisation dans le domaine biomédical.
Cette initiative, née de la volonté des deux partenaires de promouvoir l’interdisciplinarité au service d’une recherche fertile et source d’innovations, vise à favoriser l’intégration d’ingénieurs dans les laboratoires de recherche académiques.« La recherche et l’innovation dans les domaines de la biologie et de la santé reposent plus que jamais sur des approches interdisciplinaires. Afin d’enrichir cette interdisciplinarité, l’Inserm souhaite intégrer des profils d’ingénieurs talentueux mais encore trop rares dans ses collectifs de recherche. C’est tout l’objet de ce dispositif innovant imaginé avec notre partenaire Pfizer Innovation France », Dr. Gilles Bloch, PDG de l’Inserm.
« Avec son approche fondée sur la complémentarité des compétences et sur l’interdisciplinarité, l’EIPI est un dispositif fondamental qui s’inscrit dans la volonté commune de l’Inserm et de Pfizer Innovation France de tout mettre en œuvre pour favoriser l’innovation de rupture en matière de santé ». Henriette Rosenquist, Présidente de Pfizer France et de Pfizer Innovation France.
Un dispositif en 2 formats
Une école d’été sera proposée en fin de première année du cycle ingénieur. 12 à 15 candidats participeront durant une à deux semaines à des formations académiques en biologie/santé ainsi qu’à des conférences portant sur des innovations ou des expertises technologiques clés pour la recherche biomédicale. Ces mêmes candidats seront invités, lors de leurs 2ème et 3ème année, à des manifestations scientifiques d’une durée de 2 à 3 jours, deux fois par an.
Des doctorats dans le domaine de la biologie/santé seront menés au sein de laboratoires de l’Inserm. A compter de l’année universitaire 2021-2022, trois doctorants, sélectionnés tous les ans, recevront une rémunération durant trois ans ainsi que le versement d’une dotation de fonctionnement de 20 000 € visant à faciliter l’amorçage d’un projet de recherche doctoral.
En lien avec un comité de pilotage du projet, constitué de représentants de l’Inserm et de Pfizer Innovation France, un conseil pédagogique composé d’experts scientifiques sera en charge de définir l’ensemble des contenus qui seront délivrés dans le cadre du dispositif. Il accompagnera par ailleurs les étudiants en les conseillant, en particulier dans leurs choix de recherche ou de laboratoires d’accueil.
L’appel à candidature sera lancé prochainement auprès des étudiants et la sélection de la première promotion sera effectuée au printemps 2021.