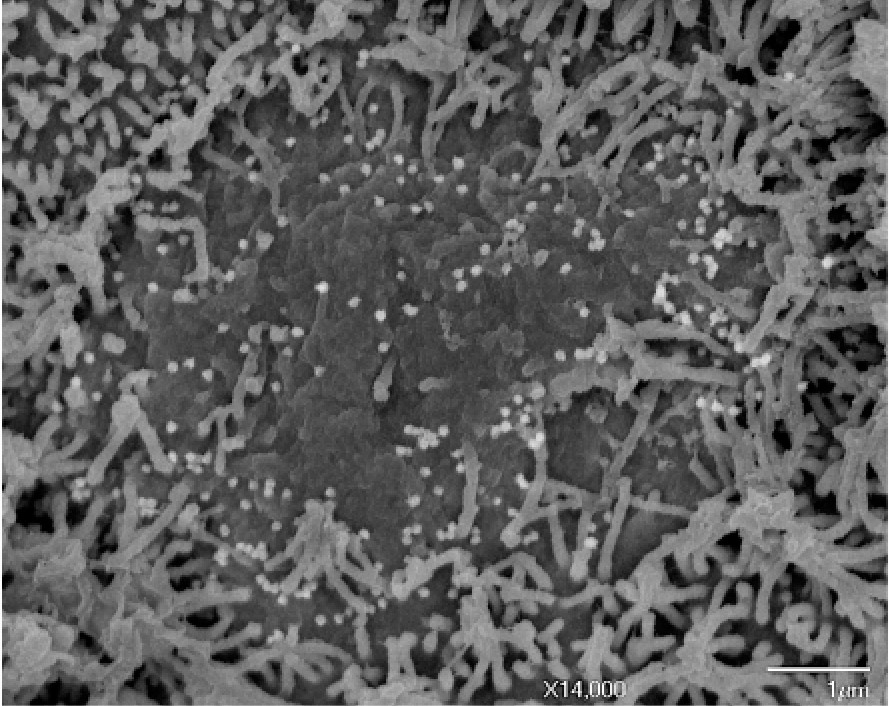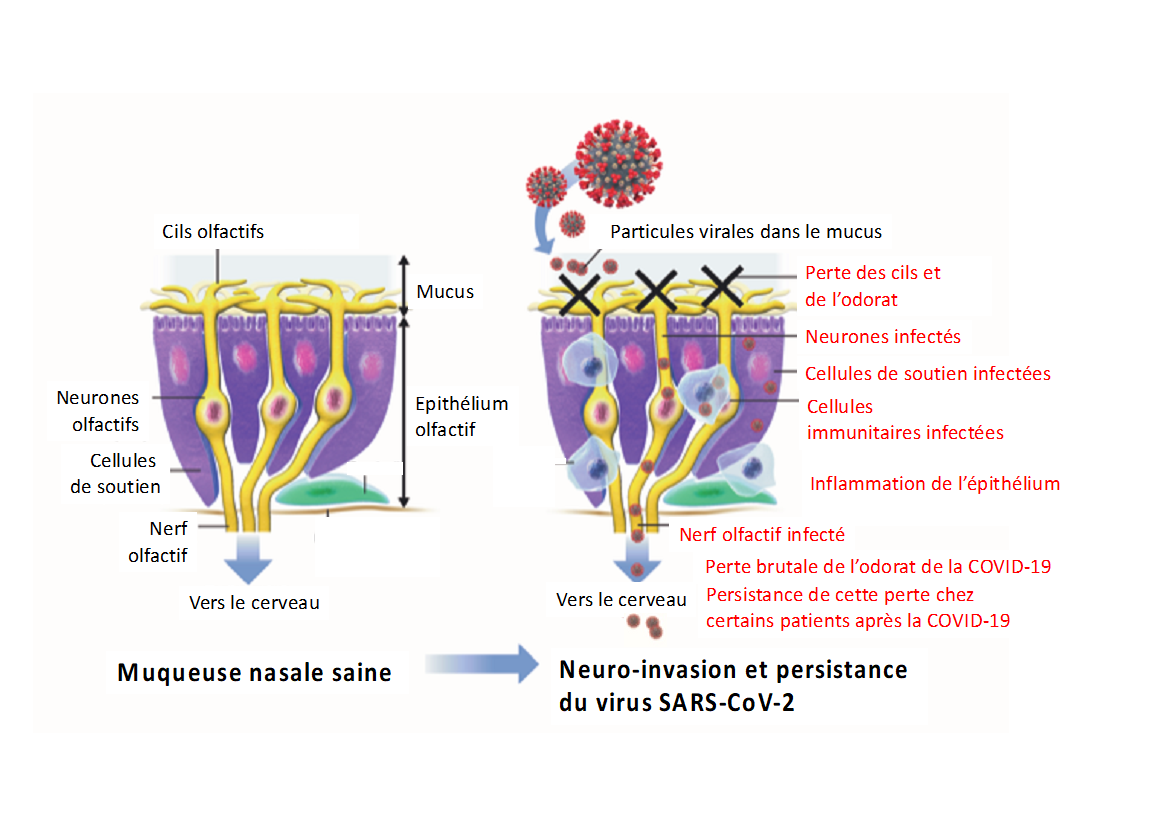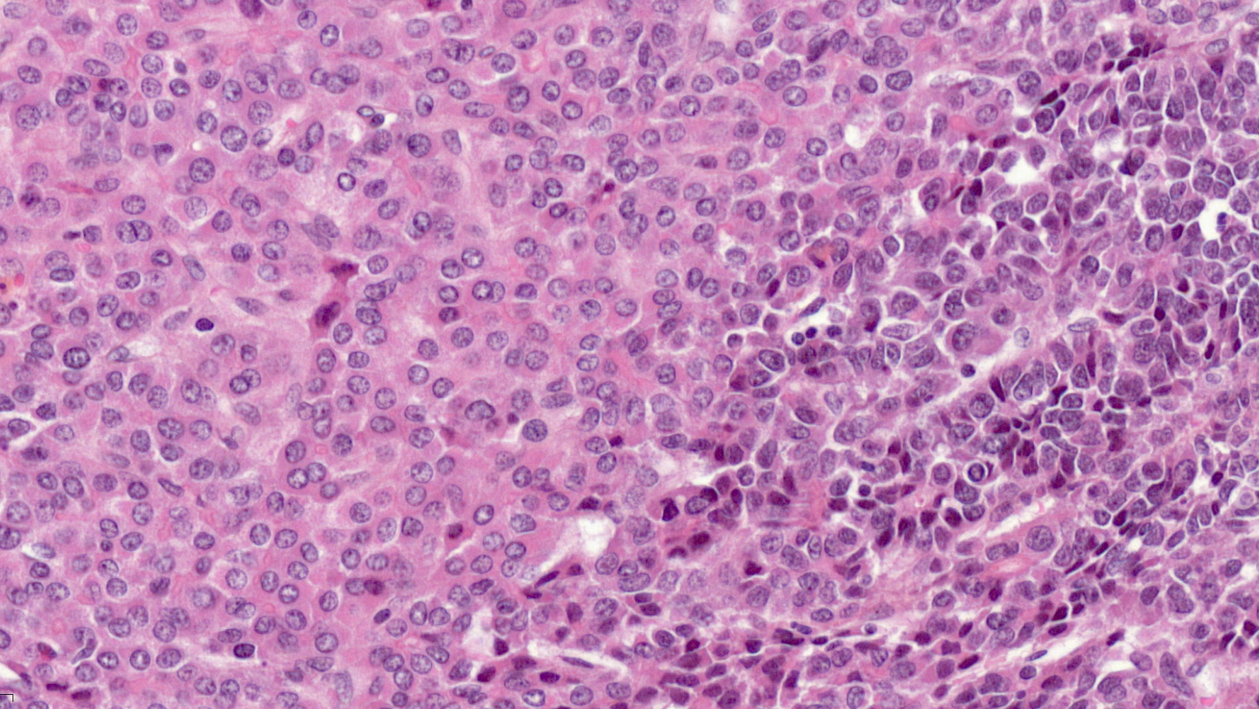© Photo by
Commandée par la MILDECA à l’Inserm, l’évaluation des salles de consommation à moindre risque (SCMR) de Paris et de Strasbourg, dispositifs expérimentaux de réduction des risques et des dommages (RDRD) dédiés à l’accueil et aux soins des usagers de drogues par injection, conclut à des effets positifs en termes de santé publique.
L’accès à ces structures permet d’améliorer la santé de ces personnes (baisse des infections au VIH et au virus de l’hépatite C, des complications cutanées dues aux injections et des overdoses), et de diminuer les passages aux urgences. Des coûts médicaux importants sont ainsi évités. Les injections et le nombre de seringues abandonnées dans l’espace public diminuent. L’évaluation ne met pas en évidence de détérioration de la tranquillité publique liée à l’implantation des salles.
Elles sont aujourd’hui largement présentes en Europe – certaines depuis plus de 30 ans – avec plus de 80 salles réparties dans 9 pays.
Les SCMR de Paris et Strasbourg ont été ouvertes en 2016 dans le cadre d’une expérimentation, accompagnée d’une évaluation scientifique pluridisciplinaire, prévue par la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Ces ouvertures faisaient suite aux recommandations de l’expertise collective de l’Inserm « Réduction des risques infectieux chez les usagers de drogues » publiée en 2010 (disponible ici : https://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/86).
Une évaluation scientifique indépendante et pluridisciplinaire
Commandée par la MILDECA à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), l’évaluation scientifique de cette expérimentation, conduite entre 2013 et 2021, repose sur une approche pluridisciplinaire en santé publique (épidémiologie, économie de la santé et sociologie) qui a mobilisé plus de 40 scientifiques dans 4 équipes de recherche. Cette évaluation se décline en trois volets :
- Le premier repose sur la mise en place d’une cohorte de 665 usagers de drogues dont une partie fréquentait une SCMR, tandis que l’autre partie n’en fréquentait pas, chez qui plusieurs indicateurs de santé (infections, visites aux urgences…) ont été suivis (cohorte COSINUS) ;
- Le second volet (étude COSINUS éco) fournit une évaluation médico-économique des SCMR, et notamment de leur rapport coût-efficacité sur le long terme, intégrant le coût des salles et les coûts sanitaires évités ;
- Le troisième est constitué d’une recherche sociologique portant sur l’acceptabilité sociale de la SCMR de Paris et son impact sur la tranquillité publique. Ce volet repose sur 160 entretiens menés auprès de nombreuses parties prenantes (riverains, agents de propreté et de sécurité, policiers, professionnels de santé et de la RDRD, usagers de drogues, élus locaux), sur l’analyse des données de l’enquête EROPP sur l’opinion des français sur les SCMR en 2018, menée en collaboration avec l’OFDT, sur une analyse des discours dans la presse et sur une étude des traces de consommation dans l’espace public (présence de seringues) avant et après l’ouverture de la salle, menée à partir d’observations ethnographiques et d’une modélisation par séries temporelles.
Le travail des équipes de recherche (piloté par 6 investigateurs principaux : Marc Auriacombe, Sylvie Boyer, Anthony Cousien, Marie Jauffret-Roustide, Laurence Lalanne, et Perrine Roux) a été évalué par un comité scientifique indépendant présidé par Christian Ben Lakhdar (Université de Lille) et Marc Bardou (CHU Dijon).
Des résultats qui apportent de nombreux éléments favorables
Les résultats issus de ce programme de recherche montrent des effets positifs sur la santé¸ un rapport coût-efficacité des SCMR acceptable pour la société et une absence de détérioration de la tranquillité publique directement attribuable aux SCMR.
Au plan sanitaire, les résultats des analyses montrent que les usagers des SCMR sont moins susceptibles que les usagers de drogues par injection qui ne les fréquentent pas de déclarer des pratiques à risque d’infection (VIH, virus de l’hépatite C) ou des abcès, d’avoir une overdose, d’aller aux urgences, de s’injecter dans l’espace public et de commettre des délits.
Ces résultats sont globalement convergents avec les expériences conduites à l’étranger.En ce qui concerne l’accès aux soins, le constat est plus mitigé, ce qui pourrait être lié à la plus grande précarité des populations utilisatrices des SCMR que celle des personnes utilisant les autres structures de soin et de RDRD (Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de Drogues – CAARUD et Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie – CSAPA notamment). La surreprésentation de patients SCMR n’ayant pas de couverture sociale et la relative « nouveauté » de ces lieux expliquent ces limites, qui pourraient être dépassées au fil du temps notamment par une articulation plus forte des SCMR avec d’autres services ou professionnels du soin.
L’évaluation médico-économique estime à 11 millions d’euros les coûts médicaux évités chez les usagers de drogues fréquentant les SCMR, en extrapolant leur présence sur une période de 10 ans. Ceux-ci ne contrebalancent pas les coûts d’implémentation et de fonctionnement de ces structures sur 10 ans mais le rapport coût-efficacité est acceptable au regard des standards de la littérature internationale et du rapport coût-efficacité d’autres interventions de santé publique déjà mises en place en France. Les modélisations réalisées suggèrent que le rapport coût-efficacité des SCMR pourrait encore être amélioré si les espaces de consommation étaient intégrés aux structures existantes (CAARUD).
L’enquête sociologique sur l’acceptabilité sociale de la SCMR et son impact sur la tranquillité publique met en évidence une diversité des perceptions et des vécus vis-à-vis de la SCMR parisienne. Pour autant, ce dispositif fait désormais l’objet d’un consensus dans l’opinion générale avec 80,2% des Français favorables aux SCMR, 75,9% des Français favorables à l’ouverture de nouvelles SCMR et 55,1% favorables à l’ouverture d’une SCMR dans leur propre quartier (Enquête EROPP-OFDT 2018). Cette perception est largement partagée dans la sphère professionnelle des acteurs de la prise en charge des addictions et de la RDRD. Si le sujet reste clivant entre les associations de riverains, c’est souvent moins le dispositif même de SCMR qui est critiqué que son emplacement en zone résidentielle.
L’étude des traces de consommation (seringues, emballages de médicaments, etc.) dans un périmètre géographique proche de la SCMR parisienne met en évidence une diminution significative des seringues abandonnées dans l’espace public, leur nombre ayant été divisé par 3 depuis l’ouverture de la salle.
Ces données sur la diminution des injections dans l’espace public sont confortées par les entretiens menés avec les agents en charge de la propreté et de la sécurité ainsi que par les données de la cohorte.Concernant la tranquillité publique, les analyses de la cohorte montrent que la proportion de délits commis récemment par les utilisateurs de la SCMR est significativement moins importante comparée aux non-utilisateurs.
Des difficultés sont relevées par une partie des riverains concernant la persistance d’injections dans l’espace public dans certaines rues autour de la SCMR. Elles seraient le fait d’un petit nombre d’usagers présentant des comorbidités psychiatriques, difficiles d’accès en termes de prise en charge. De plus, des troubles à l’ordre public divers (propreté, rixes) cristallisent certains mécontentements de riverains. Les entretiens menés auprès des forces de l’ordre montrent qu’il est impossible de distinguer si ces nuisances proviennent des usagers de la SCMR ou d’une population précaire installée depuis très longtemps aux abords de la Gare du Nord. D’autres riverains constatent une diminution des injections dans l’espace public, une amélioration de la tranquillité publique et sont rassurés de la présence de la SCMR dans le quartier qui permet pour les usagers d’être mieux pris en charge et pour les riverains de contacter des professionnels en cas de besoin. Ces riverains demandent une augmentation des heures d’ouverture et l’ouverture d’autres SCMR.
La MILDECA conclut que « Les SCMR ont fait la preuve de leur efficacité. Elles ne résolvent pas toutefois, à elles seules, l’ensemble des problèmes de santé et de tranquillité liés à l’usage de drogues. L’évaluation des expérimentations menées à Paris et Strasbourg démontre cependant que de nouvelles implantations méritent d’être étudiées, en fonction des contextes locaux, en complément des autres dispositifs d’accompagnement, de RDRD, et de sécurisation de l’espace public. »