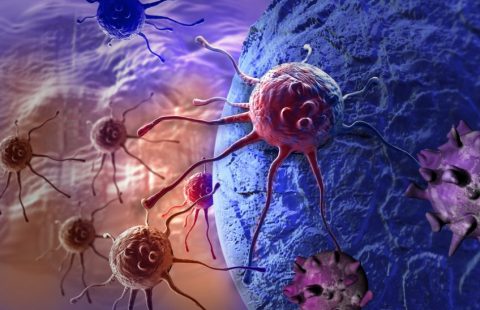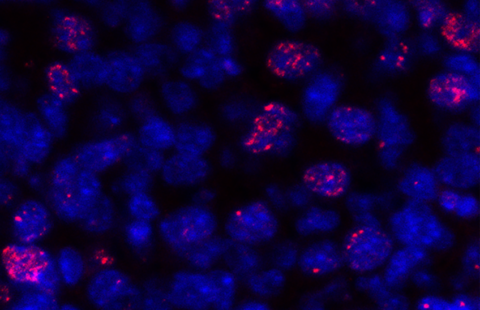Une équipe franco-suisse met en lumière l’impact à long terme des inégalités socio-économiques sur la qualité de vie des femmes ayant eu un cancer du sein. © Photo Angiola Harry sur Unsplash
Une équipe franco-suisse met en lumière l’impact à long terme des inégalités socio-économiques sur la qualité de vie des femmes ayant eu un cancer du sein. © Photo Angiola Harry sur Unsplash
Dans le domaine de la santé, les inégalités peuvent apparaître à tous les niveaux chez les femmes atteintes d’un cancer du sein: prévention, dépistage, diagnostic, traitement et survie. Mais qu’en est-il de leur qualité de vie? En suivant pendant 2 ans près de 6000 patientes, une équipe franco-suisse de l’Université de Genève (UNIGE), des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), de l’Inserm et de Gustave Roussy montre que leur statut socio-économique a un impact majeur et durable, en dépit d’une prise en charge médicale identique. Ces résultats qui font partie l’étude CANTO promue par UNICANCER, à lire dans le Journal of Clinical Oncology, appellent à une meilleure prise en compte des déterminants socio-économiques dans les programmes de soutien aux femmes atteintes d’un cancer du sein.
Les déterminants sociaux et économiques (comme le revenu ou le niveau d’éducation) ont un impact sur la manière dont les individus font face à la maladie et constituent l’une des principales causes des inégalités en matière de santé. En oncologie, les inégalités socio-économiques sont présentes tout au long du continuum de soins, de la prévention au diagnostic, traitement et survie.
« On ignorait néanmoins l’impact des inégalités économiques sur la qualité de vie des personnes atteintes d’un cancer du sein », explique José Sandoval, oncologue au Département d’oncologie des HUG et chercheur dans les départements de médecine et santé et médecine communautaires de la Faculté de médecine de l’UNIGE, premier auteur de cette étude. « C’est ce que nous avons voulu quantifier chez ces femmes, au moment du diagnostic, mais aussi dans les deux années qui suivent. »
Près de 6 000 femmes suivies pendant deux ans
Les 5900 femmes qui ont participé à cette étude, soignées en France, ont eu un cancer du sein précoce (sans métastase), un cancer fréquent et dont plus de 80% des femmes guérissent.
« De nombreuses femmes recevaient un traitement lourd la première année suivant leur diagnostic — comme une chirurgie suivie d’une
chimiothérapie — puis une hormonothérapie la deuxième année. Nous les avons suivies sur deux ans afin d’analyser l’évolution des différences de qualité de vie sur le moyen terme », souligne Gwenn Menvielle, directrice de recherche à l’Inserm et à Gustave Roussy, qui a dirigé ces travaux.
L’équipe de recherche a examiné cinq domaines de la qualité de vie – la fatigue, l’état général, l’état psychique, la santé sexuelle et les effets secondaires, en regard de plusieurs indicateurs socio-économiques: niveau d’études, revenu du foyer en tenant compte du nombre de personnes dans le foyer, et situation financière perçue. La combinaison de ces éléments a permis de déterminer un score où 0 indique l’absence d’inégalités.
Les inégalités augmentent rapidement
Au diagnostic, les inégalités de qualité de vie entre les deux extrêmes socio-économiques sont notables, avec un score de 6,7. Le score augmente à 11 pendant le traitement, puis se maintient à 10 deux ans après le diagnostic, soit à un niveau plus élevé qu’à l’annonce du diagnostic.
« Si on s’attendait à une certaine inégalité au début de la maladie, le fait que ces inégalités augmentent rapidement et perdurent autant constitue une surprise », analyse José Sandoval. « L’impact sur la qualité de vie est beaucoup plus prononcé chez les femmes moins favorisées, quelles que soient les caractéristiques biologiques de leur cancer, leur âge ou le traitement reçu. »
Pourquoi ? Les réponses sont à chercher non pas au niveau du traitement, similaire pour toutes les femmes, mais probablement dans tous les éléments de soutien autour de la prise en charge médicale.
« Avoir le temps, l’argent et l’accès à l’information pour prendre soin de soi et trouver des ressources de soutien et mieux gérer les effets secondaires physiques et psychologiques de la maladie sera probablement plus facile pour les femmes de statut socio-économique élevé que pour, par exemple, une mère de famille monoparentale à faible revenu, sans relais pour ses enfants », souligne José Sandoval. « Or, ces éléments influent sur la maladie et ses conséquences pour la santé physique et psychique des patientes. »
Mieux prendre en compte les inégalités
L’accès égalitaire aux soins n’est donc pas synonyme d’absence d’inégalité. Le contexte socio-économique peut avoir un impact majeur sur l’état de santé, au même titre que les caractéristiques biologiques.
« Lorsque l’on parle d’oncologie de précision, il faudrait prendre en compte la personne dans son ensemble, y compris dans sa dimension sociale », ajoutent les auteurs. « Nos données concernent des femmes soignées en France, un pays pourtant très égalitaire en matière d’accès aux soins. Dans des pays sans système de santé universel, ces inégalités risquent d’être encore plus prononcées. »
Ces résultats font partie de l’étude CANTO: étude des toxicités chroniques des traitements anticancéreux chez les malades porteurs de cancer localisé. Cette recherche est financée par le gouvernement français dans le cadre du programme «Investissements d’avenir» géré par l’Agence nationale de la recherche (ANR), subvention n° ANR-10-COHO-0004.
Ces contenus pourraient aussi vous intéresser :