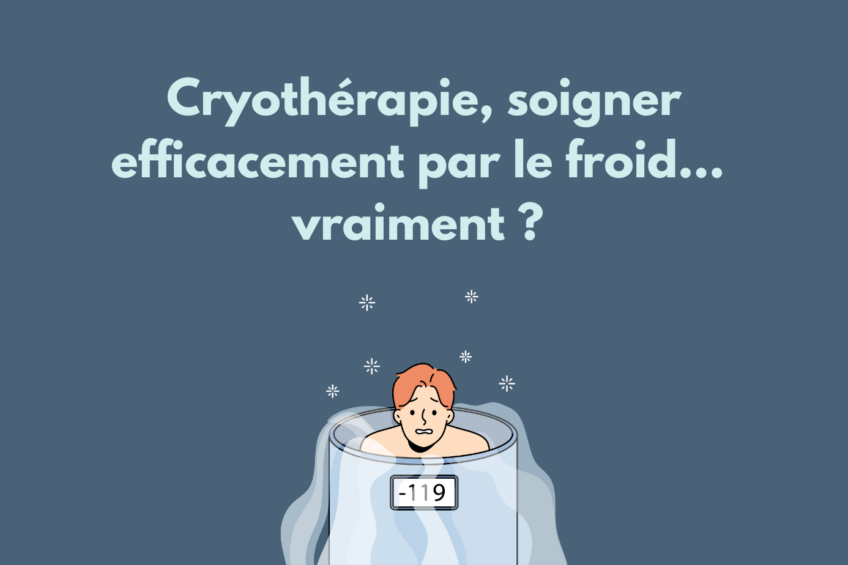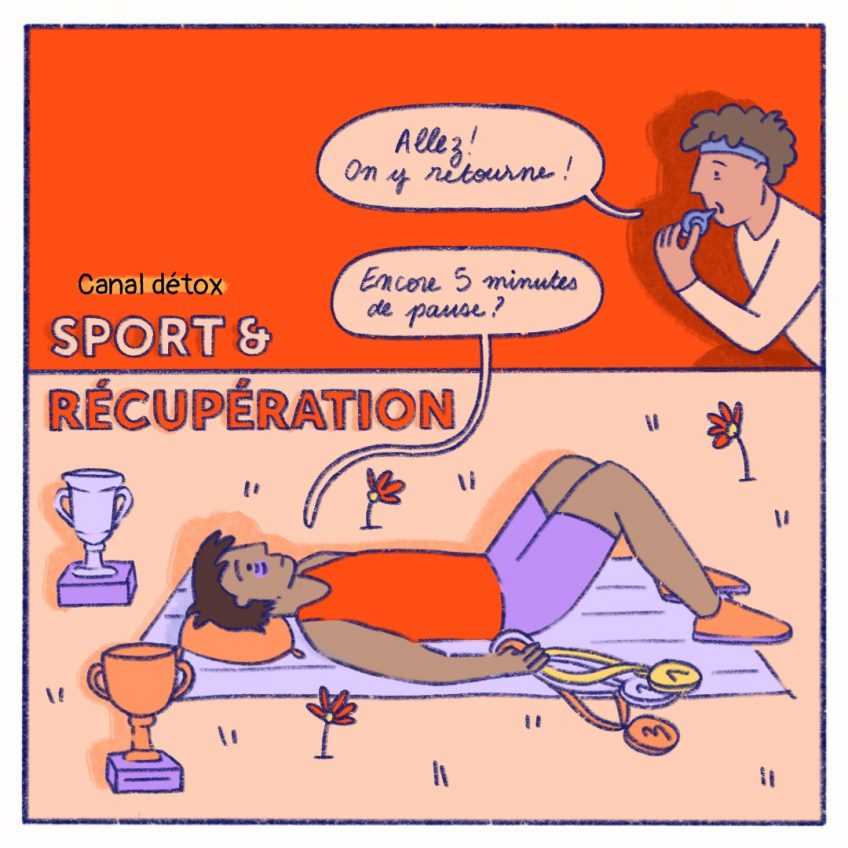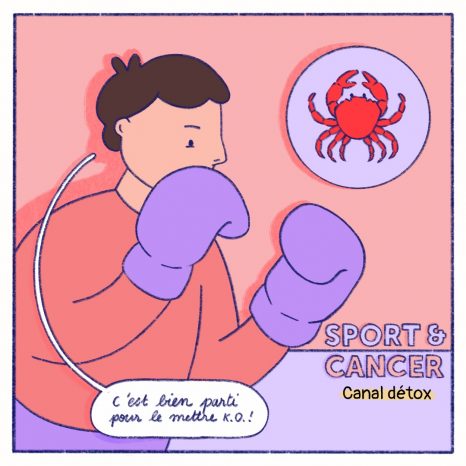Les boissons enrichies aux électrolytes sont censées prévenir la déshydratation (image d’illustration). Crédit : Adobe Stock
Les boissons enrichies aux électrolytes sont censées prévenir la déshydratation (image d’illustration). Crédit : Adobe Stock
Que ce soit pour préparer un marathon, se remettre d’une soirée trop arrosée ou affronter une canicule, les boissons aux électrolytes sont souvent présentées comme des alliées miracles, vantées pour leurs supposées vertus « super hydratantes ».
Sur TikTok, la tendance explose : des influenceurs qui se présentent comme des spécialistes du bien-être affirment commencer chaque matin par une cure, et le hashtag « Electrolyc drinks » cumule déjà plus de 48 millions de vues. Mais que dit vraiment la science ? Canal Détox, la cellule de l’Inserm qui lutte contre les fausses informations en santé, fait le point.
Qu’est-ce qu’une boisson enrichie aux électrolytes ?
Dans leurs bouteilles fluos, en poudre ou sous forme de comprimés effervescents, les boissons enrichies aux électrolytes sont censées prévenir la déshydratation.
Elles contiennent des sels minéraux comme le sodium, le potassium, le magnésium ou le calcium. Ces électrolytes jouent un rôle clé dans plusieurs fonctions essentielles de notre corps : l’hydratation, la régulation de la tension et du rythme cardiaque, la transformation des nutriments en énergie, la contraction musculaire, l’activité cérébrale… Lorsqu’on transpire, on perd une partie de ces sels minéraux. Les boissons enrichies aux électrolytes sont alors supposées compenser ces pertes.
Certaines boissons aux électrolytes contiennent également des glucides. Dans le commerce, on les présente alors aussi souvent comme des boissons de l’effort ou des boissons sportives, qui se déclinent en plusieurs types : les boissons dites « isotoniques », les boissons « hypotoniques », avec une concentration un peu plus faible en sodium et en glucides, et les « boissons hypertoniques », plus concentrées.
Les boissons aux électrolytes ne doivent pas être confondues avec les boissons dites « énergisantes », qui contiennent de la caféine, des sucres rapides et des acides aminés comme la taurine, destinés à stimuler l’éveil et la concentration, et qui sont strictement déconseillées pendant l’effort physique, comme le rappelle l’Agence nationale de sécurité de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). [1]
Les boissons aux électrolytes sont-elles vraiment utiles pour ne pas se déshydrater ?
Dans la majorité des cas, les sportifs occasionnels n’ont pas besoin de recourir à des compléments en sels minéraux : une alimentation équilibrée et l’eau du robinet suffisent amplement à couvrir leurs besoins.
L’agence fédérale des États-Unis chargée de la promotion de la santé publique, le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) considère que même les personnes qui travaillent en plein air exposées aux fortes chaleurs, se supplémenter en électrolytes n’ont la plupart pas du temps pas besoin de se supplémenter en électrolytes. [2]
Les boissons aux électrolytes sont souvent recommandées pour les efforts physiques intenses et prolongés, de plus d’une heure. Mais, même dans ce cas, leurs bénéfices sont de plus en plus discutés, alors que certaines études avec un faible nombre de participants ont montré que, même lors d’épreuves d’endurance comme les triathlons, des athlètes parviennent à maintenir un taux de sodium normal dans leur sang, sans supplémentation particulière. [3]
Ces résultats pourraient en partie s’expliquer par le fait que tout le monde ne transpire pas de la même façon, et que les pertes en sel minéraux lors de l’effort varient énormément d’un individu à l’autre, comme le montre une étude réalisée auprès de 150 marathoniens, publiée en juillet 2016 dans le Journal of the International Society of Sports Nutrition. [4]
De plus, l’efficacité de ces boissons semble dépendre de leur composition. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) n’autorise certaines allégations sur l’hydratation et la performance que pour les boissons sportives enrichies en sodium et en glucides respectant des dosages très précis. [5]
Les boissons aux électrolytes sont-elles utiles pour prévenir l’hyponatrémie ?
Dans de rares cas, boire trop d’eau peut faire baisser le taux de sodium dans le sang : c’est ce qu’on appelle l’hyponatrémie, un phénomène qui peut provoquer de la fatigue, des nausées, ou encore des convulsions dans les cas les plus graves. Les personnes avec des problèmes de cœur, de foie ou de reins sont plus à risque.
Les athlètes qui boivent trop d’eau lors d’efforts intenses et très prolongés peuvent également être exposés. Mais les boissons sportives ne semblent pas contenir suffisamment de sodium pour prévenir ce risque, comme le suggère une étude menée auprès de près de 500 marathoniens, dont les résultats ont été publiés en avril 2005 dans le New England Journal of Medicine. [6]
Quels sont les risques avec les boissons enrichies aux électrolytes ?
Les boissons sportives enrichies aux électrolytes sont fréquemment perçues comme des alternatives saines aux sodas ou aux boissons énergisantes. Pourtant, elles sont souvent riches en sucres ajoutés ou en édulcorants (qui ne sont pas considérés comme une alternative sûre aux sucres ajoutés par les autorités sanitaires). [7]
Entre 2004 et 2011, plus de 7 500 enfants et adolescents âgés de 9 à 16 ans ont été interrogés sur leur consommation de boissons sportives dans le cadre d’une étude américaine. Publiées dans la revue Obesity en septembre 2014, les conclusions sont sans appel : la consommation de boissons sportives était associée à une prise de poids, chez les garçons comme chez les filles.[8]
Les boissons enrichies aux électrolytes apportent aussi du sel. Or, un excès de sodium est associé à des risques bien documentés pour la santé, comme l’hypertension et les maladies rénales et cardiovasculaires.
En bref, que faut-il retenir ?
Bien dosées, les boissons sportives pourraient présenter des bénéfices pour les athlètes lors d’efforts intenses et prolongés. En revanche, pour un jogging de trente minutes ou pour se remettre d’un état d’ébriété, boire de l’eau suffit amplement, et permet d’éviter des apports inutiles en sels, sucres ou édulcorants !
Cet article a été écrit avec le soutien d’Alice Bellicha, enseignante-chercheuse dans l’Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle (Centre de Recherches en Epidémiologie et Statistiques, Université Sorbonne Paris Nord, Inserm, Inrae, Cnam) et Basile Chaix, directeur de recherche à l’Inserm.
Sources
[1] Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, Evaluation des risques sanitaires des boissons dites énergisantes
[2] Centers for Disease Control and Prevention, Keeping Workers Hydrated and Cool Despite the Heat
[3] Hew-Butler T, Collins M, Bosch A, Sharwood K, Wilson G, Armstrong M, Jennings C, Swart J, Noakes T. Maintenance of plasma volume and serum sodium concentration despite body weight loss in ironman triathletes. Clin J Sport Med. 2007 Mar;17(2):116-22. doi: 10.1097/JSM.0b013e3180326836. PMID: 17414479
[4] Lara B, Gallo-Salazar C, Puente C, Areces F, Salinero JJ, Del Coso J. Interindividual variability in sweat electrolyte concentration in marathoners. J Int Soc Sports Nutr. 2016 Jul 29;13:31. doi: 10.1186/s12970-016-0141-z. PMID: 27478425; PMCID: PMC4966593.
[5] Autorité européenne de sécurité des aliments, Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to carbohydrate-electrolyte solutions and reduction in rated perceived exertion/effort during exercise
[6] Almond CSD, Shin AY, Fortescue EB, Mannix RC, Wypij D, Binstadt BA, et al. Hyponatremia among runners in the Boston Marathon. N Engl J Med. 2005 Apr 14;352(15):1550-1556. doi:10.1056/NEJMoa043901.
[7] Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, Les édulcorants intenses
[8] Field, A.E., Sonneville, K.R., Falbe, J., Flint, A., Haines, J., Rosner, B. and Camargo, C.A., Jr. (2014), Association of sports drinks with weight gain among adolescents and young adults. Obesity, 22: 2238-2243. https://doi.org/10.1002/oby.20845