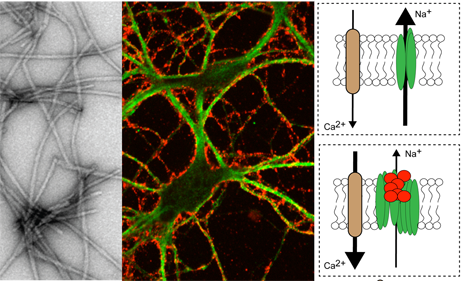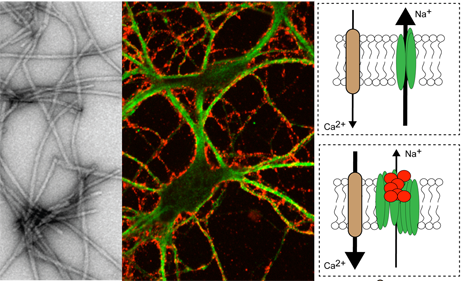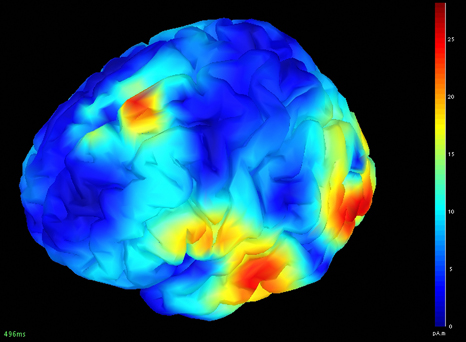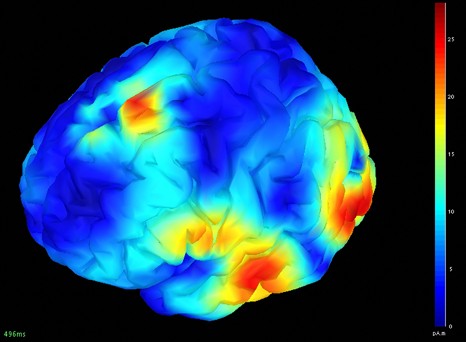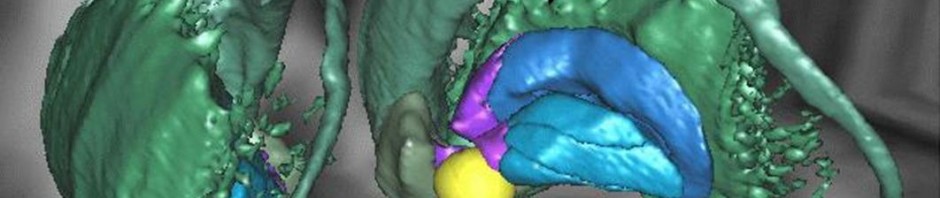Le moteur de recherche Google est aujourd’hui le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. Google Trends est un outil d’analyse statistique des mots entrés dans le moteur de recherche. Lors de l’épidémie de grippe H1N1 en 2009, un fort pic de croissance pour la recherche du mot « grippe » a été retrouvé dans les régions où avait commencé l’épidémie. Ainsi, Google Trends pourrait être utilisé pour suivre la propagation d’épidémies infectieuses, mais également d’autres phénomènes, comme des épidémies de suicide. C’est cette hypothèse qui a conduit le psychiatre et chercheur Guillaume Fond (Unité Inserm 955, Institut Mondor de recherche biomédicale, Créteil) et son équipe à étudier plus en détails les liens entre nombre de requêtes sur Google de termes tels que suicide, dépression, trouble bipolaire, et…risque d’une « épidémie » de suicides. Ce travail est publié dans la revue Psychiatry Research.
Une épidémie de suicide est une augmentation ponctuelle du taux de suicide dans une population à un moment donné. Ce phénomène a également été nommé « effet Werther », en référence à l’augmentation de suicide qui avait suivi la publication du livre de Goethe Les souffrances du jeune Werther en 1774.
Le but de l’étude réalisée par Guillaume Fond et ses collaborateurs a été de déterminer en quoi Google Trends pouvait aider à suivre des évolutions dans la recherche des mots-clés ou expressions-clés tels que « suicide » ; « comment se suicider », mais aussi « dépression » et « trouble bipolaire », le trouble bipolaire de l’humeur étant très fortement associé au risque suicidaire.
« Détecter une hausse de la recherche du mot suicide permettrait potentiellement de mettre en place des politiques de prévention ciblées », expliquent les chercheurs.
Les travaux publiés ce mois-ci montrent plusieurs pics de recherche entre 2005 et 2015 concernant le mot suicide, cette recherche étant dissociée des recherches des mots « dépression » et « bipolaire ». Ces pics de recherche ont parfois été associés à des actualités parues sur internet contenant le mot suicide, essentiellement. D’autres pics n’étaient associés à aucun événement présent sur le web. Ceci n’exclut pas que des reportages ou émission diffusés sur des canaux traditionnels (télévision radio, presse version papier) aient pu avoir une influence, mais celle-ci n’a pas été prise en considération dans le cadre de cette étude.
Ces résultats ont confirmé l’influence très forte des medias sur les taux de recherche de mots clés associés au suicide et à la dépression. Ainsi, la recherche du mot « bipolaire » a progressivement augmenté en France au cours de la dernière décennie. Un pic a été retrouvé dans cette recherche aussi bien en France qu’au niveau mondial au moment de l’annonce de la bipolarité de l’actrice Catherine Zeta-Jones en 2011.
Aussi les auteurs proposent de nommer l’effet de l’influence des medias de l’internet sur la recherche de mots psychiatriques « l’effet Zeta-Jones« , en référence à l’effet Werther.
En conclusion, Google Trends est un outil qui peut fournir certaines informations utiles pour évaluer l’impact de la communication médiatique sur les maladies mentales, mais l’outil n’est pas encore assez précis pour permettre une politique de prévention efficace du suicide.
Perspectives : un outil permettant une analyse fine de certains mots-clés, tel que « suicide » « comment se suicider », à une fréquence hebdomadaire voire journalière associée avec une répartition géographique fine, permettrait d’orienter les politiques de prévention du suicide de manière adaptée et efficace. Suivant le même procédé Google orientant les recherches des internautes en fonction des intérêts perçus par leurs mots clés, une orientation vers un numéro vert ou vers un centre de crise pourrait être imaginée. Ce système pourrait être particulièrement efficace chez les adolescents.
« La limite de ce procédé serait la liberté individuelle et le respect de la vie privée, enjeux très débattus à l’heure actuelle », conclut Guillaume Fond.