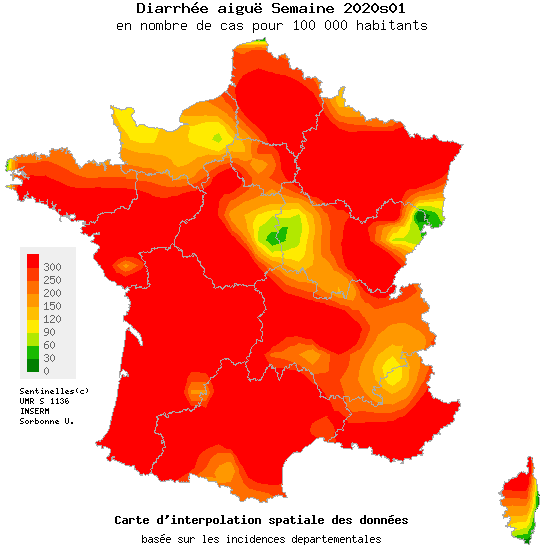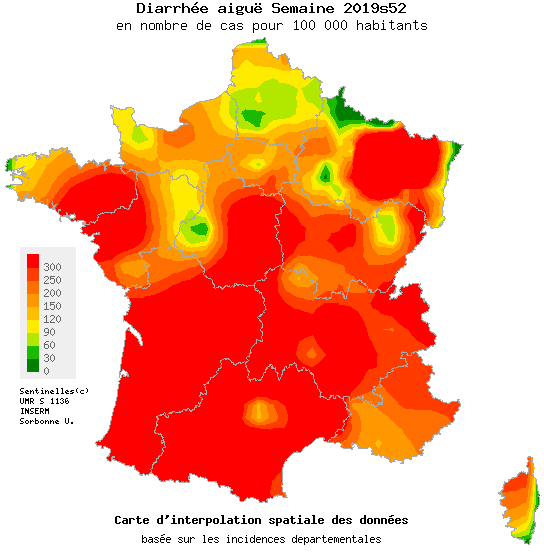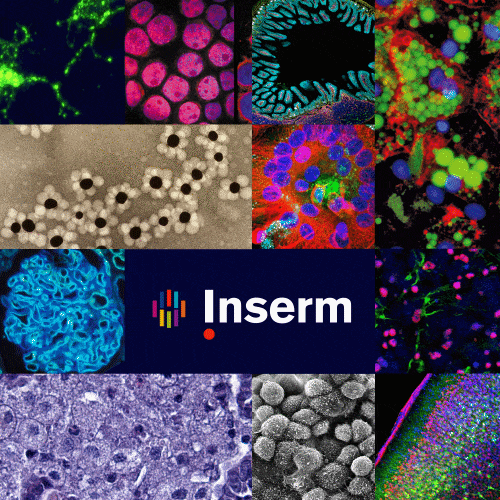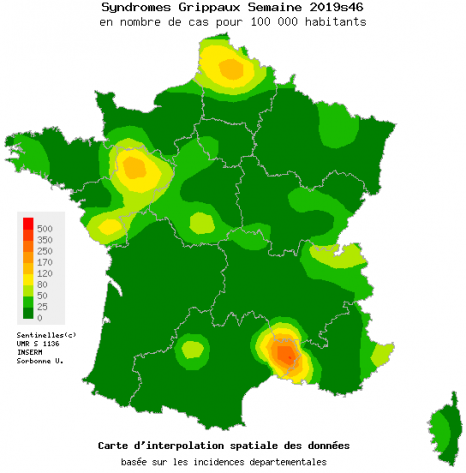Le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc) de l’Inserm publie cette semaine, dans le bulletin épidémiologique (BEH), un bilan de l’évolution des causes de mortalité en France depuis 2000. Permettant de distinguer les récentes évolutions des causes médicales de mortalité dans la population française, ce bulletin nous rappelle que près d’un tiers des décès sont causés par des cancers et un quart par des maladies cardio-vasculaires.
Le responsable du CépiDc et directeur de recherche à l’Inserm, Grégoire Rey, nous éclaire sur ces données et les enjeux qu’elles reflètent.
Dans la lignée des statistiques antérieures à 2000, le taux de mortalité est dans l’ensemble en baisse. Cependant, bien qu’il y ait à peu près autant de décès masculins que féminins, les hommes meurent plus que les femmes à âge égal et donc, en moyenne, plus jeunes. Ce déséquilibre, appelé sex ratio, est au désavantage des hommes dans la majorité des causes de décès. En 2016, il est de 1.7 pour l’ensemble des morts comptabilisés, mais grimpe à 3.3 pour les accidents de transport, à 3 pour les maladies chroniques du foie et même à 4.6 pour les tumeurs des voies aérodigestives supérieures (VADS). Cela veut dire par exemple que, parallèlement au recul important des décès causés par le virus du sida entre 2000 et 2016, il y a eu en 2016 3.8 fois plus de victimes masculines que féminines. Pour Grégoire Rey, les ratios élevés s’observent souvent pour des causes de mortalité impliquant des comportements à risque, que l’on retrouverait davantage chez les hommes, et pourraient donc expliquer une grande partie de ce décalage statistique.
Avec un taux de mortalité de respectivement 29 et 24.2%, les deux premières causes pathologiques de décès en France sont les tumeurs et les maladies cardio-vasculaires. Avec une population vieillissante et davantage sédentaire que par le passé, la France a vu le nombre de pathologies cardio-vasculaires augmenter, surtout chez les adultes d’âge moyen. Mais derrière cette augmentation corrélée aux évolutions sociodémographiques du pays, le taux de mortalité lié à des maladies cardio-vasculaires est en forte diminution pour les deux sexes, une baisse qui se poursuit depuis plusieurs décennies. Alors que celles-ci sont en Europe la première cause de décès en 2016, ce sont les tumeurs qui emportent le plus de personnes en France.
Bien que les décès causés par un cancer soient plus importants en effectifs qu’avant 2000, le taux est lui aussi en baisse par rapport au nombre de décès totaux. Ce qui n’empêche pas certains types de tumeurs d’inquiéter les épidémiologistes, ne sachant pas encore donner d’explications à leur présence accrue dans les données. Alors que chez les hommes les cancers de la prostate, colorectaux et des voies respiratoires sont continuellement en baisse dans les tableaux, le regain de prévalence de certaines tumeurs est inquiétant. C’est le cas des cancers du cerveau et du pancréas, que l’on retrouve en hausse dans l’ensemble de la population et des classes d’âge et pour lesquels les explications de causalité ne sont pas encore suffisantes, compliquant pour l’instant le pilotage de nouvelles campagnes publiques de prévention.
Malheureusement, il est très difficile de prédire l’avenir des causes de mortalité à partir de ces données. Souvent médiatisées pour la part non négligeable de décès liés aux cas de démence, les maladies neurodégénératives comme les syndromes d’Alzheimer et de Parkinson connaissent une évolution en dents de scie qu’il est encore difficile d’expliquer pour les épidémiologistes, celle-ci n’étant pas corrélée au vieillissement de la population depuis quelques décennies. Il en va de même pour les suicides. Si la médiatisation des suicides adolescents et professionnels est forte, le phénomène touche en réalité bien plus des personnes âgées, voire très âgées, et recule progressivement avec les années.
A la lecture des statistiques et de leur évolution, Grégoire Rey, confirme qu’il est tout de même raisonnable de penser qu’à l’avenir certaines causes de mortalité vont se faire plus rares. Ce sera le cas du cancer des poumons chez la femme, dont la prévalence encore élevée est due à un effet de retardement du tabagisme féminin dans la seconde moitié du XXème siècle, une consommation qui a depuis atteint un plateau et devrait diminuer comme chez les hommes. Même constat de la part de l’épidémiologiste de l’Inserm vis-à-vis du nombre de décès causés par les accidents de la route et le sida, une baisse de taux respectivement liée à une amélioration de la politique de prévention et aux progrès thérapeutiques majeurs ces dernières années.