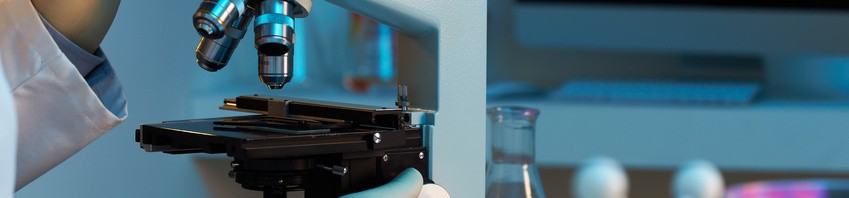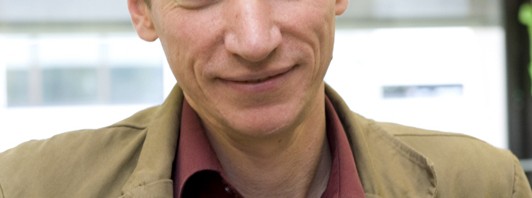Le Cirad, le CNRS, la CPU, l’Inserm, l’Institut Pasteur et l’IRD, membres fondateurs de l’Agence inter-établissements de recherche pour le développement (AIRD), ont signé, le 10 novembre 2011, un accord-cadre de coopération. Ils pérennisent et renforcent ainsi leur engagement en faveur de la recherche pour le développement.
Renforcer l’engagement par un accord-cadre
Ayant fait preuve de leur motivation sur la nécessité d’agir collectivement sur les questions de recherche pour le développement, les six membres fondateurs de l’AIRD ont souhaité pérenniser et renforcer leur engagement en concluant un accord-cadre, pour une durée de trois ans. Ce dernier a ainsi été signé le 10 novembre 2011, par Gérard Matheron, Président du Cirad, Alain Fuchs, Président du CNRS, Louis Vogel, Président de la CPU, André Syrota, Président Directeur général de l’Inserm, Alice Dautry, Directrice générale de l’Institut Pasteur et Michel Laurent, Président de l’IRD. Regroupés au sein d’un Comité de coordination, les partenaires contribueront à la réflexion stratégique de l’agence, à la programmation des activités et à la mutualisation des moyens (humains, financiers, infrastructures scientifiques, expertise…).
Une agence d’objectifs, de programmes et de moyens
Créée en 2006, l’AIRD compte six membres fondateurs : le Cirad, le CNRS, la CPU, l’Inserm, l’Institut Pasteur et l’IRD. Désormais intégrée au sein de l’IRD (décret n°2010-594 du 3 juin 2010), elle a vocation à mobiliser, animer et coordonner les organismes et établissements de recherche et d’enseignement supérieur français sur toute question de science pour le développement, afin de co-construire une société de la connaissance au sud.
Ses champs d’action sont :
- la recherche, pour faire avancer les connaissances et obtenir un réel impact au sud
- la formation et le renforcement des capacités scientifiques
- l’innovation, pour assurer la meilleure valorisation culturelle, économique et sociétale des résultats de recherche au Sud, la meilleure coordination de la recherche et la mise en place de moyens mutualisés
Agence d’objectifs, l’AIRD recueille les problématiques et attentes du sud tant à partir de ses réseaux au sud qu’en s’appuyant sur son Conseil d’orientation, composé à parité Nord-Sud. Elle utilise ces attentes pour générer des programmes “Sud” dans les feuilles de route programmatiques françaises, voire européennes, des organismes de recherche et des agences de financement de la recherche.
Agence de programmes, l’AIRD apporte un soutien à l’ingénierie des grands programmes de recherche réalisés en partenariat Nord-Sud, en particulier en contribuant à assurer le tour de table financier. Elle a vocation à porter les grands programmes de recherche régionaux, multi-organismes et multithématiques, tels la Grande Muraille Verte (Afrique), Guyamaz (Brésil) ou la gestion des centres de recherche et de veille en matière de santé. Elle agit pour réaliser des programmes ou remplir des missions pour le compte de ses deux ministères de tutelles (recherche et affaires étrangères), telle la coordination des actions des organismes français de recherche pour l’aide à la reconstruction du système de recherche en Haïti. Elle procède en coordonnant des projets ou programmes et en gérant des appels d’offre.
Agence de moyens, l’AIRD dispose de la capacité à mobiliser les forces scientifiques françaises, en premier lieu celles de ses membres fondateurs, dont les équipes actives au Sud regroupent de l’ordre de 7000 personnes. Elle s’appuie aussi sur les implantations au sud de ses membres fondateurs, laboratoires, observatoires, stations satellitaires, centres de documentation… Elle dispose de représentants institutionnels installés dans les pays du Sud, au plus près des partenaires et à l’écoute de leurs besoins, qui :
- assurent la liaison entre les acteurs locaux de la science, organismes ou ministères, et l’AIRD
- apportent un soutien aux travaux réalisés par l’AIRD et ses membres ;
- contribuent à faire remonter les problématiques et attentes du sud ;
- suivent les axes et programmes du partenariat ;
- sont garants de l’application régionale de la politique de l’AIRD et de la mise en œuvre des programmes en partenariat.
Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement est le centre de recherche français qui répond, avec les pays du Sud, aux enjeux internationaux de l’agriculture et du développement. Il produit et transmet, en partenariat avec ces pays, de nouvelles connaissances, pour accompagner le développement agricole et contribuer au débat sur les grands enjeux mondiaux de l’agronomie. Le Cirad concentre ses recherches autour de 6 axes scientifiques prioritaires, partagés et développés dans de nombreux dispositifs de recherche à travers le monde, qui s’adossent à 12 directions régionales. Le Cirad emploie 1 800 agents, dont 800 ingénieurs chercheurs. Son budget s’élève à 214 millions d’euros dont les deux tiers proviennent de l’Etat français. www.cirad.fr
Le CNRS
Le Centre national de la recherche scientifique est un organisme public de recherche (Etablissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche). Il produit du savoir et met ce savoir au service de la société. Avec plus de 34 000 personnes (dont 25 630 statutaires – 11 450 chercheurs et 14 180 ingénieurs, techniciens et administratifs), un budget primitif pour 2011 de 3,204 milliards d’euros dont 677 millions d’euros de ressources propres, une implantation sur l’ensemble du territoire national, le CNRS exerce son activité dans tous les champs de la connaissance, en s’appuyant sur plus de 1100 unités de recherche et de service. Des chercheurs éminents ont travaillé, à un moment ou à un autre de leur carrière, dans des laboratoires du CNRS. Avec 17 lauréats du prix Nobel et 11 de la Médaille Fields, le CNRS a une longue tradition d’excellence. www.cnrs.fr/
La CPU
Définie dans le code de l’Education, la Conférence des présidents d’université (CPU) rassemble les dirigeants des universités, des instituts nationaux polytechniques, des écoles normales supérieures, de grands établissements, et des pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES). Depuis 40 ans, elle représente et défend les intérêts des établissements qu’elle regroupe. Véritable acteur du débat public sur toutes les questions universitaires, la CPU est force de proposition et de négociation auprès des pouvoirs publics, des différents réseaux de l’enseignement supérieur et de la recherche, des partenaires économiques et sociaux et des institutions nationales et internationales. Dans un contexte de profondes mutations du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, la CPU a également un rôle de soutien aux présidents dans leurs nouvelles missions et de promotion de l’Université française et de ses valeurs. www.cpu.fr
L’Inserm
Créé en 1964, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la double tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de la Santé. Ses chercheurs ont pour vocation l’étude de toutes les maladies, des plus fréquentes aux plus rares, à travers leurs travaux de recherches biologiques, médicales et en santé des populations. L’Inserm soutient plus de 300 laboratoires répartis sur le territoire français. L’ensemble des équipes regroupe près de 13 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens, gestionnaires…Afin de consolider son rôle de premier plan dans la recherche clinique, l’Institut privilégie la mise en place d’infrastructures dédiées à la recherche clinique et la promotion d’essais cliniques toujours plus innovants. L’Inserm est membre fondateur d’Aviesan, l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé. www.inserm.fr
L’Institut Pasteur
Centre de recherche biomédicale de renommée internationale, l’Institut Pasteur créé en 1887 par Louis Pasteur, est une fondation privée reconnue d’utilité publique. Il a pour mission de contribuer à la prévention et à la lutte contre les maladies, en France et dans le monde, par la recherche scientifique et médicale, l’enseignement et des actions de santé publique. Près de 2600 personnes travaillent sur son campus à Paris. Parallèlement à des recherches sur le fonctionnement du vivant, une grande partie de ses travaux est consacrée à l’étude des maladies infectieuses, de maladies génétiques, neuro-dégénératives ou de certains cancers. L’Institut Pasteur est au cœur d’un Réseau international qui regroupe 32 instituts sur les 5 continents. Depuis sa création, 10 chercheurs ont reçu le Prix Nobel de Physiologie ou Médecine. www.pasteur.fr ; www.aiderpasteur.fr
L’IRD
Etablissement public français à caractère scientifique et technologique, l’Institut de Recherche pour le Développement déploie ses activités à l’international depuis son siège, à Marseille, et ses deux centres métropolitains de Montpellier et de Bondy. Grâce à son action de recherche, de formation et d’innovation en partenariat, il rayonne dans plus d’une cinquantaine de pays en Afrique, sur le pourtour méditerranéen, en Asie, en Amérique latine et en outre-mer. Fondés sur l’interdisciplinarité, les projets menés conjointement traitent de questions cruciales pour les Suds : maladies tropicales et de civilisation, relations entre santé et environnement, changements climatiques, ressources en eau, sécurité alimentaire, écosystèmes tropicaux et méditerranéens, risques naturels, pauvreté, vulnérabilité et inégalités sociales, migrations, évolution du marché du travail…www.ird.fr