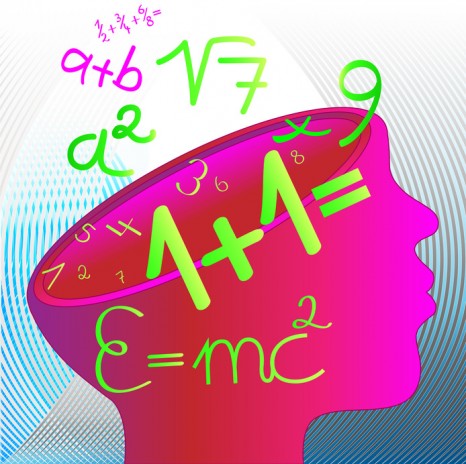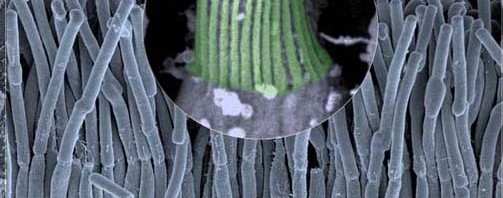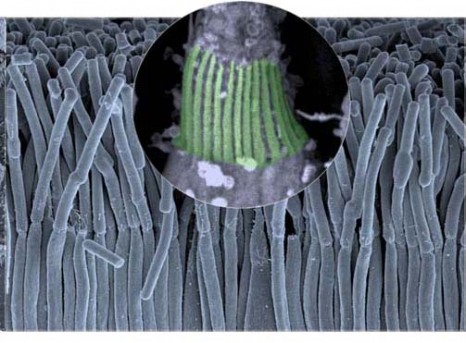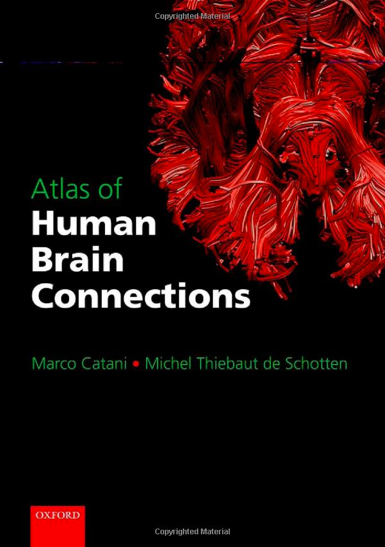La dépression est une maladie multifactorielle fréquente et dont l’apparition des symptômes est souvent liée au mode de vie des patients. Parmi ces facteurs, l’alimentation semble jouer un rôle prépondérant. Des travaux menés en collaboration par des chercheurs de l’Inserm à Montpellier et de l’University College London suggèrent que l’amélioration de la qualité de l’alimentation est associée à la diminution de la récurrence des épisodes dépressifs, en particulier chez les femmes. Ces résultats sont publiés dans la revue American Journal of Clinical Nutrition.
Dans ce travail, les chercheurs de l’Unité 1061 « Neuropsychiatrie: recherche épidémiologie et clinique » (Inserm/Université Montpellier) et de l’University College London, ont analysé les données, sur 10 ans (1993-2003), de 4215 fonctionnaires de la cohorte anglaise Whitehall II travaillant à Londres. La qualité de l’alimentation a été estimée à l’aide d’un score -le Alternative Healthy Eating Index (AHEI)[1].
Chez les participantes de l’étude, la qualité de l’alimentation (le fait de suivre les recommandations alimentaires du AHEI) sur 10 ans est associée à la récurrence des symptômes dépressifs mesurés 5 ans plus tard. Cette relation n’est pas retrouvée chez les hommes. L’originalité de cette étude réside dans l’analyse des données répétées au cours du temps permettant d’étudier le sens de la relation alimentation-symptômes dépressifs.
« Nous avons observé que l’amélioration ou le maintien du score au AHEI des participantes au cours des 10 ans de suivi diminue de 65% leur risque de développer des symptômes dépressifs récurrents par rapport aux femmes avec un faible score », explique Tasnime Akbaraly, chargée de recherche à l’Inserm, co-auteur de l’étude. « Les résultats suggèrent que le suivi des recommandations alimentaires du AHEI tout au long de la vie adulte permettrait de réduire la récurrence des épisodes dépressifs » conclut la chercheuse.
[1]Le score du AHEI est basé sur les apports alimentaires en fruits, légumes, noix, soja, fibres, en acides gras trans, sur le ratio de viande blanche par rapport à la viande rouge, le ratio d’acides gras polyinsaturés par rapport aux acides gras saturés, la prise d’alcool et la consommation à long terme de multivitamines.