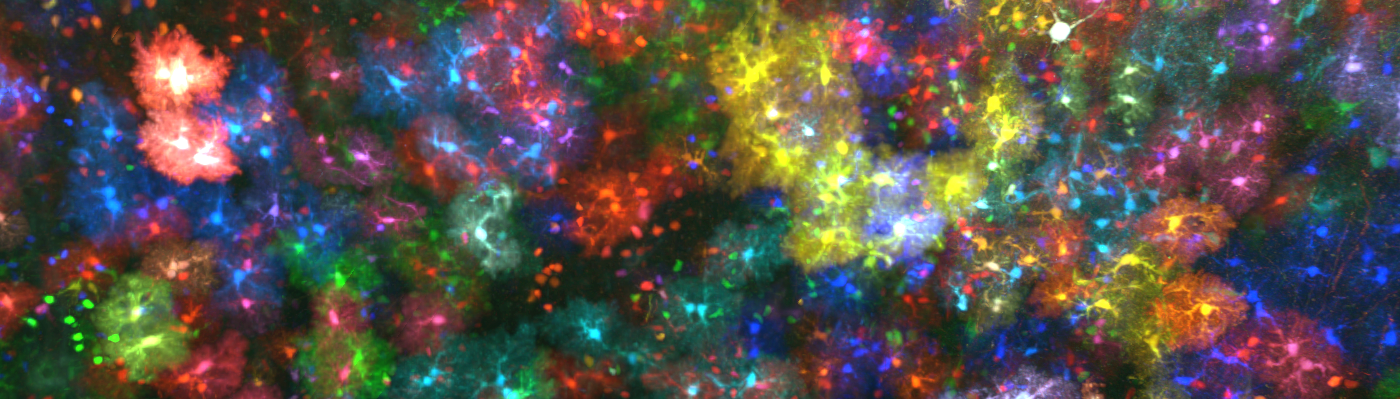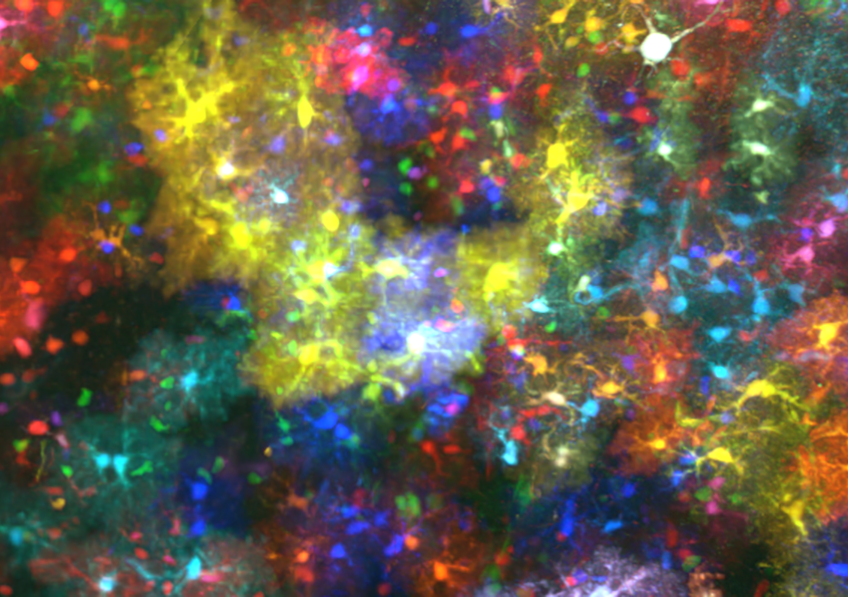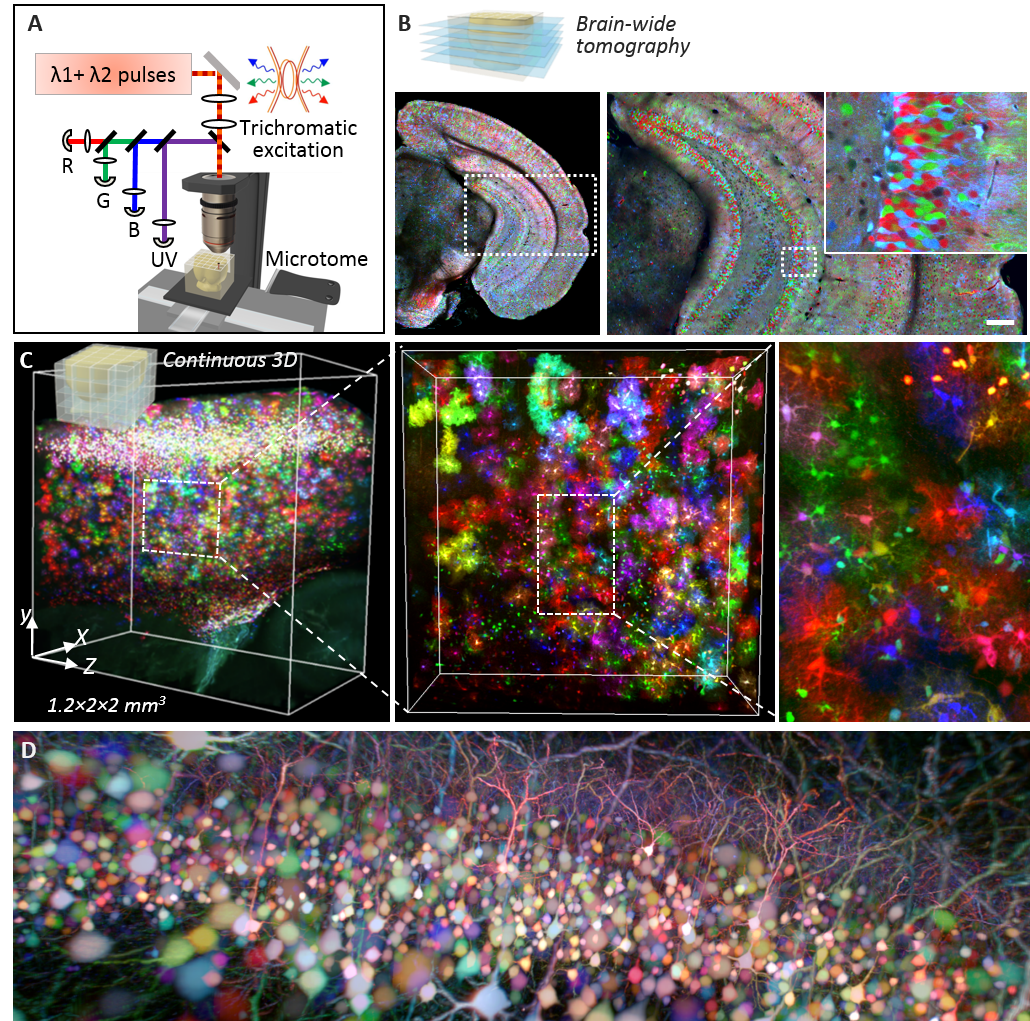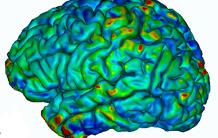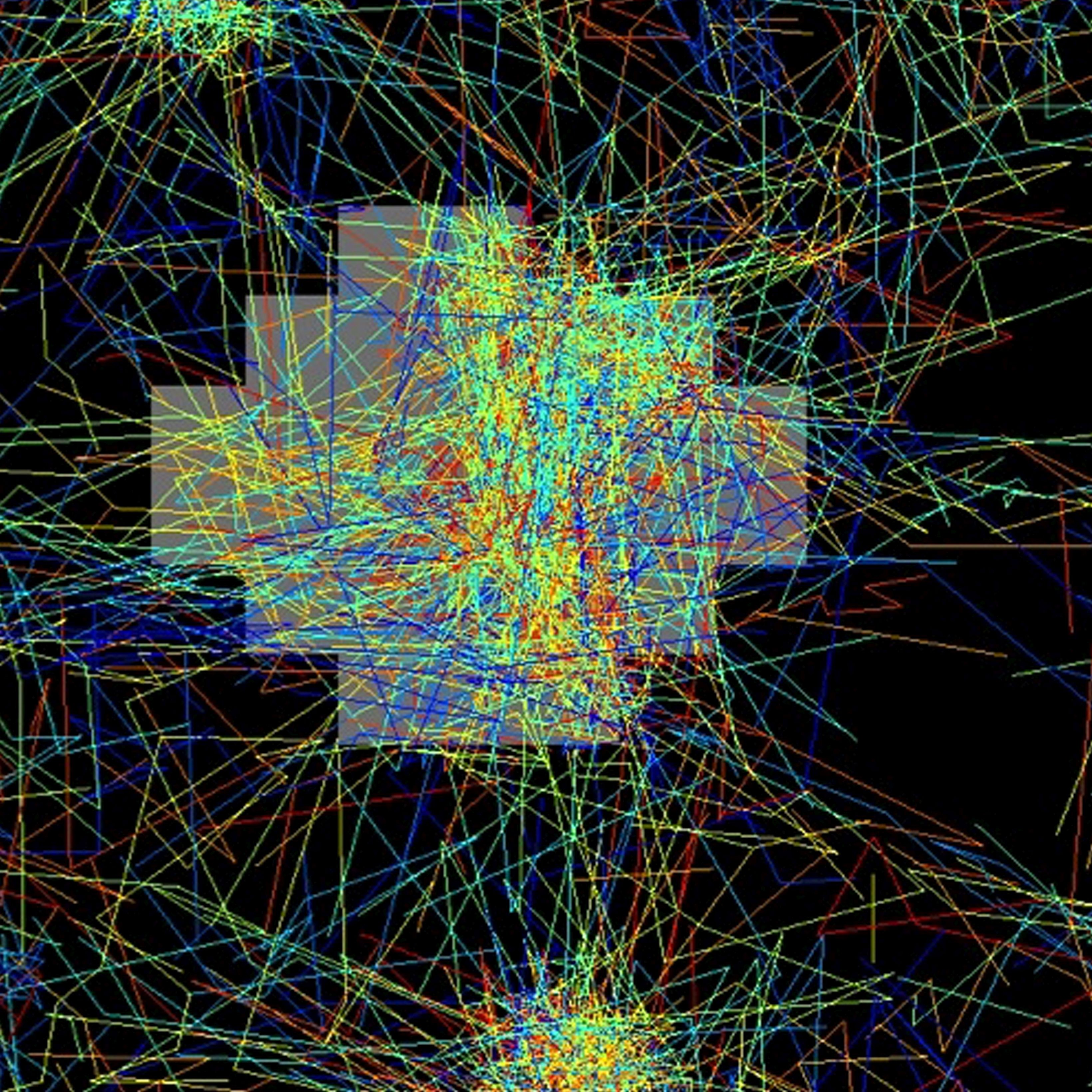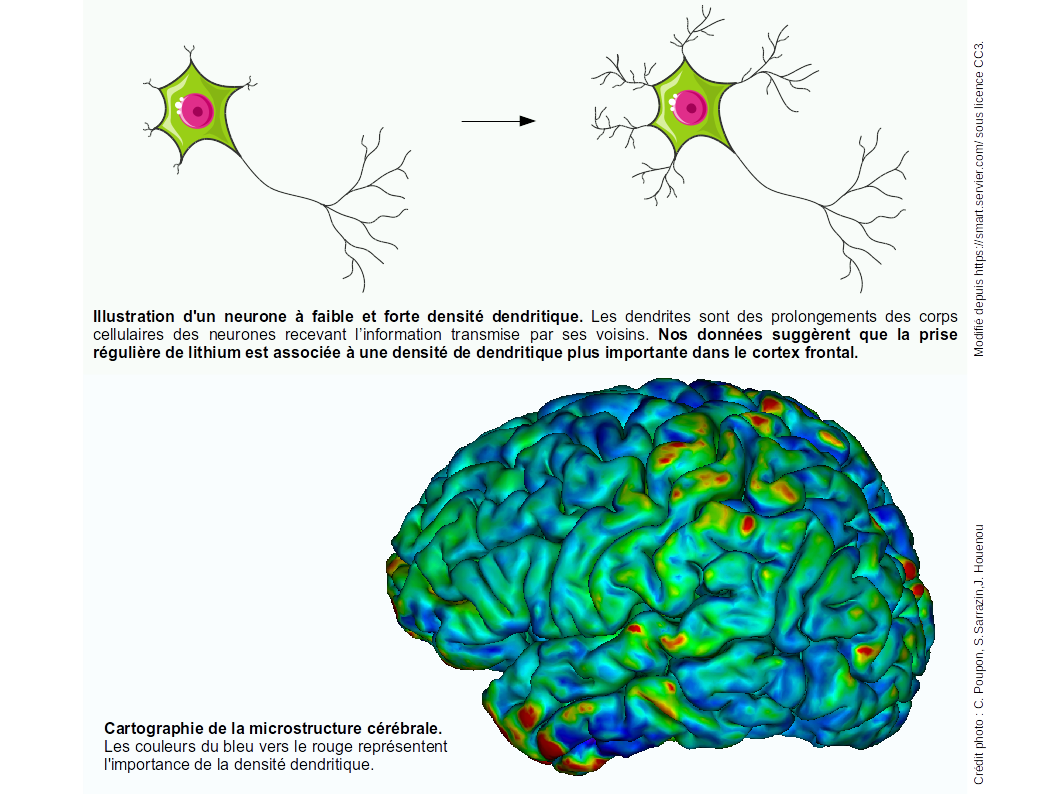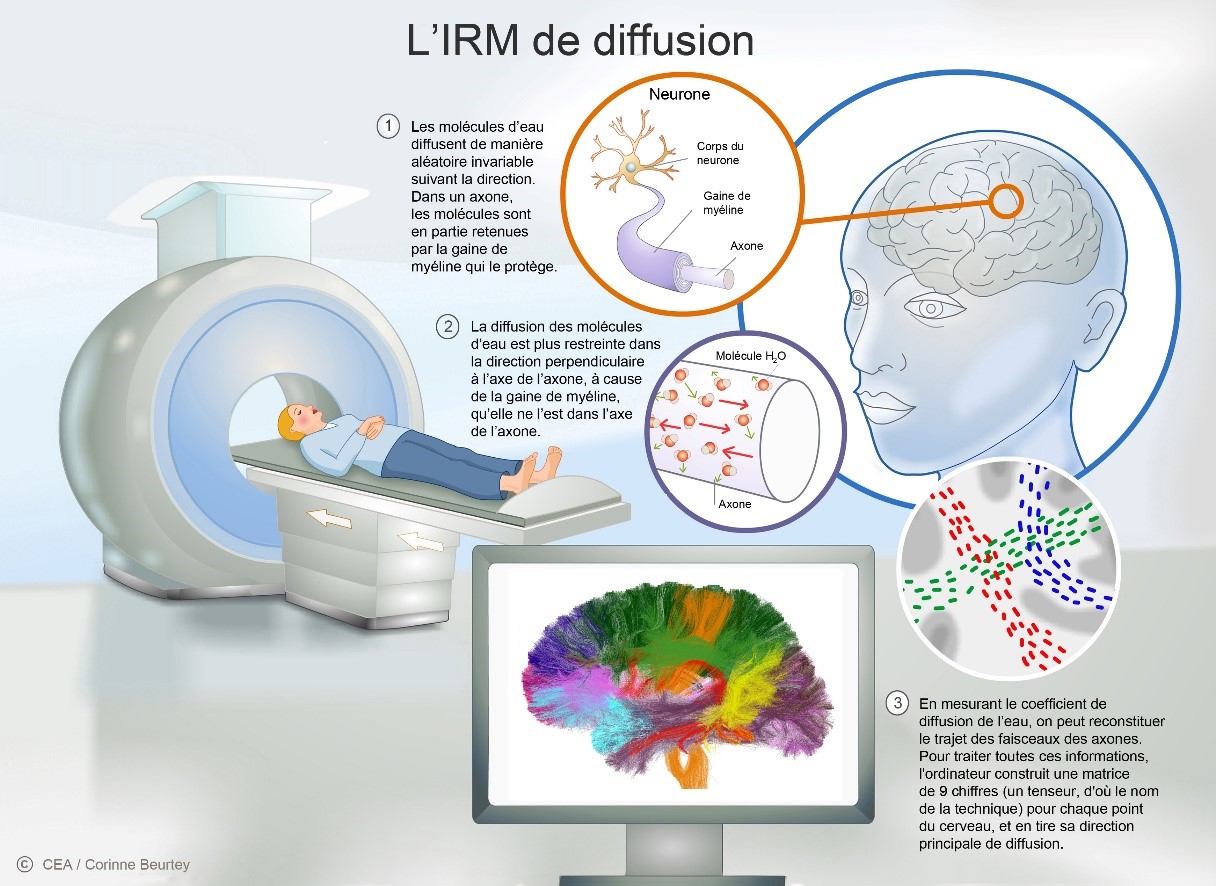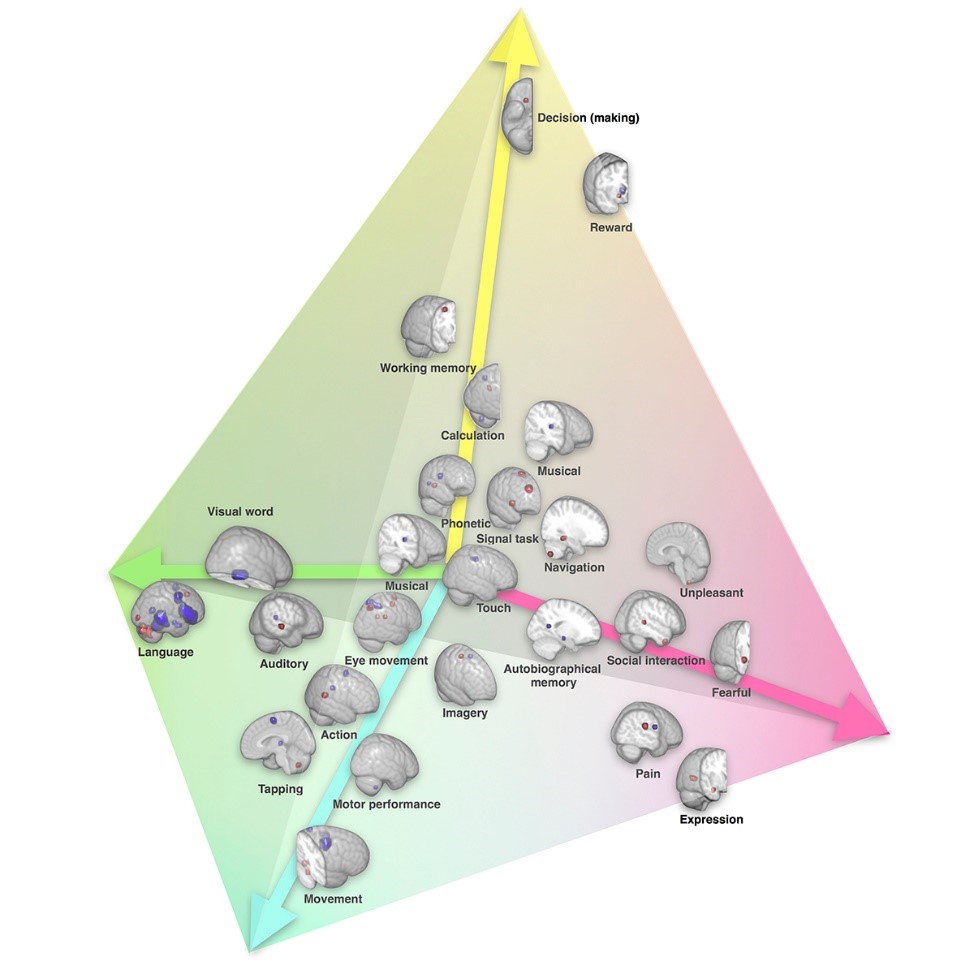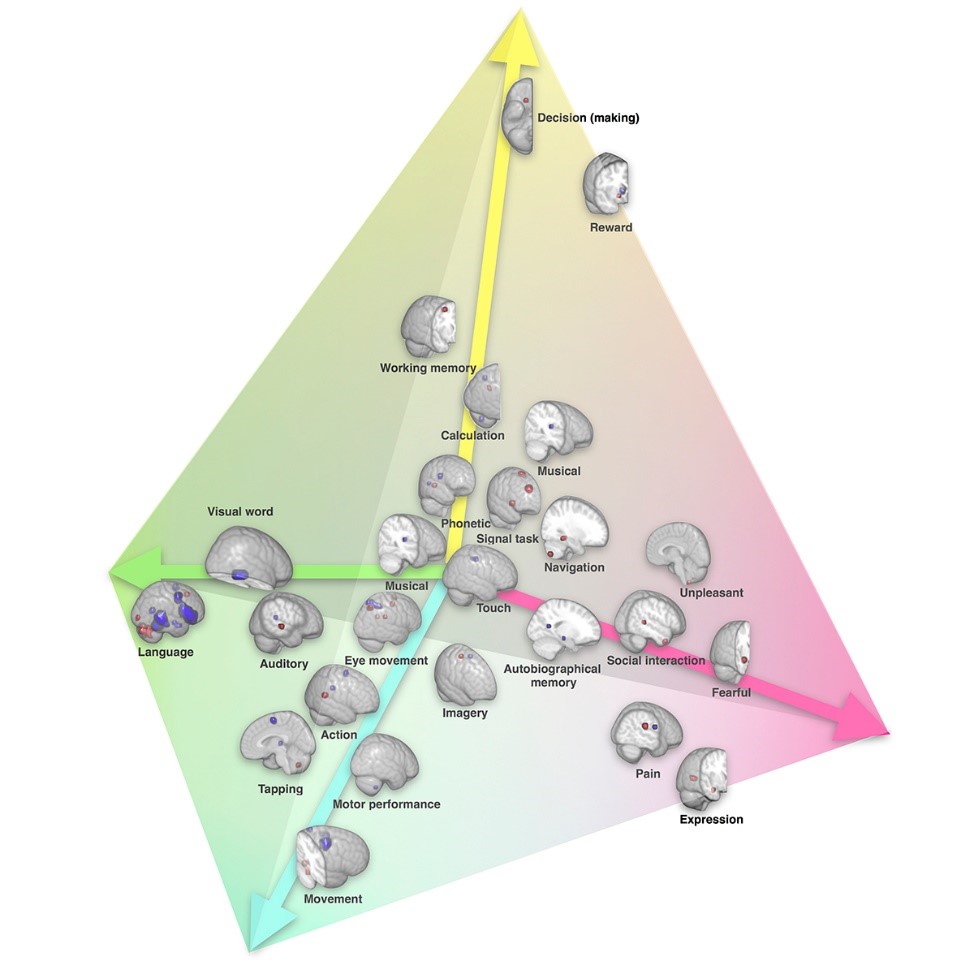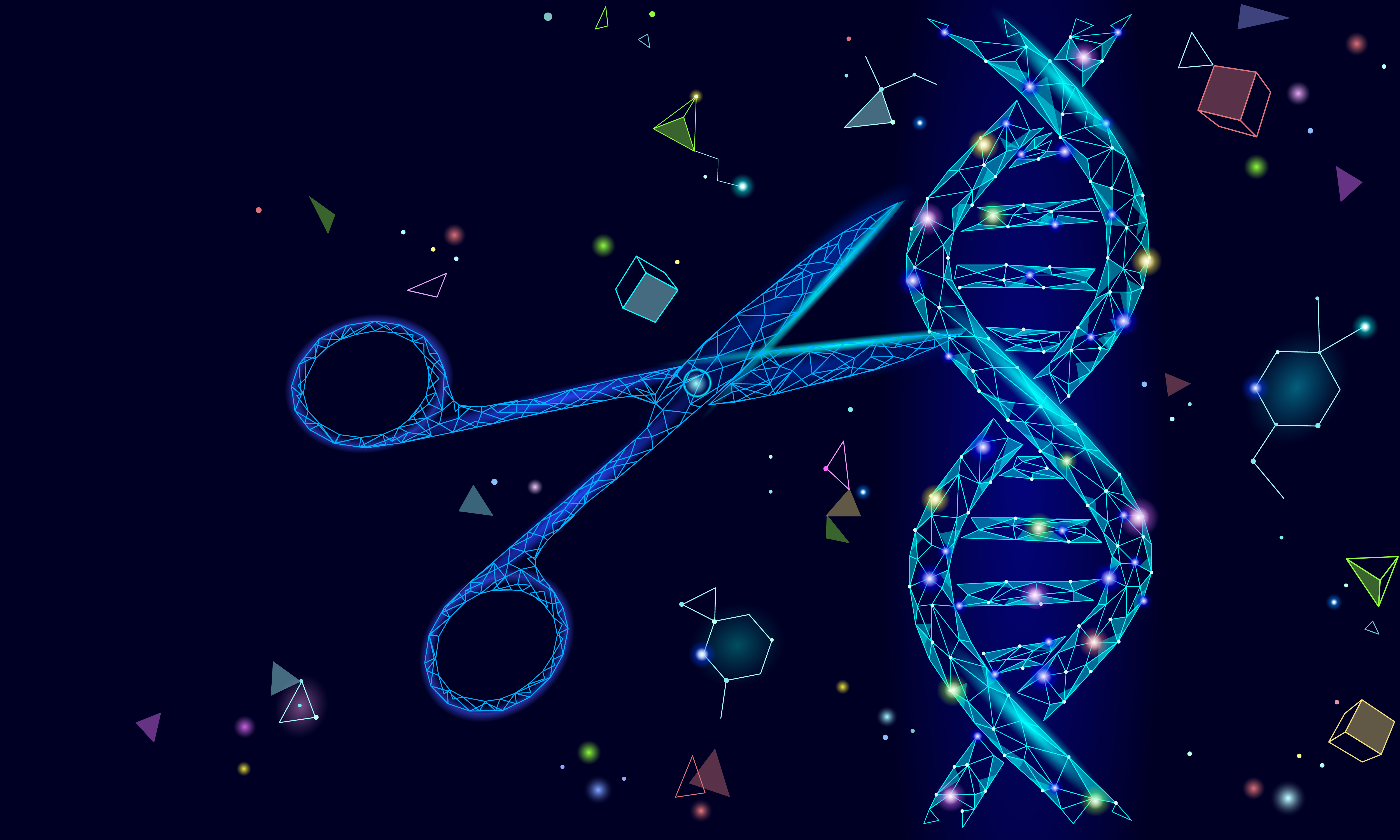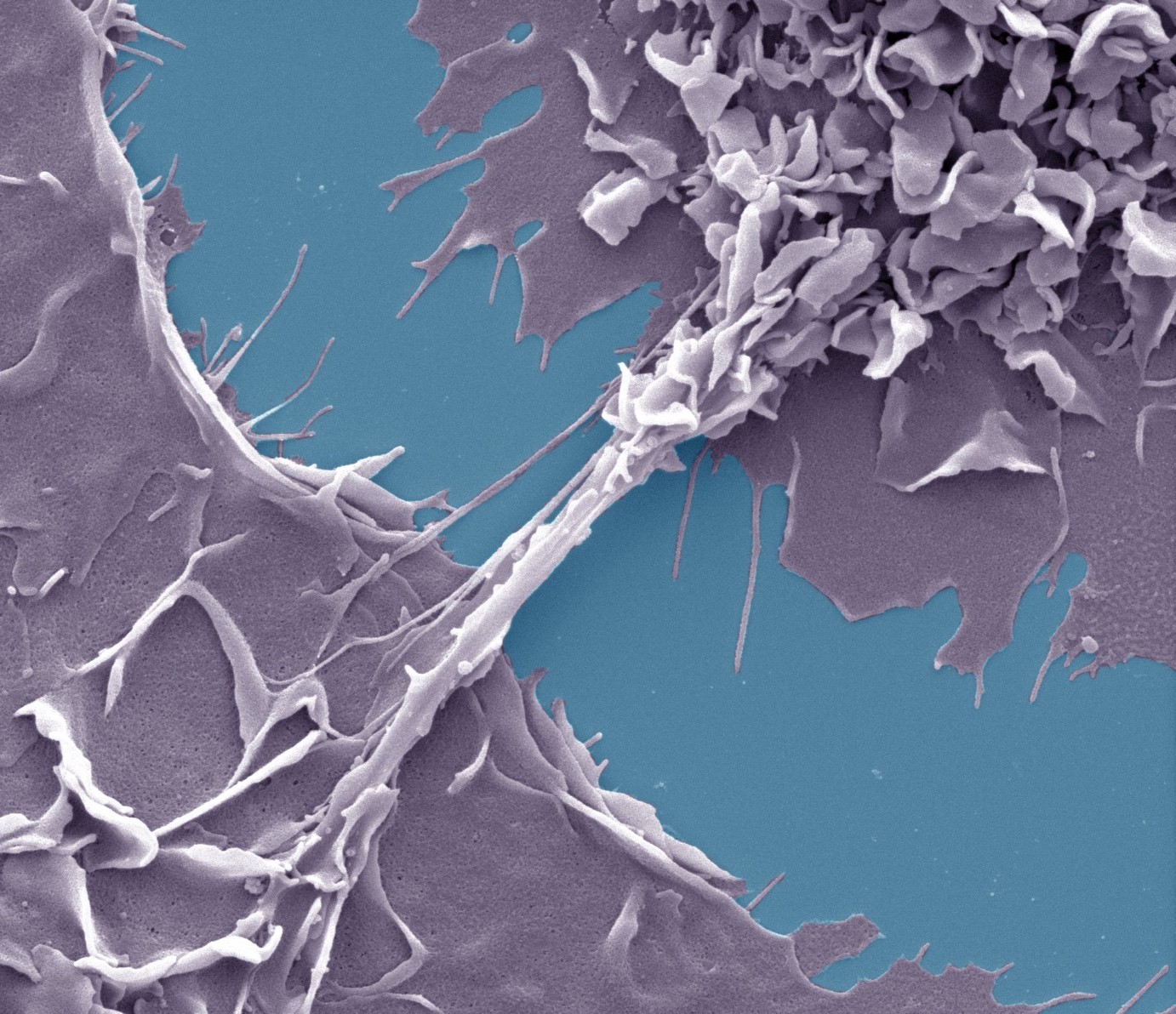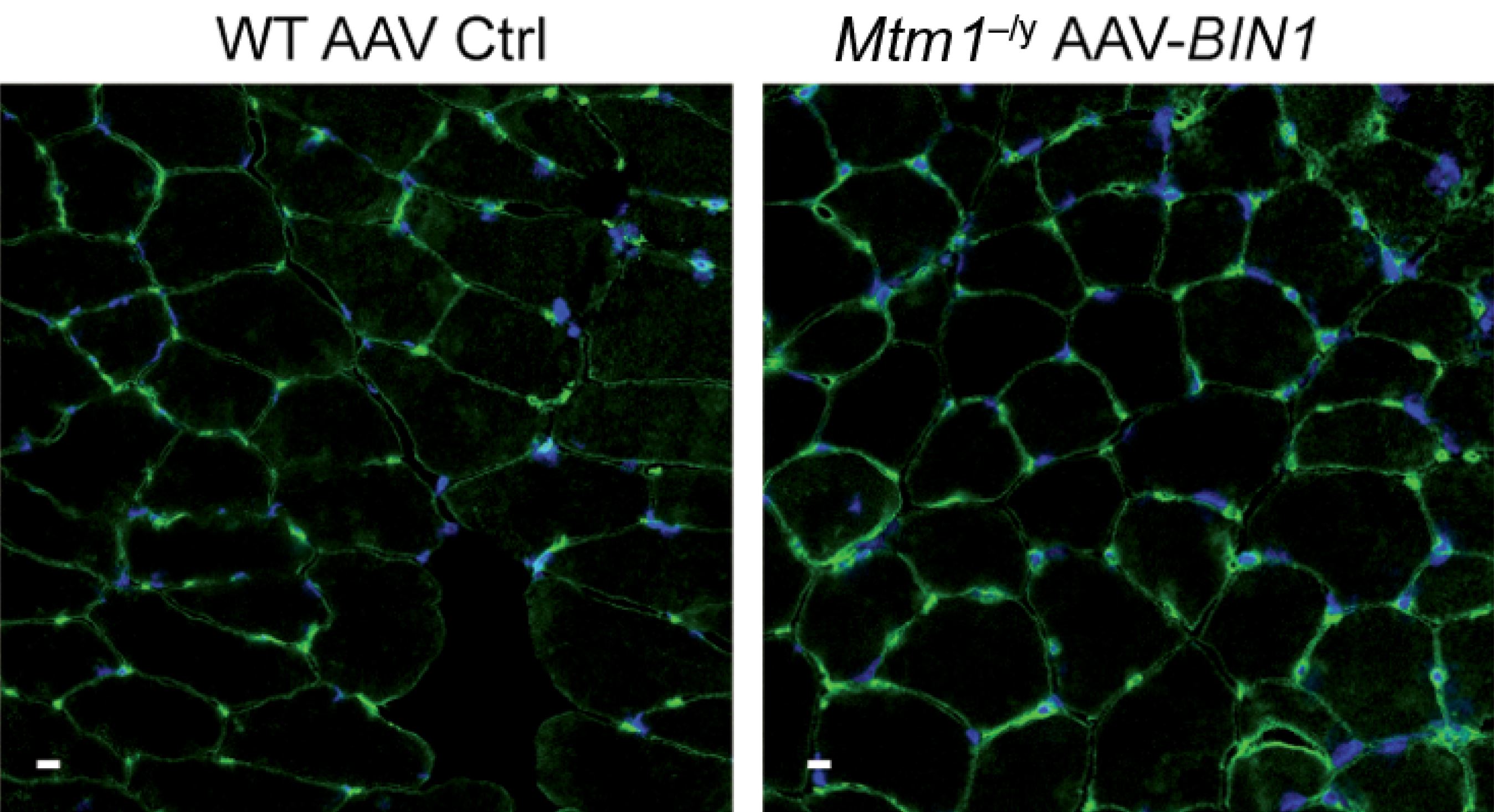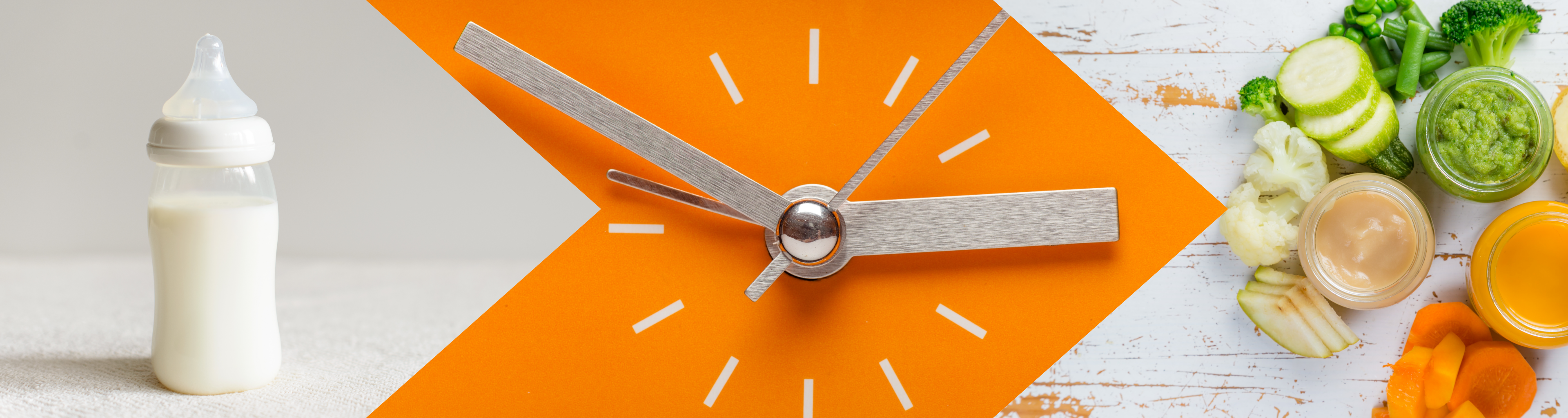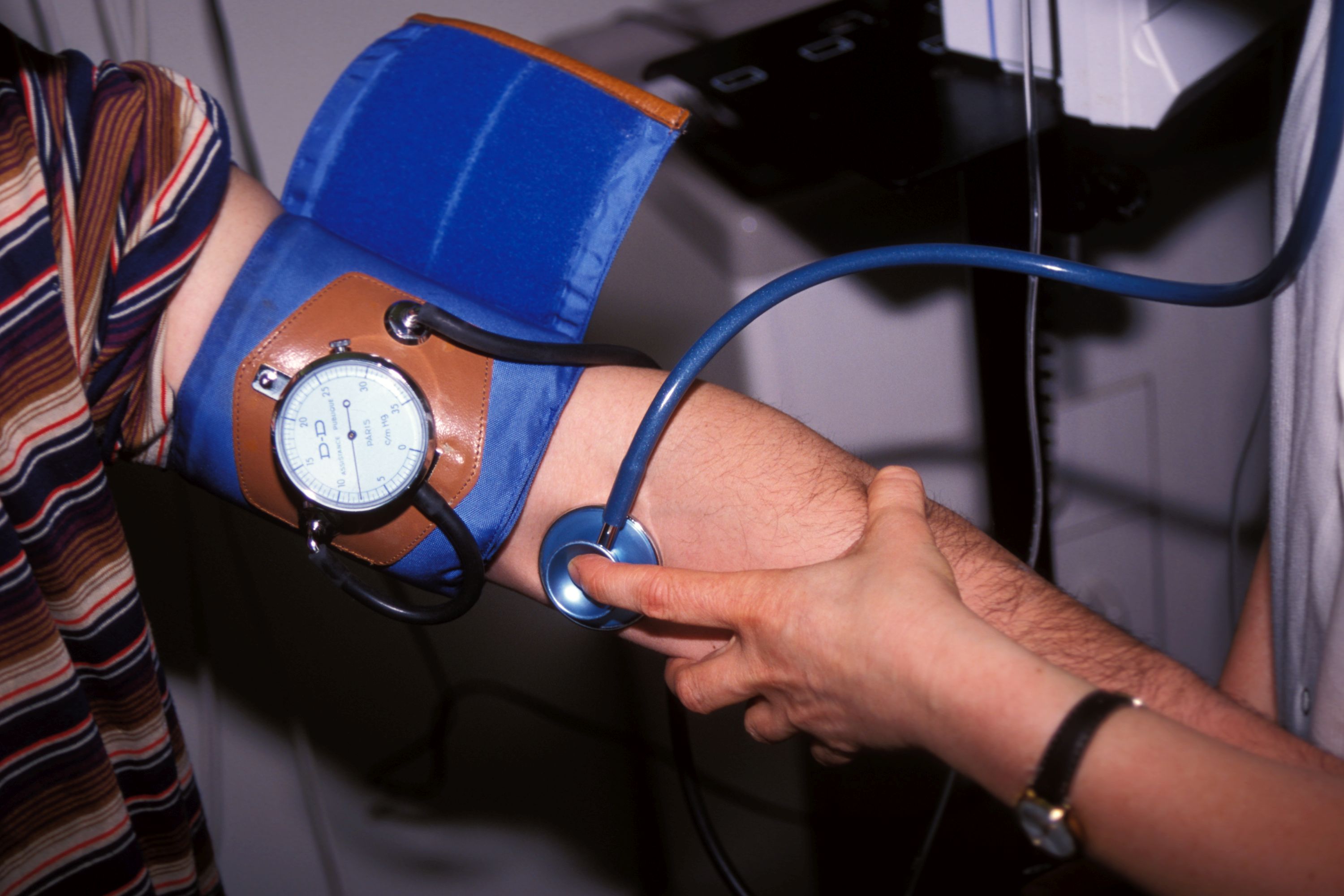
Prise de la tension artérielle chez un patient ©Inserm/Depardieu, Michel
Un essai clinique de phase IIa apporte les premières données d’efficacité du firibastat chez des sujets hypertendus par rapport au placebo. Ce médicament est le chef de file d’une nouvelle classe d’antihypertenseurs qui cible le système rénine-angiotensine cérébral. Cette étude est coordonnée par Michel Azizi du Centre d’investigation clinique 1418 Inserm / hôpital européen Georges-Pompidou AP-HP et du service d’hypertension artérielle du même hôpital et Catherine Llorens-Cortes, directrice de recherche Inserm au sein de l’Unité 1050 » Centre interdisciplinaire de recherche en biologie » au Collège de France. Les résultats parus dans The Journal of Hypertension, ont permis de lancer la phase IIb aux Etats-Unis.
L’hypertension artérielle (HTA) est la maladie chronique la plus fréquente en France. Liée à une pression anormalement élevée du sang dans les vaisseaux sanguins, elle semble anodine car elle est généralement silencieuse. Elle constitue pourtant, lorsqu’elle n’est pas contrôlée, l’une des principales causes de complications cardiovasculaires, cérébrovasculaires ou neurodégénératives (infarctus du myocarde, AVC, maladie d’Alzheimer…). Des mesures hygiéno-diététiques seules, ou le plus souvent associées à un traitement médicamenteux, permettent de normaliser la pression artérielle. Néanmoins, jusque 30 % des patients ne répondent pas, ou insuffisamment, aux traitements actuellement disponibles. Pour y remédier, des approches interventionnelles et de nouvelles cibles thérapeutiques liées à la physiopathologie de la maladie sont à l’étude.
Le développement du firibastat[1] dans la prise en charge de l’hypertension artérielle se poursuit. Ce médicament est le chef de file d’une nouvelle classe thérapeutique qui cible le système rénine-angiotensine cérébral contrôlé par l’angiotensine III. Ce peptide exerce un effet stimulateur sur la pression artérielle dans différents modèles d’hypertension via trois mécanismes. Elle accroit l’activité des neurones qui favorisent la vasoconstriction, elle inhibe le réflexe qui permet d’adapter l’intensité des contractions cardiaques au niveau de la pression artérielle et enfin, elle contribue à la sécrétion accrue de vasopressine, hormone anti-diurétique, dans le sang, réduisant le volume d’urine produit au niveau des reins.
Le firibastat s’oppose à tous ces mécanismes en inhibant spécifiquement l’aminopeptidase A, une enzyme présente dans le cerveau qui produit l’angiotensine III. Ce médicament, pris par voie orale, devient actif dans le cerveau après avoir franchi la barrière hémato-encéphalique. Sa sécurité d’emploi a déjà été testée chez des sujets sains dans deux études cliniques de phase I. Les résultats de l’étude de phase IIa qui viennent de paraître confirment les données de sécurité et apportent les premiers éléments d’efficacité. Cette étude, a inclus 34 patients ayant une pression artérielle ambulatoire diurne comprise entre 135/85 mmHg et 170/105 mmHg. Ils étaient âgés en moyenne de 57 ans (73% d’hommes) et non obèses (IMC moyen 26,8 kg/m2). La moitié d’entre eux a reçu le firibastat pendant quatre semaines puis le placebo pendant quatre autres semaines et l’autre moitié a reçu le traitement dans l’ordre inverse : placebo puis firibastat.
Les résultats attestent d’un meilleur contrôle de la pression artérielle systolique (PAS) sous firibastat après quatre semaines avec une baisse de la PAS de -4,7 mmHg en moyenne contre +0,1 mmHg sous placebo. Néanmoins cette différence n’est pas statistiquement significative. « Cela peut s’expliquer par la taille réduite de l’effectif mais aussi par le fait que les patients inclus avaient une hypertension artérielle modérée, explique Catherine Llorens-Cortes, directrice de recherche Inserm. Le firibastat est un agent anti-hypertenseur et non un hypotenseur ce qui signifie qu’il peut agir sur une hypertension mais n’aura aucun effet sur une tension normale. « Son efficacité devrait donc s’accroitre avec la sévérité de l’hypertension », clarifie la chercheuse. Ce qui semble se confirmer d’ailleurs dans cet essai car la baisse de la PAS ambulatoire a atteint -9,4 mmHg en cas de fortes hypertensions au moment de l’inclusion alors que le bénéfice était moins marqué pour des PAS basales plus faibles. Les auteurs ont par ailleurs vérifié la tolérance à ce médicament et constaté qu’il n’interférait pas avec le système rénine-angiotensine systémique, contrôlé lui par l’angiotensine II.
« Ces résultats encourageants ont donné le feu vert à l’étude de phase IIb qui vient de s’achever aux Etats-Unis. Elle a confirmé l’efficacité du firibrastat chez 254 patients hypertendus en surpoids à haut risque cardiovasculaire après deux mois de traitement, y compris chez les patients afro-américains qui ont le plus souvent une hypertension résistante aux traitements actuellement disponibles. » précise Catherine Llorens Cortes.
[1] En partenariat avec la Société Quantum Genomics avec le soutien de l’ANR : ANR RPIB CLINAPAI et LabCom CARDIOBAPAI»