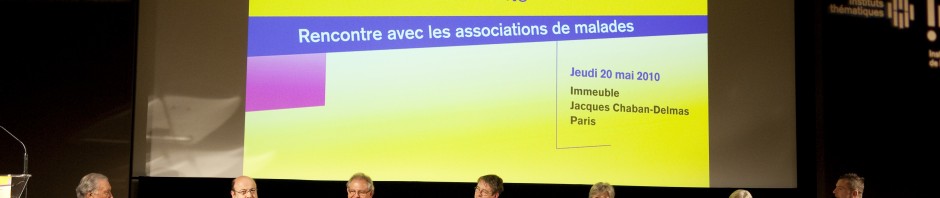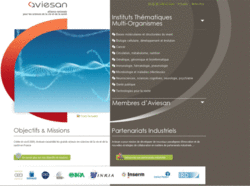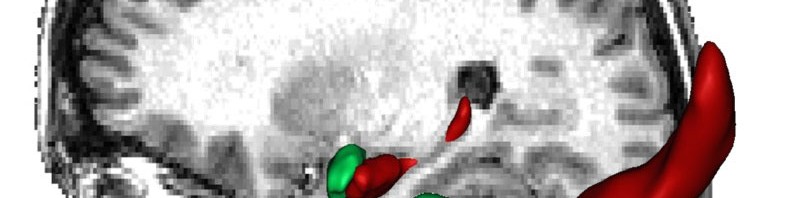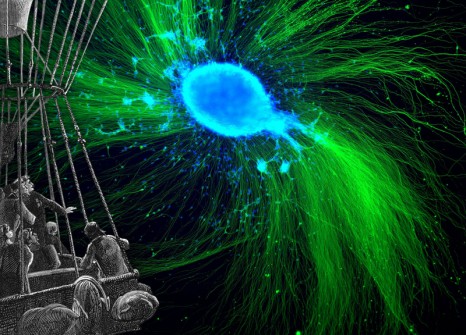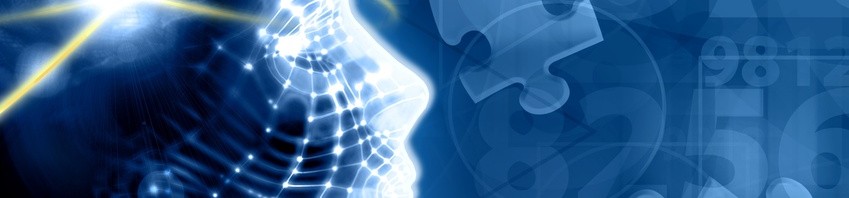Le Professeur Georges Mathé est décédé vendredi 15 octobre 2010 à l’âge de 88 ans. Il a fondé en 1964 puis dirigé pendant 20 ans l’institut de cancérologie et d’immunogénétique en associant l’unité de recherche Inserm 50 « cancérologie et immunogénétique » et le laboratoire 189 du CNRS à l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif. La recherche médicale perd un de ses piliers qui a ouvert le champ de l’immunothérapie. En 1959, il a réalisé la première greffe de moelle osseuse chez l’homme.
Georges Mathé a marqué l’organisation de la recherche en France en participant à la création de l’Inserm en 1964. Il a également contribué à la création, à Lyon, du Centre international de la recherche sur le cancer (CIRC).
Le Professeur Georges Mathé a consacré sa carrière à la recherche médicale en privilégiant l’immunologie et l’hémato-cancérologie, disciplines qui lui ont valu la reconnaissance de la communauté scientifique internationale. Professeur de cancérologie expérimentale à la faculté de médecine de Paris-Sud de 1966 à 1990, chef du service des maladies sanguines et tumorales de l’hôpital Paul-Brousse de 1980 à 1990, ses travaux de recherche ont donné lieu à la publication de plus de 1000 articles et de nombreux ouvrages. Sa contribution à l’immunothérapie s’est traduite par la réalisation de greffes de moelle osseuse sur 6 physiciens yougoslaves accidentellement irradiés dans une centrale nucléaire. Cette première chez l’homme a initié les greffes sur des patients leucémiques.
Conseiller auprès de Raymond Marcellin, ministre de la Santé publique, Georges Mathé a participé à la création de l’Inserm et à l’élaboration de ses statuts en 1964. Par la suite, il a été de nombreuses fois membre et président des instances scientifiques de l’Inserm. Vice-président du conseil d’administration de 1972 à 1973, il a ensuite présidé la commission scientifique spécialisée de l’Inserm (CSS) “Biologie et pathologie cellulaires, hématologie cellulaire, cancer” de 1974 à 1979.
Au cours de sa carrière, il n’a cessé de recevoir des distinctions de la part de la communauté scientifique. En 1994, il a obtenu le prix Léopold-Griffuel, une récompense prestigieuse en France dans le domaine de la cancérologie. En 2002, il recevait le Prix Medawar de la Société internationale de transplantation pour récompenser le rôle pionnier de ses travaux sur la moelle osseuse. En 2007, pour honorer ses recherches en cancérologie, un centre anticancéreux portant son nom a été inauguré à Belgrade (Serbie).
André Syrota, Président-Directeur Général de l’Inserm, salue “non seulement le scientifique de renom que fut Georges Mathé, mais aussi celui qui a activement contribué au renouveau de la recherche médicale française”.
Professeur Georges Mathé (à gauche) lors de l’inauguration, du centre anticancéreux qui porte son nom (Belgrade, 2007)