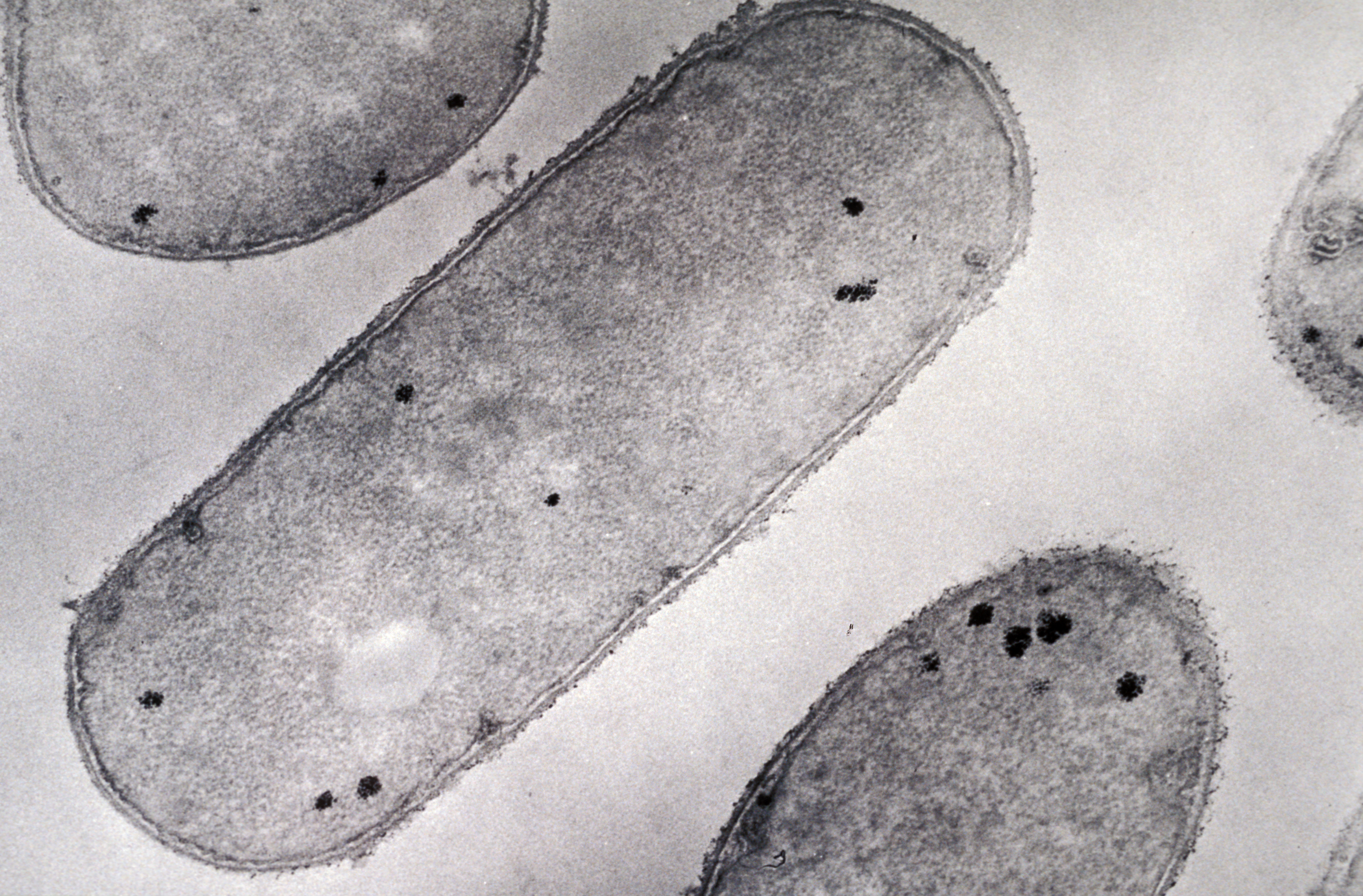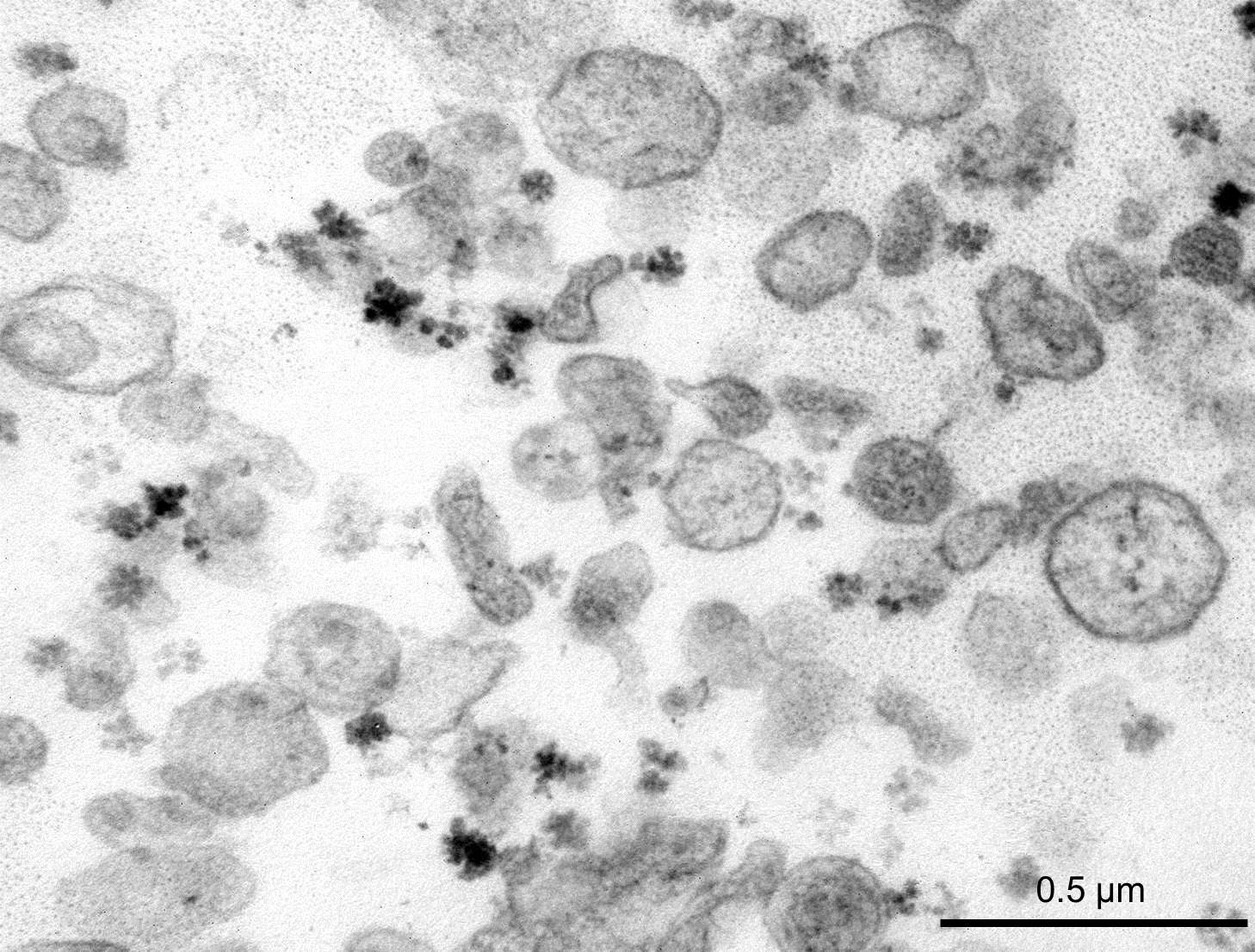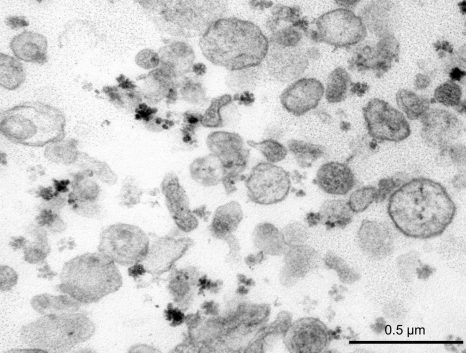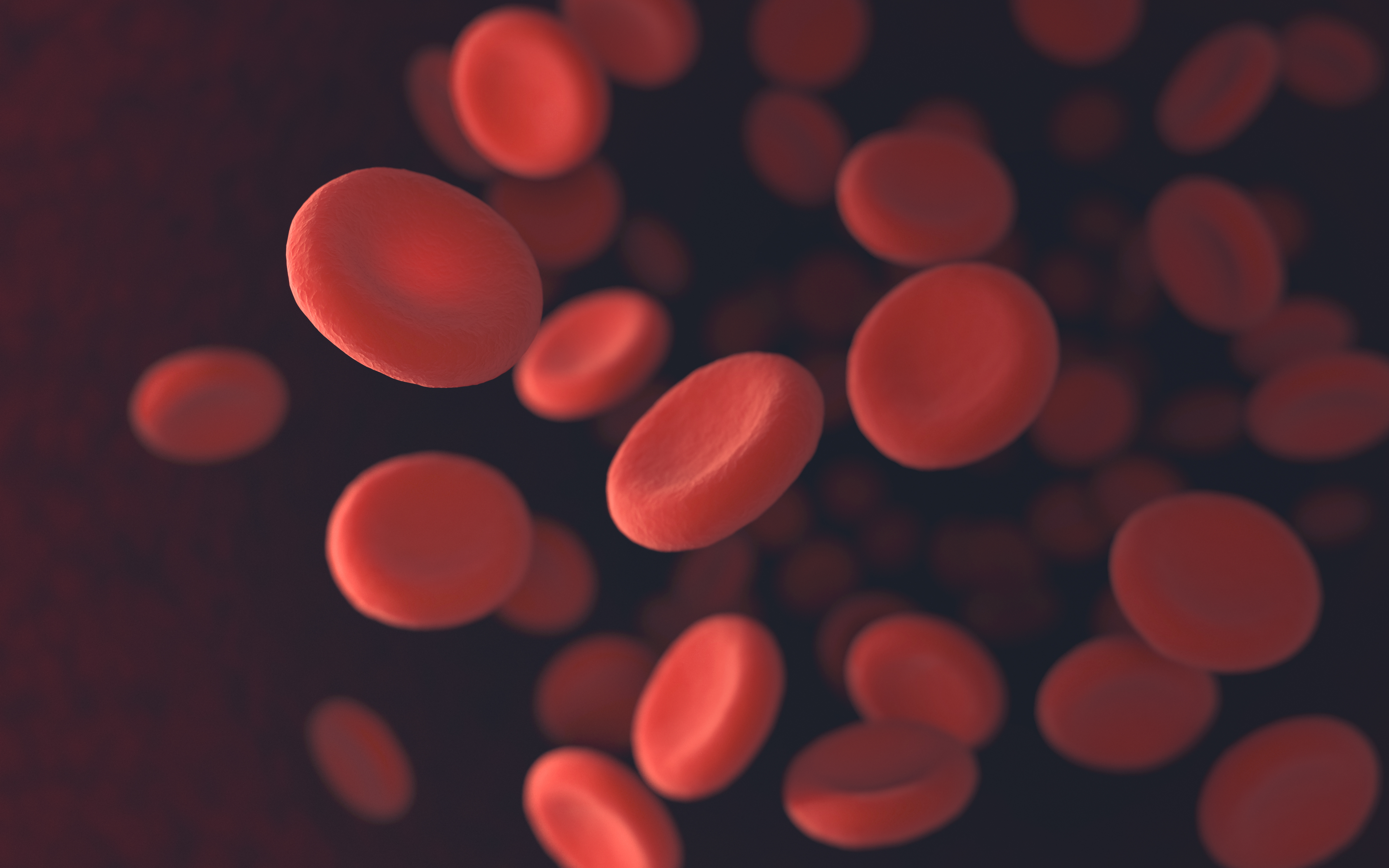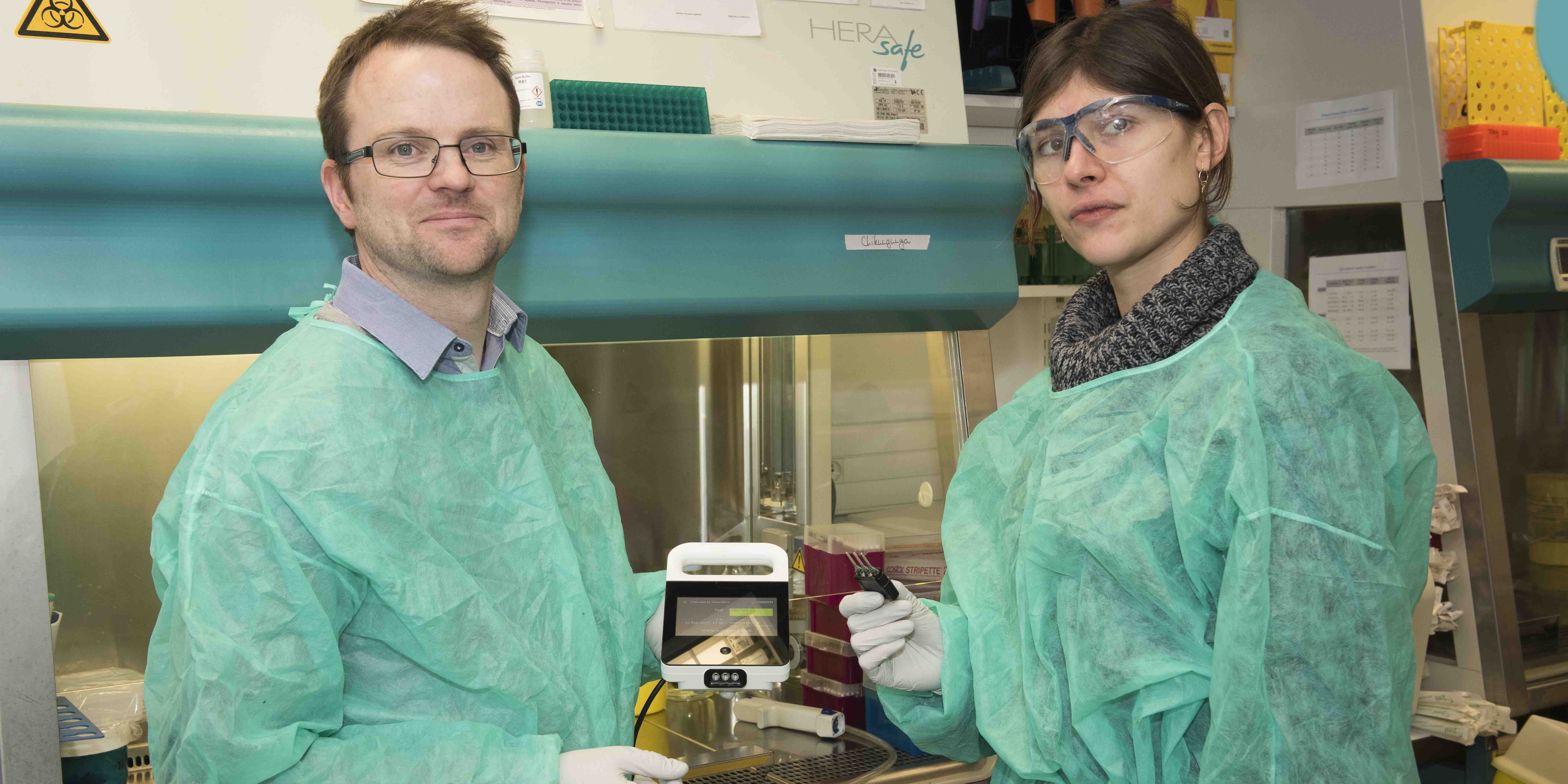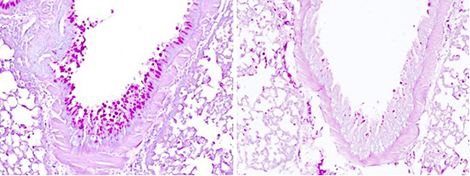Crédits: AdobeStock
Un passage aux urgences n’est pas anodin. Quelle que soit la raison pour laquelle une personne s’y présente, environ 1 sur 5 souffrira pendant plusieurs mois de symptômes divers (maux de tête, difficulté à se concentrer, irritabilité, troubles sensoriels …). Afin d’agir sur ce phénomène, les chercheurs de l’Inserm de l’Unité 1219 « Bordeaux Population Health center « , ont montré les bénéfices d’une séance précoce d’EMDR réalisée dans les 6 heures suivant l’événement ayant conduit aux urgences. Ces séances sont efficaces pour diminuer jusqu’à 75% les syndromes post-commotionnels et les troubles de stress post-traumatique. Ces résultats sont publiés dans The Journal of Psychiatric Research.
D’après une étude menée en 2012, plus de 10 millions de personnes fréquentent les services d’urgences en France chaque année. Si l’on prend en considération les passages multiples, ce sont 18 millions de visites qui sont comptabilisées par an. Environ 10 à 20% des patients souffriront pendant plusieurs mois de symptômes persistants très divers (maux de tête, difficulté à se concentrer, irritabilité, troubles sensoriels …), dégradant significativement leur qualité de vie. Cela représente un enjeu de santé publique majeur puisque environ un million de personnes sont concernées chaque année. Parce que ces symptômes ont été initialement décrits chez des personnes souffrant de commotions cérébrales, leur persistance sur plusieurs mois est connue sous le nom de syndrome post-commotionnel. Environ 5% de ces patients souffrent également d’un trouble assez proche : le trouble de stress post-traumatique, qui se traduit par des symptômes décrits classiquement chez des personnes ayant vécu une situation durant laquelle leur intégrité physique ou psychologique ou celle de son entourage a été menacée ou atteinte.
Les chercheurs Inserm du centre de recherche « Bordeaux Population Health », du CHU de Bordeaux et du centre hospitalier de Cadillac ont remarqué, lors d’investigations menées depuis 2007, que les niveaux de stress de ces patients étaient particulièrement élevés. Ils se sont demandé s’il était possible de les faire baisser, avec comme objectif ultime de prévenir la survenue de ces symptômes invalidants.
Un protocole de prise en charge adapté aux Urgences
Ils ont conduit pour cela une nouvelle étude, dans le but d’évaluer la faisabilité et l’efficacité d’une approche thérapeutique reconnue, l’EMDR (en français « désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires»), pour laquelle ils ont adapté un protocole administrable dans le contexte d’un service d’urgences. Lors de la séance d’EMDR aux urgences, on demande au patient de porter attention aux éléments qui les placent dans un état de stress, et à leur ressenti physique, émotionnel et sensoriel. Ce faisant, le thérapeute effectue des séries de stimulations bilatérales alternées, consistant en des mouvements oculaires (balayage horizontal ou vertical) ou, lorsque l’état clinique du patient ne le permet pas, des tapotements alternés des genoux ou des épaules.
Ce modèle psychothérapeutique est l’une des deux thérapies recommandées par la Haute Autorité de Santé (HAS), l’OMS et l’Inserm dans la prise en charge du trouble de stress post-traumatique. La durée du traitement est habituellement variable (2 à plusieurs séances). Pour la présente étude, il s’agit de prévenir l’apparition des manifestations du syndrome post-commotionnel et du trouble de stress post-traumatique, en utilisant un protocole d’intervention précoce (dans les 6 heures suivant l’événement ayant conduit aux urgences), unique (une seule séance lors de la consultation aux urgences) et bref (une heure maximum). L’étude a consisté à inclure des patients évalués comme étant à haut risque de développer ces deux troubles (le fait d’avoir eu recours à des antidépresseurs, d’avoir eu une mauvaise santé au cours de l’année et le genre féminin étaient les facteurs prédictifs principaux).
Des patients traités par EMDR bien moins sujets aux troubles post traumatique que les autres
130 patients ont été ainsi sélectionnés et ont accepté de participer à l’étude. Ils ont par la suite été répartis au hasard en trois groupes : le premier bénéficiait d’une séance d’EMDR de 60 minutes, le deuxième d’un entretien de 15 minutes avec un psychologue tandis que le troisième ne recevait pas de prise en charge psychologique.
Les patients étaient ensuite contactés par téléphone trois mois plus tard, afin d’identifier ceux qui avaient développé un syndrome post-commotionnel, ou un trouble de stress post-traumatique.
Dans les trois groupes les proportions de patients souffrant de syndrome post-commotionnel trois mois plus tard étaient respectivement de 15%, 47% et 65%. La proportion de patients présentant un trouble de stress post-traumatique était de 3%, 16% et 19%.
« Il s’agit du premier essai contrôlé randomisé mondial qui montre qu’une intervention EMDR brève et ultra-précoce est, d’une part réalisable dans le contexte des urgences et d’autre part potentiellement efficace. » estime Emmanuel Lagarde, directeur de recherche Inserm. Ces résultats restent à confirmer par une nouvelle étude de plus grande ampleur. Une telle étude a été initiée en janvier 2018 par la même équipe aux CHU de Lyon et de Bordeaux, auprès de plus de 400 patients. Ses résultats seront connus avant la fin de l’année 2018.