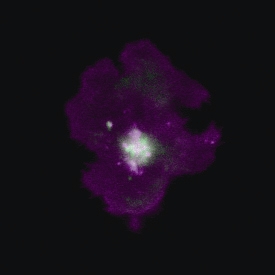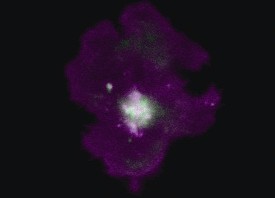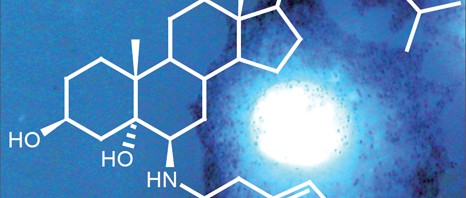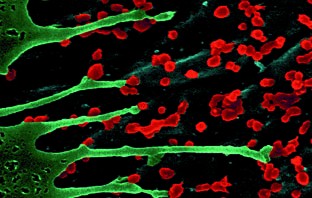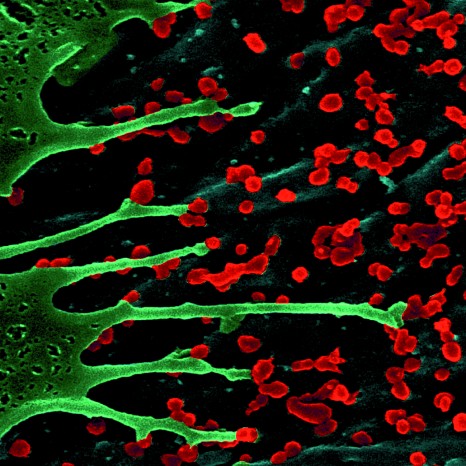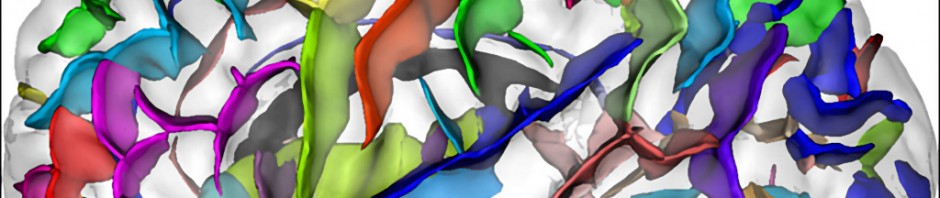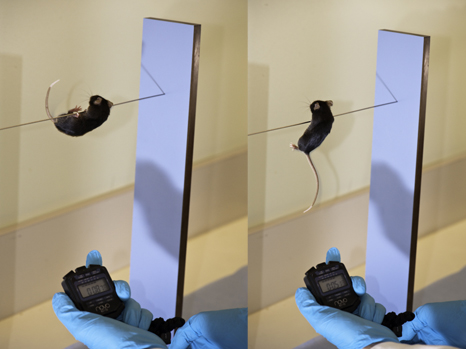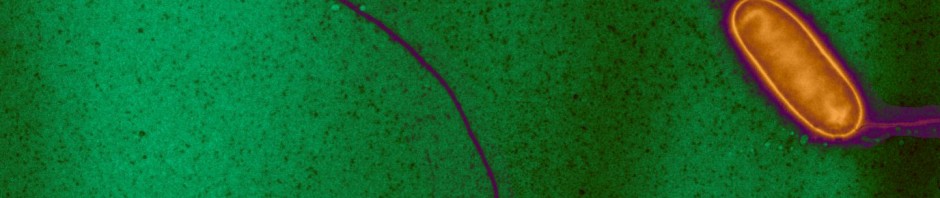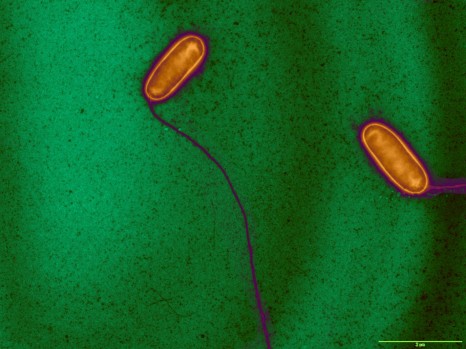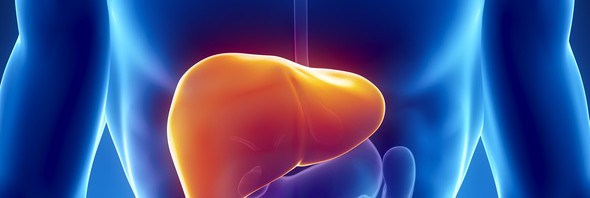A l’occasion du comité de suivi annuel du schéma national pour les handicaps rares qui s’est tenu le 30 avril 2013, et a été présidé par Mme Marie-Arlette Carlotti, Ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, l’Inserm rend publique l’expertise collective « Handicaps rares, contextes, enjeux et perspectives. »

Dans le cadre du Schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les Handicaps Rares 2009-2013, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a sollicité l’Inserm pour la réalisation d’une expertise collective sur la question des handicaps rares.
L’objectif était de mieux connaître les difficultés rencontrées par les personnes atteintes de handicaps rares et mieux répondre à ces situations, réparties en petit nombre sur le territoire national.
Le terme de « handicaps rares » a été introduit dans la législation française pour prendre en compte, dans l’organisation du secteur médico-social, la situation des personnes (enfants ou adultes) atteintes de deux déficiences ou plus et dont la prise en charge requiert le recours à des compétences très spécialisées. Les textes réglementaires définissent les handicaps rares par une faible prévalence (inférieure à 1 cas pour 10 000 habitants), une combinaison de déficiences et de limitations nécessitant une prise en charge complexe pour laquelle il existe peu d’expertise d’intervention (au niveau de la détection, de l’évaluation fonctionnelle et de l’accompagnement).
La démarche proposée au groupe d’experts sollicité par l’Inserm, a été d’aborder, sous un angle à la fois clinique et scientifique, plusieurs configurations illustratives (surdicécité, maladie de Huntington, association d’épilepsie et d’autisme, polyhandicaps sévères) pouvant servir de « modèles » et aider à conceptualiser une problématique de prise en charge des handicaps rares. Il a été également recherché les spécificités et points communs aux différentes situations de handicaps rares : (historique de la notion, référence aux classifications internationales) ; données de prévalence ; stratégies d’intervention (éducation et scolarité, accompagnement des familles, communication et langage, coût des prises en charge…).
Principaux constats et recommandations
1. La notion de handicaps rares a été introduite dans la politique du handicap en France pour prendre en compte les personnes ne bénéficiant pas d’accompagnement adapté au regard de la spécificité de leurs besoins. Mais, le terme de handicaps rares n’a pas d’équivalent stabilisé dans le contexte international et la notion de handicaps rares questionne les modèles conceptuels du handicap en général qui sous-tendent les définitions réglementaires françaises.
L’expertise recommande de construire une définition évolutive des handicaps rares qui permette l’intégration de nouvelles configurations en fonction des contextes socio-politiques différents et qui reflète la multi-dimensionnalité de ces formes de handicap (déficiences de fonctions, limitations d’activité, restrictions de participation sociale en fonction des environnements).
La Classification internationale du fonctionnement (CIF), du handicap et de la santé constitue aujourd’hui un cadre de référence qui permettrait de caractériser les handicaps rares.
2 Les données épidémiologiques disponibles en France sont parcellaires et portent principalement sur des associations de déficiences sensorielles. La littérature internationale rapporte, pour l’essentiel, des données de prévalence concernant des handicaps rares dont l’étiologie est précisée et qui relèvent également du champ des maladies rares.
La mise en place de registres ou de bases de données populationnelles européens ou internationaux paraît indispensable pour disposer d’une assise de population adaptée à l’étude de groupes de patients de taille aussi limitée.
3 L’identification des situations de handicaps rares ainsi que l’évaluation des déficiences et des capacités des personnes restent difficiles à appréhender. Cependant, la France a mis en place un dispositif organisationnel original d’accompagnement des personnes et des professionnels avec les Centres de ressources nationaux handicaps rares. Pour renforcer ce dispositif, l’expertise propose de :
• améliorer la visibilité, l’accessibilité et l’efficacité des dispositifs existants ;
• mettre en place une personne ou une équipe référente « handicaps rares » par inter-région ;
• renforcer la mission de mutualisation des connaissances du Groupement national de coopération handicaps rares ;
• sensibiliser les professionnels de santé, de l’éducation et du champ médico-social à l’identification des personnes présentant un handicap rare.
4 L’accompagnement peut se construire sur les influences réciproques entre la recherche médicale, les professionnels et l’expérience des sujets et de l’entourage proche. Les stratégies d’intervention et leur qualité reposent sur la capacité des proches, des aidants et des professionnels à développer un partenariat et à intégrer des connaissances générales sur les handicaps, mais aussi des données individuelles (notamment les stratégies adaptatives développées par la personne), et sur la capacité d’ouverture et de créativité nécessaires à l’exploration de voies nouvelles et ajustées d’accompagnement.
La scolarisation des enfants présentant un handicap rare suppose un système inclusif capable de répondre aux besoins éducatifs de chacun. Le mode de scolarisation des enfants « à besoins éducatifs particuliers » dépend des conceptions de l’éducation et du handicap. Des approches éducatives ajustées aux situations complexes existent.
Les familles sont quotidiennement confrontées à des difficultés sur le plan pratique, psychologique, et social. De nombreux écrits soulignent la nécessité d’une co-construction de l’intervention par les professionnels et les familles et associant si possible, les personnes handicapées.
D’une façon générale, il est apparu au groupe d’experts que la notion « handicaps rares » questionne les pratiques et les connaissances, son historique montre que sa définition est intrinsèquement liée à une réflexion et une critique des prises en charge existant dans le champ du handicap.
La question des handicaps rares incite à modifier et innover les pratiques d’accompagnement dans le sens d’une plus grande cohérence, avec comme objectif de contribuer au bien-être des personnes et au respect de leurs droits, ce qui pourra avoir un impact bénéfique pour l’ensemble des personnes en situation de handicap.
Groupe d’experts et auteurs
Claire AMIET, Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière AP-HP, Paris
Catherine ARNAUD, UMR 1027 Inserm, Université Toulouse III, Unité d’épidémiologie clinique, Centre hospitalier universitaire, Toulouse
Anne-Catherine BACHOUD-LÉVI, Inserm U 955 E01 IMRB- UPEC, Créteil-IEC ENS, Paris et AP-HP, Centre de Référence Maladie de Huntington, Hôpital Henri Mondor, Créteil
Catherine BARRAL, Maison des sciences sociales du handicap, Ecole des hautes études en santé publique (MSSH-EHESP), Paris
Jean-Jacques DETRAUX, Département de Psychologie, cognition et comportement, Université de Liège, Belgique
Karine DUVIGNAU, Sciences du langage, Université de Toulouse 2, Ecole interne IUFM et CLLE-ERSS, Toulouse
Serge EBERSOLD, Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité, les pratiques éducatives et scolaires (GRHAPES-EA 7287), Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’Éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INS HEA), Suresnes et Université de Strasbourg
Agnès GRAMAIN, Institut des sciences sociales du travail (ISST) et Centre d’économie de la Sorbonne, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris
Régine SCELLES, Laboratoire psychologie et neurosciences de la cognition et de l’affectivité, Université de Rouen
Jacques SOURIAU, ancien directeur du Centre de ressource expérimental pour enfants et adultes sourdaveugles et sourds-malvoyants (Cresam), Saint-Benoit, et Université de Gröningen, Pays-Bas
Myriam WINANCE, Cermes-3, Inserm U 988, CNRS UMR 8211, EHESS, Université Paris Descartes, Villejuif