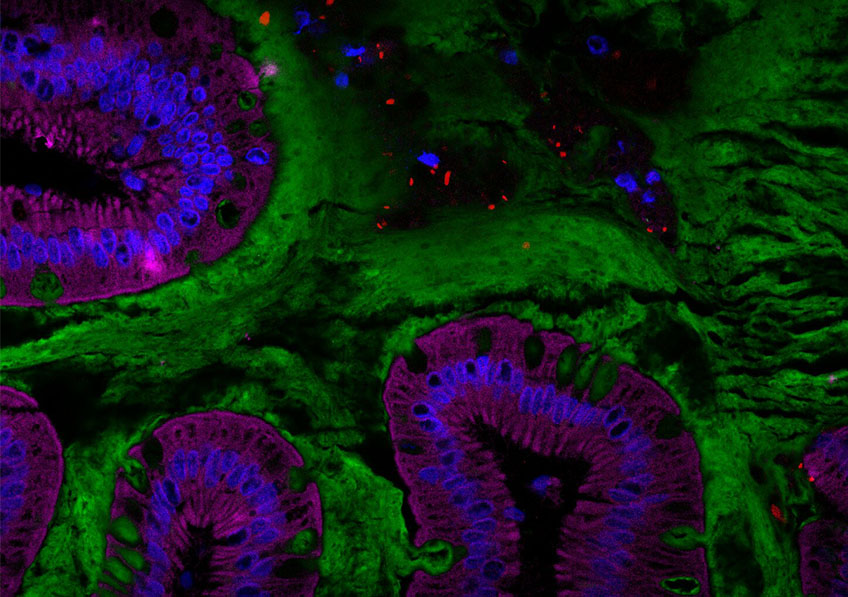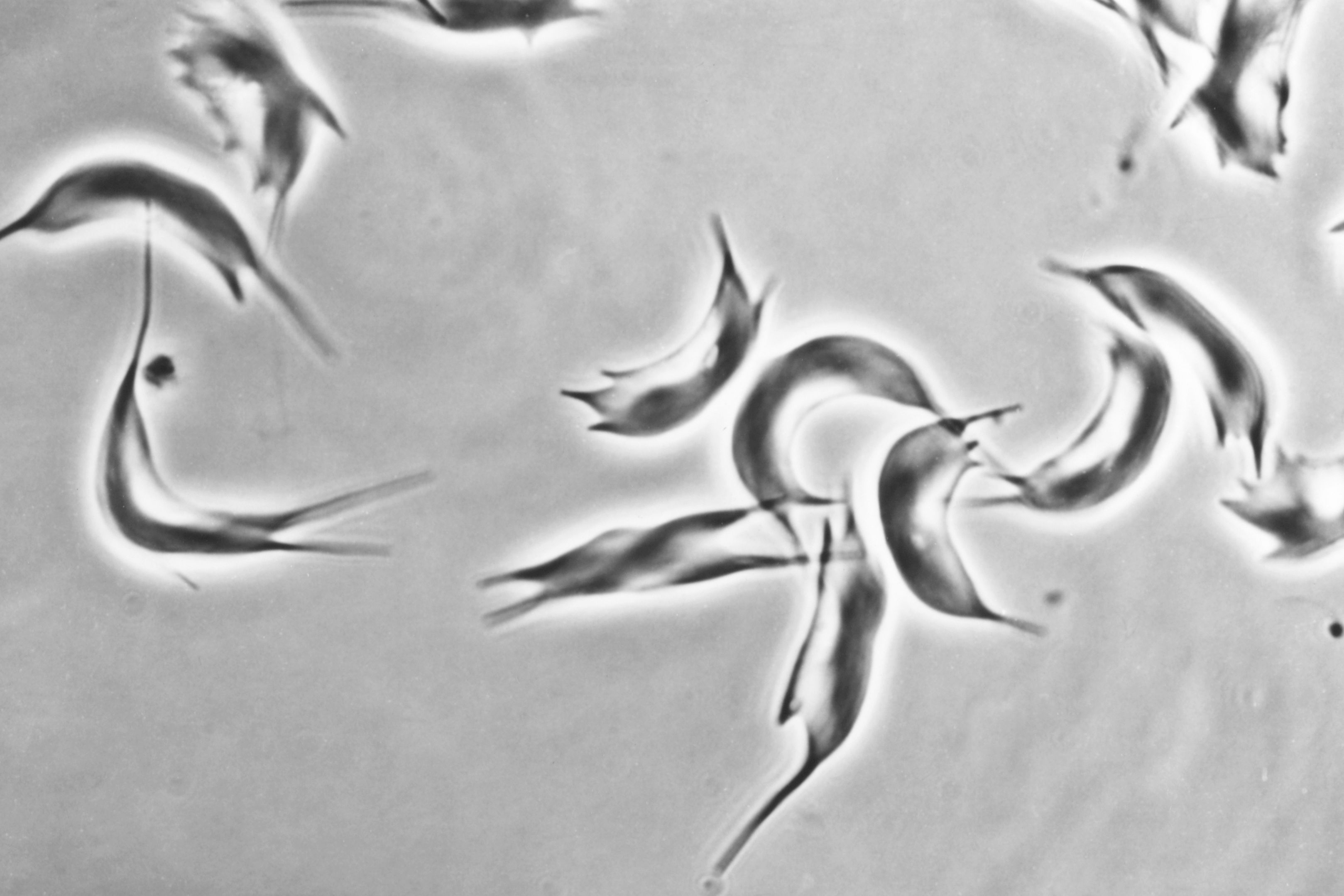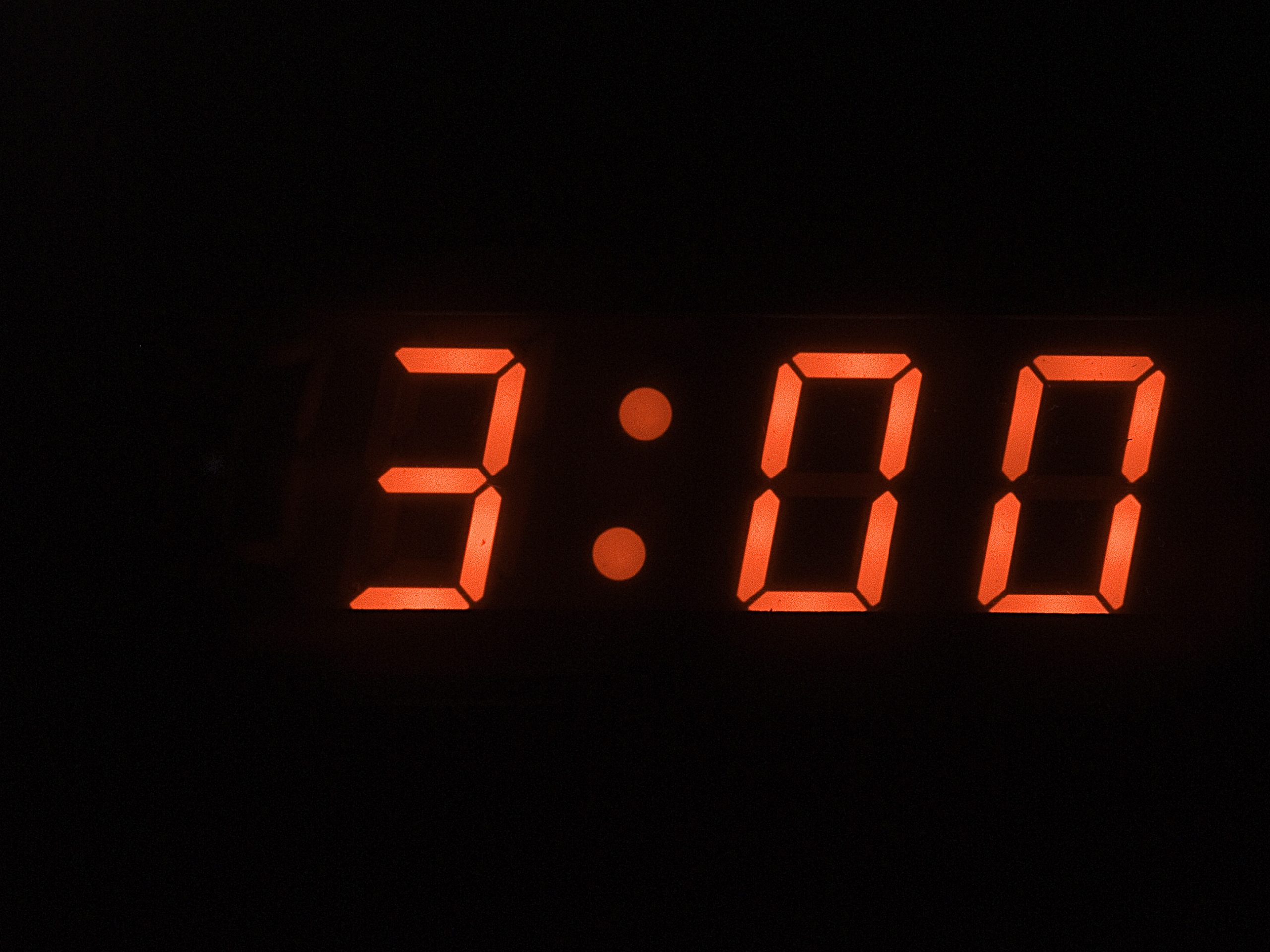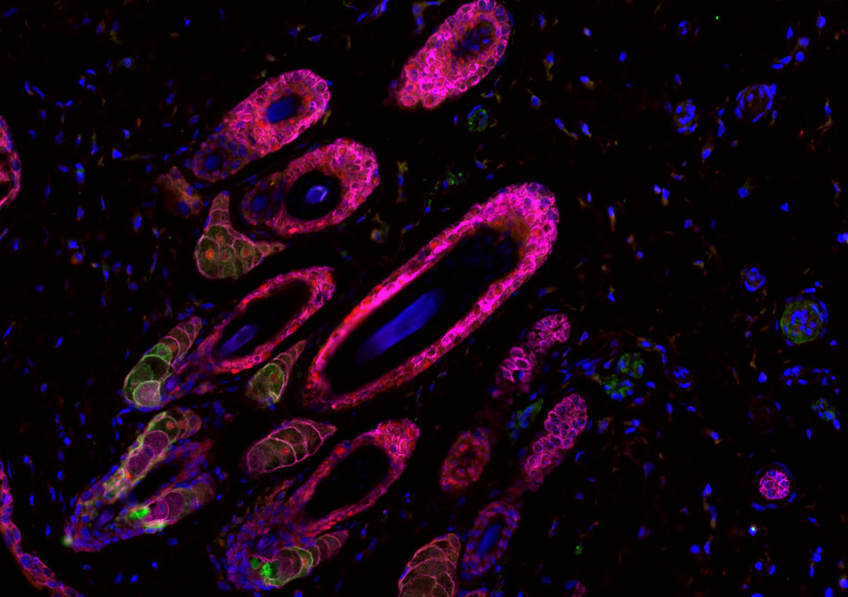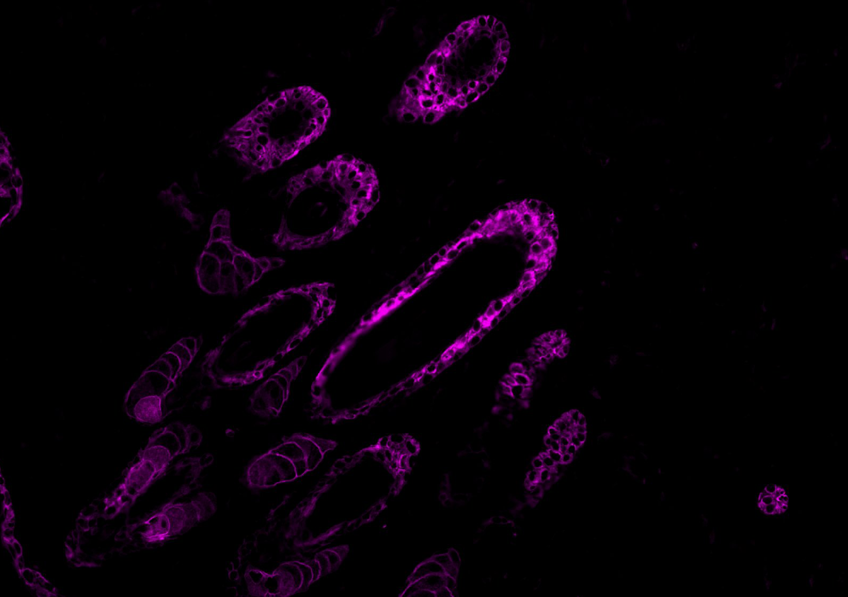© Inserm
© Inserm
Alors que l’Inserm fête cette année ses 60 ans, l’Institut souhaite plus que jamais continuer à proposer de nouvelles initiatives pour rendre les sujets scientifiques accessibles au plus grand nombre. Tout au long de l’été, de nouveaux formats seront ainsi diffusés auprès du public, pour permettre à chacun de mieux comprendre le travail de l’Inserm mené au service de la santé de tous.
Dès le 21 juin, l’Inserm vous propose donc de découvrir son initiative inédite : la série de podcasts Les volontaires qui part à la rencontre de celles et ceux qui participent à la recherche en santé dans les laboratoires de l’Institut. Un format attractif qui permet de revenir sur leur rôle précieux en faveur de la recherche. Puis, à partir de la semaine du 24 juin, retrouvez sur le compte Instagram de l’Inserm une série créative de bande-dessinées qui éclaire les liens étroits entre activité physique et santé, célébrant cet été placé sous le signe des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Au-delà de sa fonction première qui est de mener des avancées scientifiques, le rôle de l’Inserm est aussi d’informer les citoyennes et les citoyens afin qu’ils puissent mieux comprendre la démarche scientifique et être acteurs de leur propre santé. Toutefois, pour mener à bien cette mission, encore faut-il réussir à amorcer un réel dialogue avec le public, en proposant des contenus pertinents, accessibles et sans cesse renouvelés, fondés sur des données scientifiques rigoureuses.
Cet été 2024, l’Inserm vous invite ainsi à découvrir ses nouvelles initiatives visant à mieux partager avec tous les citoyens les avancées de la recherche biomédicale et en santé.
Les volontaires : des podcasts pour découvrir celles et ceux qui participent à la recherche en santé de l’Inserm
Le podcast est un format qui séduit de plus en plus d’auditeurs en France. Près de 200 millions de podcasts seraient d’ailleurs écoutés chaque mois dans l’Hexagone ! Face à cet engouement, l’Inserm a donc fait le pari de proposer sa propre série, en mettant à l’honneur un maillon essentiel de la recherche : les volontaires qui participent aux études menées par l’Institut.
La série Les volontaires propose de comprendre le rôle primordial de ces citoyennes et de ces citoyens en les suivant lors des expérimentations et en les accompagnant dans les laboratoires. Suivez Joanna, 8 ans, dans son parcours pour déterminer l’impact de la pollution sur sa santé, Giovanna, militante associative et son combat pour améliorer la prise en charge des personnes transgenres vivant avec le VIH, ou encore Stéphane, 23 ans, et Geneviève, 74 ans, sur le tapis d’entraînement afin de mesurer les effets du vieillissement sur la motricité…
D’une durée de 10 à 15 minutes par épisode, orchestrés par le journaliste scientifique Chandrou Koumar, ces podcasts diffusés à partir du 21 juin 2024 font partie intégrante de la démarche de l’Inserm pour expliquer et valoriser la recherche en santé et fournir une information scientifique de qualité à tous.
Plus d’informations sur le podcast de l’Inserm
Les épisodes sont notamment disponibles sur Apple Podcast, Audible, Deezer, Spotify et YouTube.
Des BD sur Instagram pour parler de sport avec les jeunes
Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 vont occuper une grande partie de l’actualité dans les prochaines semaines. Si les liens étroits entre activité physique, sport et santé ne sont aujourd’hui plus à prouver, de nombreuses idées reçues demeurent. Profitant de la notoriété de sa série Canal Détox, l’Inserm s’apprête à publier une série de cinq nouveaux textes qui tenteront de répondre à des questions que se posent fréquemment les internautes :
- Le sport s’accompagne t-il toujours d’une perte de poids ?
- Avoir une activité physique pour lutter contre le cancer, vraiment ?
- Les étirements permettent-ils vraiment d’empêcher les courbatures ?
- Quel est l’intérêt des protéines pour les sportifs ?
- Quelles techniques de récupérations privilégier pour récupérer après un effort ?
Et pour toucher un public plus large et plus jeune, l’Inserm s’est associé à l’illustratrice scientifique Flore Avram afin de décliner ensuite ces cinq textes au format BD. Des petites planches illustrées avec humour et finesse, qui seront publiées sur le compte Instagram de l’Inserm, au rythme d’une bande dessinée par semaine, sur les cinq semaines précédant la série d’ouverture des JOP. Rendez-vous le 26 juin pour découvrir le premier épisode !
Les Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris et en France sont l’occasion d’accueillir massivement les spectateurs au sein d’un grand espace festif d’animation et de célébration : le club France. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) a manifesté son intérêt pour tenir et animer un stand au sein de ce club France lors des JOP 2024, auquel l’Inserm est convié à participer. Du 1e au 4 août 2024 les équipes de recherche dijonnaises du laboratoire Cognition, action et plasticité sensorimotrice (Caps) de l’Inserm présenteront leurs travaux de recherche au travers des animations suivantes : Le rameur-FES : une technique de réadaptation innovante Grâce à une stimulation électrique des muscles des cuisses, le rameur-FES permet à des personnes paraplégiques de ramer ! Testez vos qualités physiques à travers quelques sauts avec l’Optojump ! Force, vitesse, puissance, détente, aérobie, souplesse… les sauts verticaux font partie des tests de terrain les plus utilisés pour déterminer les qualités physiques des muscles du membre inférieur. La mesure du temps de suspension donne l’estimation de la hauteur de saut et la puissance développée. L’électrostimulation pour se muscler L’électrostimulation musculaire est une technique efficace utilisée dans le monde médical et sportif. Elle offre de nombreux bénéfices que ce soit pour le sportif ou pour des populations plus fragiles.