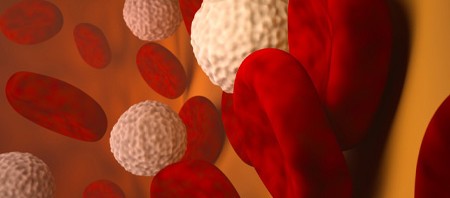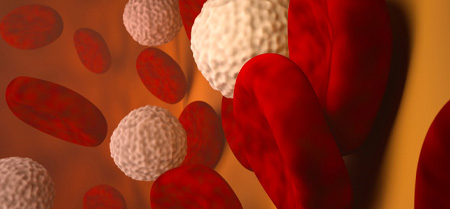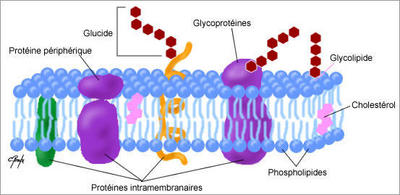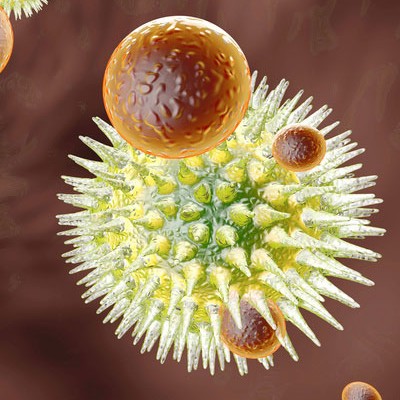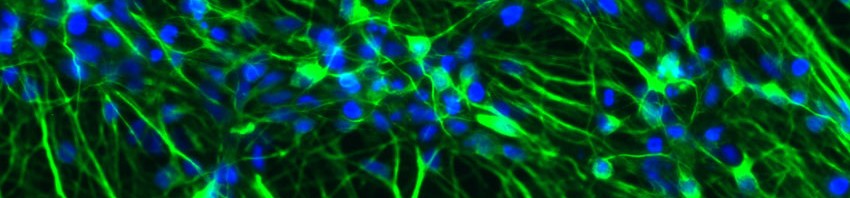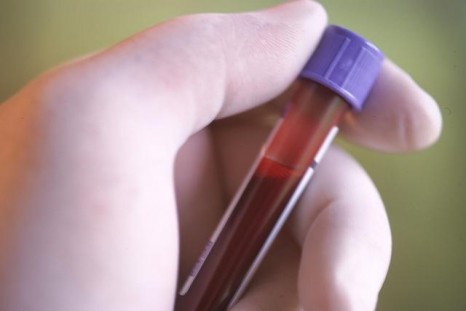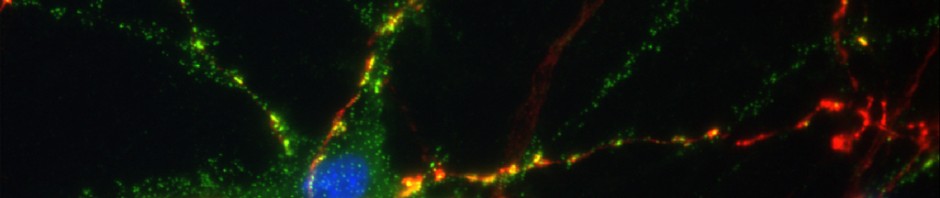Un nouveau dispositif permettant de dessiner et d’écrire grâce aux mouvements des yeux vient d’être mis au point par un chercheur CNRS au Centre de recherche de l’institut du cerveau et de la moelle épinière (CNRS/UPMC/Inserm). Comme s’il s’agissait d’un stylo, l’utilisateur peut tracer des lettres, des chiffres, des figures, une signature, et même réaliser des dessins avec son regard grâce à une technique très simple incluant un oculomètre (1) et un écran d’ordinateur. Cette performance se base sur une illusion visuelle qui permet aux yeux de tracer des trajectoires lisses et claires après quelques heures d’entraînement.
Ce système pourrait améliorer les conditions de vie de patients atteints de paralysie des membres. Ces travaux sont publiés le 26 Juillet 2012 dans la revue Current Biology.
©J Lorenceau, CNRS
Les dispositifs actuels d’écriture à l’aide des mouvements oculaires permettent seulement de choisir parmi les lettres ou les mots qui s’affichent sur un écran. Ils ne laissent pas la liberté de tracer ses propres figures. Jusqu’à présent, on pensait que cela était impossible. En effet, si l’œil peut suivre très efficacement un objet qui se déplace, il n’est pas capable de réaliser des mouvements lisses et réguliers devant un arrière-plan statique. Toute tentative en ce sens se traduit par une succession de saccades assez irrégulières.
Pour obtenir de l’œil des trajectoires lisses, Jean Lorenceau, chercheur CNRS au Centre de recherche de l’institut du cerveau et de la moelle épinière (CNRS/UPMC/Inserm) a eu l’idée d’utiliser une illusion visuelle appelée reverse-phi connue depuis les années 70 mais qui n’avait jusqu’à présent aucune application. L’illusion se produit lorsque, sur un écran, s’affichent quelques centaines de disques dont la luminance (2) varie au cours du temps à une fréquence d’environ 10-15 Hertz (Hz). Lorsque son regard se déplace sur ce fond clignotant, le sujet a la nette impression que les disques se déplacent avec le mouvement des yeux.
Puisque l’œil humain est capable de suivre avec précision des objets qui bougent, le déplacement illusoire des disques induit par le mouvement des yeux donne à ceux-ci une sorte d’appui mouvant leur permettant de réaliser des trajectoires régulières et non saccadées. Un oculomètre (1) enregistre les mouvements de l’œil de l’utilisateur et un logiciel très simple permet de les visualiser sur un écran. Deux à quatre sessions d’entraînement d’environ 30 minutes sont nécessaires pour parvenir à maîtriser ses mouvements oculaires de façon à tracer des lettres.
Dans les tests réalisés, les sujets ont d’abord appris à percevoir le mouvement reverse-phi, puis à « s’accrocher » à ce mouvement un peu à la manière d’un surfeur qui « s’accroche » à la vague. Ensuite, les sujets ont progressivement appris à « surfer » sur cette illusion visuelle de mouvement pour piloter à volonté leurs mouvements oculaires. Grâce à ce système, une personne bien entraînée peut écrire avec ses yeux à peu près à la même vitesse qu’avec sa main. Si l’attention nécessaire pour tracer des figures peut devenir fatigante au début, l’entraînement permet de créer des automatismes qui facilitent l’écriture.

©J Lorenceau/CNRS
Ce dispositif pourrait donner aux personnes atteintes de paralysie des membres le moyen de personnaliser leur écriture, tracer leur propre signature, ou plus généralement, s’exprimer et communiquer de façon plus libre et créative.
Le prochain pas dans ces recherches consistera à proposer à des personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique d’utiliser l’invention. Mais Jean Lorenceau pense que d’autres applications sont possibles pour ce système: celui-ci pourrait servir à l’entrainement de pilotes, chirurgiens, sportifs, artistes (3) et autres personnes dont les activités exigent un contrôle oculomoteur précis. Il pourrait aussi permettre de concevoir des systèmes de sécurité basés sur la reconnaissance de mouvements oculaires.Notes :
(1) Un oculomètre permet d’enregistrer les mouvements oculaires en analysant les images de l’œil humain captées par une caméra pour calculer la direction du regard du sujet.
(2) La luminance est l’intensité d’une source étendue dans une direction donnée, divisée par l’aire apparente de cette source dans cette même direction. Il s’agit d’une grandeur photométrique, c’est-à-dire qui dépend de la sensibilité de l’œil humain.
(3) Une collaboration est notamment en cours avec Michel Paysant, artiste contemporain qui réalise des dessins avec les yeux et dont l’objectif vise à tester les nouvelles possibilités de ce dispositif : https://www.michelpaysant.fr/onlab/