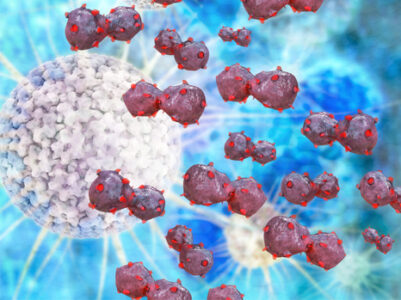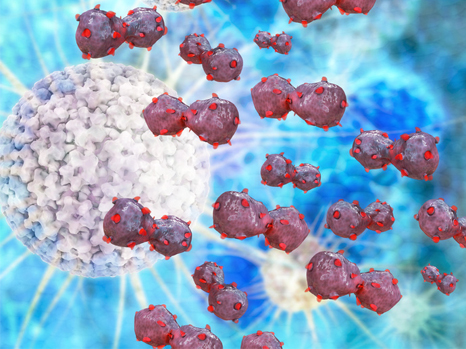© AdobeStock
© AdobeStock
Omniprésents dans notre quotidien, les per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont associés à des conséquences néfastes sur la grossesse et le développement du fœtus, selon plusieurs publications récentes. Dans une nouvelle étude réalisée auprès de 367 femmes enceintes, des chercheuses et des chercheurs de l’Inserm, de l’Université Grenoble Alpes (UGA), du CEA et du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes (CHU), ont examiné l’impact de ces polluants sur le placenta. Publiés le 30 janvier 2025 dans la revue Environment International, leurs résultats suggèrent une association entre l’exposition à plusieurs PFAS et une altération de cet organe qui assure les échanges entre le sang de la mère et celui du fœtus[1].
La littérature scientifique regorge d’études qui associent les per- et polyfluoroalkylées, plus connus sous le nom de PFAS[2], à des effets indésirables pour la mère et l’enfant. Plusieurs travaux suggèrent que l’exposition à ces substances, devenues incontournables dans notre quotidien en raison de leurs propriétés antiadhésives et imperméables ainsi que de leur résistance aux fortes chaleurs, augmente le risque de donner naissance à des bébés de petit poids ou de souffrir de troubles hypertensifs pendant la grossesse.[3]
Une nouvelle étude coordonnée par l’Inserm et le CHU publiée le 30 janvier 2025 dans la revue Environment International ouvre la voie à une meilleure compréhension des mécanismes expliquant certains de ces effets. Ils pourraient provenir en partie d’une altération du placenta.
« Le placenta est un organe essentiel pendant la grossesse qui fait le lien entre la mère et le fœtus et permet, entre autres, les échanges de gaz et de nutriments », explique Claire Philippat, co-dernière autrice de l’étude et chercheuse à l’Inserm.
Ces résultats ont été obtenus par un consortium de chercheurs de l’Inserm, du CNRS, du CEA, de l’UGA et du CHU de Grenoble. Ils se fondent sur une cohorte de 367 mères (et de leurs enfants) recrutées entre 2014 et 2017 dans la région grenobloise[4].
L’équipe s’est intéressée aux conséquences de l’exposition à treize per- et polyfluoroalkylées sur la santé du placenta. Les chercheurs ont constaté que trois d’entre eux[5] semblent affecter l’intégrité des villosités placentaires, structures qui assurent les échanges entre le sang maternel et le réseau vasculaire fœtal.
Concrètement, ces altérations suggèrent une moins bonne perfusion de l’organe et une diminution des échanges entre la mère et le fœtus, ce qui peut entraîner une baisse des apports en oxygène et en nutriments.
« Selon de précédentes études, les dérégulations dans les échanges fœto-maternels seraient associés aux retards de croissance intra-utérins et au développement de la prééclampsie », explique Nadia Alfaidy, directrice de recherche à l’Inserm et co-dernière autrice de cette étude. La prééclampsie se caractérise par une hypertension artérielle et une présence importante de protéines dans les urines.
Le poids du placenta semble aussi réduit chez les femmes présentant les concentrations les plus élevées de sept PFAS[6] . Or, plusieurs études suggèrent qu’une diminution du poids de cet organe peut indiquer que ses fonctions sont compromises, affectant le développement du fœtus[7].
Alors que de précédents travaux de recherche ont déjà tenté de déterminer comment les PFAS affectent le poids[8] et la vascularisation du placenta[9], « notre étude est la première à disposer de marqueurs histologiques spécifiques, qui rendent compte de la structure du placenta. Ces marqueurs permettent d’apporter des éléments sur les mécanismes par lesquels les PFAS pourraient affecter la santé placentaire », commente Claire Philippat.
À l’avenir, l’équipe scientifique souhaite reproduire cette étude à plus grande échelle pour confirmer ces résultats : « Nous espérons qu’une étude nationale verra le jour sous peu afin de mieux comprendre les conséquences de l’exposition aux PFAS sur la santé de la mère et de l’enfant », conclut la chercheuse.
[1] https://www.inserm.fr/c-est-quoi/allo-la-mere-cest-quoi-le-placenta/
[2] https://presse.inserm.fr/cest-dans-lair/un-point-sur-les-pfas/
[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300483X20302043?via%3Dihub
[4] https://cohorte-sepages.fr
[5] Les PFHxA (acides perfluorohexanoïques), les PFHpA (acides perfluoroheptanoïques) et les PFTrDA (acides perfluorotridecanoiques)
[6] Les PFDA (acides perfluorodécanoïques), PFHpS (acides perfluoroheptanes sulfoniques), PFHxS (acides perfluorohexanes sulfoniques), PFNA (les acides perfluorononanoïques), PFOA (les acides perfluorooctanoïques), PFOS (perfluorooctane sulfonate), PFUnDA (acide perfluoro-n-undécanoïque)
[7] https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The%20placenta%20is%20the%20center%20of%20the%20chronic%20disease%20universe&publication_year=2015&author=K.L.%20Thornburg&author=N.%20Marshall
[8] https://academic.oup.com/aje/article-abstract/168/1/66/123645?redirectedFrom=fulltext&login=false
[9] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143400424000699