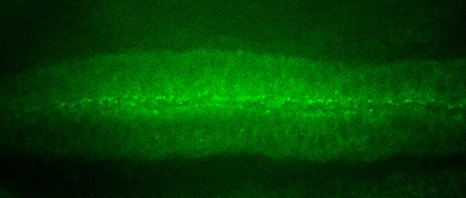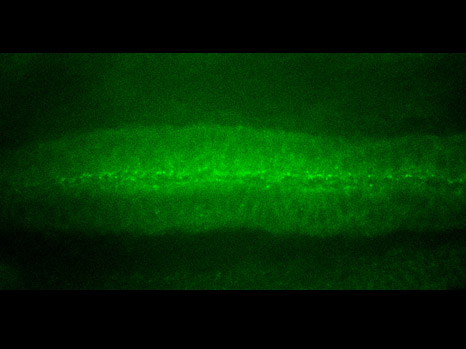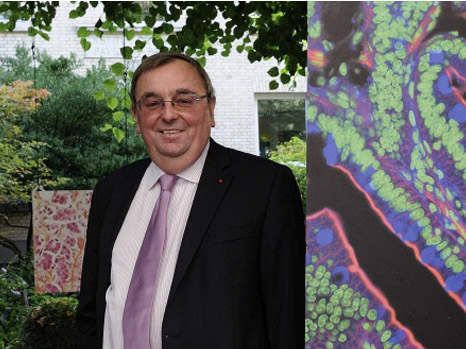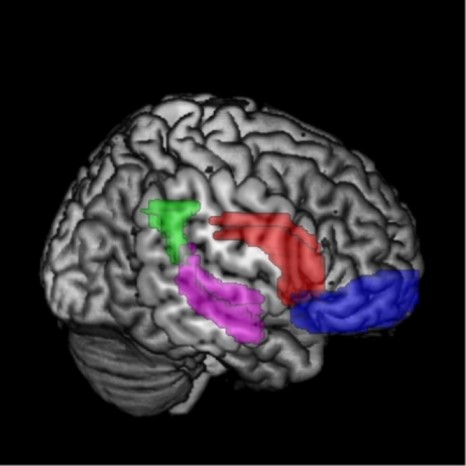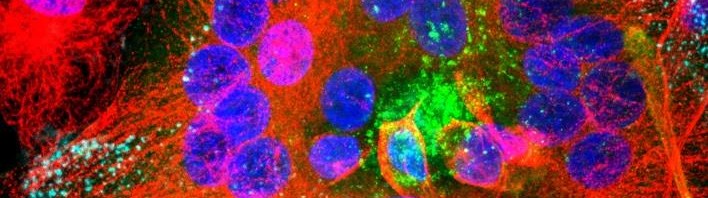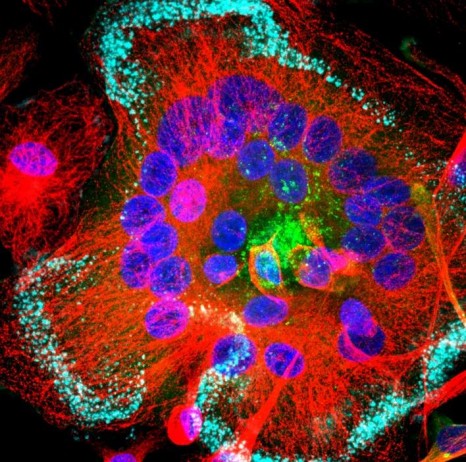Le nouveau rapport « Mortalité maternelle en France », coordonné par l’unité Inserm U953 « Recherche épidémiologique en santé périnatale et santé des femmes et des enfants », annonce une baisse du taux de mortalité par hémorragie du postpartum – première cause de mortalité maternelle en France – sur les données de 2007-2009 par rapport à 2004-2006.
Vingt recommandations ont été formulées par le Comité National d’Experts sur la Mortalité Maternelle dans le but de sensibiliser les professionnels de santé et les futurs parents en concertation avec le Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français, la Société Française des Anesthésistes-Réanimateurs/Club d’Anesthésie-Réanimation en Obstétrique, ainsi que le Collège National des Sages-femmes de France.
Les résultats épidémiologiques de ces travaux ont été publiés dans le Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction, de Novembre 2013.
La mort maternelle est devenue un événement très rare mais reste un indicateur reconnu et fondamental de santé d’un pays et un signal à l’attention des professionnels de la santé et des décideurs, témoignant d’éventuels dysfonctionnements du système de soins. La mort maternelle est le décès d’une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours, ou 1 an, après sa terminaison, pour une cause quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu’elle a motivés, mais ni accidentelle, ni fortuite.
De 2007 à 2009, 254 décès maternels ont été identifiés, ce qui représente 85 femmes décédées par an en France, d’une cause liée à la grossesse, à l’accouchement ou à leurs suites, donnant un taux de mortalité maternelle de 10,3 pour 100 000 naissances vivantes.
La France a un taux comparable à celui des pays européens voisins disposant d’un système renforcé d’étude et présente une situation favorable par rapport aux Pays-Bas et aux Etats-Unis où le taux est en hausse.La nouveauté encourageante est que la mortalité maternelle par hémorragie du postpartum – première cause de mortalité maternelle en France – a diminué pendant la période 2007-2009 par rapport à 2004-2006.
Selon la méthodologie améliorée de mesure, qu’il faut pérenniser, la fréquence de la mortalité maternelle est globalement stable. Il semble encore possible de la faire diminuer puisque des progrès ont été obtenus : baisse de décès liés aux hémorragies et diminution des soins non optimaux.
« Ces résultats sont à mettre en rapport avec l’importante mobilisation, depuis dix ans, des chercheurs et des cliniciens, dont l’attention fut attirée par les premiers résultats de cette enquête, pour évaluer et améliorer les soins dans le contexte de l’hémorragie obstétricale. Toutefois, l’amélioration doit encore se poursuivre puisqu’environ 50% de ces décès sont considérés comme « évitables » en France, dans les conditions actuelles et l’accès généralisé des femmes enceintes à la surveillance prénatale et à des soins de qualité. » commente Marie-Hélène Bouvier-Colle, Directeur de recherche émérite Inserm au sein de l’unité Inserm U953 « Recherche épidémiologique en santé périnatale et santé des femmes et des enfants ».
Les facteurs de risque maternels
L’âge et la nationalité maternels et la région de décès sont les principaux facteurs individuels identifiés comme liés à la mortalité maternelle.
L’âge est un des facteurs déterminants de la mortalité maternelle : plus de 50% des décès concernent des femmes entre 30 et 39 ans, ce qui s’explique par le fait que les grossesses en général se déroulent à des âges de plus en plus élevés et surtout par le risque nettement augmenté de mortalité maternelle après 35 ans.
Des différences significatives sont observées entre les nationalités : les femmes de nationalité subsaharienne ont le taux de mortalité maternelle le plus élevé : 22,4 pour 100 000, soit plus de deux fois supérieur à celui des femmes françaises.
Selon les régions de France, les taux varient : le taux de mortalité maternelle est plus élevé que la moyenne nationale dans les départements d’outre-mer (32,2 pour 100 000) et en Ile-de-France (12,5).
Les autres facteurs de risque de la mort maternelle sont l’obésité et les grossesses multiples.
Les causes obstétricales de décès
Les premières causes directes de mortalité maternelle sont les hémorragies obstétricales qui représentent 18% des décès, puis, ce qui est relativement nouveau, les embolies pulmonaires (11%), et les complications de l’hypertension (9%).
Le grand changement concerne le pourcentage des hémorragies du post-partum qui a diminué de moitié depuis le dernier rapport (8% (1,9/100 000) contre 16% (2,5/100 000) en 2004-2006). Ce résultat encourageant est probablement dû à la mobilisation des professionnels depuis plusieurs années.
Adéquation des soins et évitabilité
Les soins ont été jugés « non-optimaux », c’est-à-dire non conformes aux recommandations de pratiques et aux connaissances actuelles, pour 60% des décès expertisés contre 72% entre 1998 et 2000, ce qui représente une baisse significative. Les décès par hémorragies présentent la plus grande proportion de soins non optimaux (81%).
54% des décès maternels ont été jugés « évitables », c’est-à-dire pour lesquels une modification des soins ou de l’attitude de la patiente vis-à-vis de l’avis médical aurait pu changer l’issue fatale (erreur ou retard de diagnostic, retard ou premiers secours inadaptés, traitement inadéquat, retard au traitement ou à l’intervention, et négligence de la patiente). Ce taux, stable dans le temps, reste principalement dû à une inadéquation de la thérapeutique et un retard au traitement, ce qui sous entend qu’une marge d’amélioration est possible.
Ces résultats ont permis aux auteurs du rapport d’émettre 20 recommandations, parmi lesquels on peut mentionner :
– l’importance de l’implication des soignants dans la déclaration et la revue des morts maternelles pour assurer une meilleure connaissance du profil national de ces cas,
– l’évaluation des risques avant la conception et en début de grossesse, via la prévention : vaccination contre la grippe pour les femmes prévoyant une grossesse ou enceintes, évaluation des risques d’une grossesse quand une pathologie est préexistante,
– l’examen médical de la femme enceinte en dehors de la sphère obstétricale (examen cardiaque par exemple),
– le maintien de la vigilance après l’accouchement quand la mère rentre à son domicile, c’est-à-dire l’informer sur les signes d’accidents thromboemboliques veineux et ischémiques artériels. Mesure, dont le Professeur Gérard Lévy, Président du Comité National d’Experts, souligne l’importance d’autant que ce retour à domicile est de plus en plus précoce.
– l’importance des examens post mortem des décès maternels,
– d’autres messages concernent la prise en charge médicale des hémorragies obstétricales, des infections, des maladies hypertensives, des embolies amniotiques, et des thrombo-embolies veineuses.
Méthodologie
Ce nouveau rapport a analysé les données datant de 2007 à 2009. Le précédent rapport publié en 2010 portait sur des données de 2001 à 2006.
Actuellement, la France a une méthodologie spécifique pour l’identification des décès associés à la grossesse s’appuyant sur plusieurs bases de données, celles : des causes de décès, de l’état civil pour les naissances et des séjours hospitaliers.
La mission du Comité National d’Experts sur la Mortalité Maternelle est d’identifier les causes des décès maternels grâce à l’information détaillée recueillie par l’enquête confidentielle menée par l’équipe Inserm 953 « Recherche épidémiologique en santé périnatale et santé des femmes et des enfants ». La procédure actuelle se déroule en 3 étapes :
– premièrement, il s’agit d’identifier le lien temporel de tous les décès de femmes survenus pendant la grossesse et jusqu’à un an après sa fin.
– puis, une enquête est réalisée par des cliniciens bénévoles, les assesseurs, auprès de l’équipe médicale qui a suivi la grossesse, réalisé l’accouchement et pris en charge la complication.
– enfin, le décès est classé par le Comité National d’Experts qui jugera, au vu des éléments de l’enquête, si le décès a un lien causal direct ou indirect avec la grossesse, si les soins prodigués ont été optimaux ou non, et s’il était « non évitable », « peut-être évitable » ou « certainement évitable » par des soins plus adéquats ou une meilleure observance de la patiente.